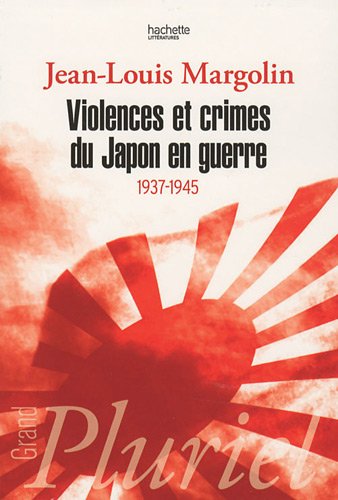Il s’agit des violences de la période de la Seconde Guerre mondiale, fort peu étudiées pour le théâtre asiatique, alors qu’elles sont responsables d’environ 40% du total des morts du conflit (environ 27 millions). L’auteur ne fournira ici que les grandes lignes de quelques aspects de cet immense sujet. Pour davantage de précisions, sur ces points et sur bien d’autres, se référer en particulier à son « L’armée de l’empereur : Violences et crimes du Japon en guerre (1937-1945) », Paris, Armand Colin, 2007, 479 p. et à la nouvelle édition revue et augmentée sous le titre « Violences et crimes du Japon en guerre (1937-1945) », Paris, Hachette littératures- Grand Pluriel, 2009.
Egalement de l’auteur, au festival de géopolitique de Grenoble (2018) : « Géopolitique des anti-américanismes »
Violences de guerre, une composante de la Seconde Guerre mondiale ? Une guerre spécifique ?
Il est délicat de situer cette guerre. Aucun consensus ni sur le point de départ (1931, invasion de la Mandchourie par le Japon ; 1937, début de la guerre sino-japonaise ; 1941, attaque nippone contre le monde anglo-saxon et les Pays-Bas – pour l’Indonésie), ni sur le nom. Au Japon : Guerre de la Grande Asie de l’Est (jusqu’en 1945, et depuis pour la droite nationaliste), Guerre de Quinze Ans (gauche japonaise, insistant sur l’agression première contre la Chine), Guerre de l’Asie-Pacifique (plus consensuel, met en valeur une Asie où l’on se battit pendant huit ans). En Chine et à Taiwan : Guerre de Résistance contre l’Agression japonaise. Aux Etats-Unis, mais aussi aux Philippines : Guerre du Pacifique.
Pour le Japon, il s’agit initialement d’une manière de croisade contre le communisme, Chiang Kaï-Shek formant le Front Uni ave le PCC, ou l’engagement d’aviateurs soviétiques aux côtés de la Chine Libre. Mais avec la défaite frontalière (Nomonhan) de 1939 face à l’URSS, avec le pacte Hitler-Staline (août 1939) doublé en avril 1941 d’un Pacte de Neutralité entre Moscou et Tokyo, et avec l’occasion de se retourner vers l’Asie du SE fournie par la défaite de la France et des Pays-Bas en 1940, c’est le libéralisme anglo-saxon qui devient l’ennemi. Ce qui vaut d’ailleurs le ralliement au militaro-fascisme nippon de la grande majorité des militants, cadres et intellectuels de la gauche marxiste japonaise (certes vigoureusement réprimée en tant que telle).
Le Pacte Tripartite (Axe Rome-Berlin-Tokyo) de septembre 1940 fut une alliance presque sans effectivité : aucune opération militaire conjointe, deux théâtres séparés de milliers de kilomètres, peu de contacts après décembre 1941. C’est le monde anglo-saxon (colonies incluses) qui les relie, toutes ses composantes combattant tant l’Allemagne que le Japon. Mais ce dernier n’est le principal adversaire que pour la seule Australie. Par contre l’URSS (attaquée, et non attaquante de l’Allemagne) est un « disjoncteur » : non seulement la neutralité est scrupuleusement respectée jusqu’au 8 août 1945 (trois mois après la défaite de l’Allemagne), mais le Japon accepte que l’URSS soit constamment ravitaillée en armements par les USA, via Vladivostok, en passant à proximité de l’archipel nippon.
La chronologie du théâtre Asie-Pacifique est elle-même disjointe de celle de l’Euro-Méditerranée : malgré le coup d’arrêt précoce à l’expansion japonaise représenté par la victoire navale américaine de Midway (juin 1942), l’année 1944 cumule encore pour le Japon de grands succès (en Chine) et de graves défaites (aux Mariannes, aux Philippines, en Birmanie), qui n’entament cependant qu’à la marge son immense empire de guerre. Cependant, la capitulation allemande précipite la chute du Japon, puisqu’elle « libère » à la fois les bombes atomiques conçues contre Hitler et les divisions blindées de l’Armée Rouge.
Où, enfin, se situe l’épicentre de cette guerre ? En effet, il est indéniable que les combats décisifs se déroulèrent dans le Pacifique (Philippines incluses), et que les vainqueurs furent anglo-saxons. Mais le plus grand nombre des soldats nippons fut stationné en Chine et au Japon même, et près de 99% des victimes furent asiatiques (dont environ 15% de Japonais et 55% de Chinois).
Des crimes de guerres semblables à ceux du régime national-socialiste ?
Blois 209 : « Construire des empires ? Les politiques coloniales de l’Italie, de l’Allemagne et du Japon avant et pendant la Seconde Guerre mondiale » – Pierre-François Souyri, Johann Chapoutot, Valéria Galimi, Christian Ingrao
Le pourcentage des civils parmi les victimes du conflit fut de près de 80%, soit nettement plus que sur l’autre théâtre (environ 50%), malgré la Shoah. Les morts des famines induites par les politiques d’occupation et par les opérations militaires, en particulier, se comptèrent par millions.
On relève quatre similitudes avec les crimes nationaux-socialistes
- De très nombreux massacres de civils (comme à Nankin en 1937 –20 000 à 30 000- ou à Manille en 1945 –des dizaines de milliers-), surtout liés à des attitudes de résistance, qu’elles soit effective (en Chine et aux Philippines principalement) ou supposée (Chinois de Singapour et de Malaisie). Les opérations des « Trois Tout » contre les guérillas chinoises (tout tuer, tout piller, tout détruire) tuèrent des millions de personnes et en déplacèrent plus encore.
- Une utilisation quasi-systématique de la torture contre les opposants, en particulier du fait de la Kempeitai (gendarmerie militaire). La plupart ne survivent pas.
- Un pillage en règle des pays occupés, par divers biais : pillage direct, et plus indirectement confiscation des biens et entreprises des Occidentaux, cartellisation forcée sous direction japonaise, cultures forcées (en particulier de plantes textiles) en lieu et place des rizières, organismes publics d’achat obligatoire de denrées agricoles à prix très bas, émission de « monnaies de singe » par les troupes d’occupation, compartimentage de zones d’occupation contraintes à l’autarcie. Cela, additionné à la rupture des voies maritimes de communication du fait de l’action des sous-marins américains, conduisit progressivement à une raréfaction des denrées alimentaires (qu’on ne pouvait plus faire parvenir dans les zones traditionnellement déficitaires) et des médicaments, ainsi qu’à une quasi-disparition des textiles. Un dixième des Singapouriens mourut d’affections induites par la faim en 1944-45.
- Une mobilisation du travail sous contrainte, parfois sur un modèle esclavagiste. Cela concerna 2,5 millions de ressortissants du Manchukuo (Etat fantoche de Mandchourie), deux millions de Chinois du nord, 800 000 Coréens, et des millions d’Indonésiens, Malayens ou Birmans, souvent purement et simplement raflés et envoyés sur les grands chantiers (voies ferrées, aérodromes, ports). Ainsi, 300 000 Javanais furent expédiés hors de Java, principalement sur le « chemin de fer de la mort », entre Thailande et Birmanie, où plus de 70 000 coolies et prisonniers de guerre occidentaux périrent – une vie pour chaque traverse de la voie. Seule la moitié des travailleurs javanais esclaves (romusha, en japonais) survécut.
Quatre différences (relatives ou absolues) distinguent les exactions du Japon de celles de l’Allemagne
- Le traitement des prisonniers de guerre (PG) par le Japon fut plutôt pire que celui infligé par les Allemands, en particulier pour les militaires occidentaux : 4% de pertes dans les stalags allemands, 27% dans les camps japonais. Au début de la guerre, la grande majorité des PG chinois furent massacrés séance tenante (30 000 à 60 000 lors de la prise de Nankin). Ensuite, les nécessités logistiques (coolies), la nécessité de former des armées collaboratrices et les besoins des industries de guerre au Japon les firent davantage épargner.
- Les crimes sexuels des militaires japonais furent bien plus étendus que ceux des Allemands. Dans cette guerre, seul le comportement de l’Armée Rouge en Allemagne peut leur être comparé. Les vagues de viols (8 000 à 20 000 à Nankin), prenant l’apparence d’une chasse aux femmes, semèrent la terreur parmi les populations occupées ; à l’approche de soldats nippons, les femmes nubiles devaient se cacher ou s’arranger pour paraître repoussantes. Il s’agit souvent là aujourd’hui du souvenir le plus vif conservé du comportement japonais. Destinées à limiter ces agressions anarchiques, les femmes de réconfort (cf. ci-dessous) constituent une pièce supplémentaire dans un accablant dossier.
- Le commerce de la drogue fut dans la pratique autorisé et même encouragé, au moins en Chine, alors que le gouvernement chinois était parvenu à beaucoup le réduire. A Nankin, en 1938, on comptait 30 magasins et 14 hôtels licenciés pour vendre l’opium, ainsi que 175 fumeries. Trente délinquants en mal de leur dose et de l’argent pour la payer étaient arrêtés chaque jour par la police. Le but des Japonais était d‘assurer ainsi l’autofinancement de leurs hommes de main et alliés chinois, et de les attacher à leur présence.
- Le Japon ne commit cependant rien qui puisse ressembler à un génocide ; il n’en rêva même pas. Il ne professait pas un racisme d’Etat, fondé sur une approche biologique des groupes humains. Il reste que la haine des Chinois, en particulier, était si forte (ils ont refusé la main paternelle des Japonais, osent résistent à sa bienveillance…) qu’elle secrèta une manière de racisme secondaire ou d’opportunité, qu’on retrouve aussi à l’égard des « Blancs ». Le Japon récupère le mythe porteur du panasiatisme, désormais nippocentré et militariste.
C’est pourquoi le Japon ne forma pas de corps comparable aux SS, spécialistes ès-génocide. C’est l’armée elle-même qui se rendit coupable de presque tous les crimes.
Les Japonais sont-ils des humains à part entière ?
J’emprunte le titre à celui d’un essai d’Alfred Smoular (1992). Il se justifie dans la mesure où les Japonais de la période de guerre ont été traités par leurs adversaires chinois de « démons japonais », par les Britanniques de « yellow bastards », et se sont considérés eux-mêmes comme d’une essence si supérieure au reste de l’humanité que, par exemple, ils ont refusé jusque fin 1944 de mobiliser massivement leurs colonisés taiwanais ou coréens, méprisant leur valeur militaire. Il est également frappant que la propagande de guerre nippone, à la différence de tous les autres belligérants, exalte les valeurs nationales beaucoup plus qu’elle ne démonise les turpitudes de l’ennemi. Enfin, des millions d’occupés, de soumis et d’emprisonnés ont vécu des expériences atroces aux mains des Japonais, avec significativement moins d’anecdotes soulignant chez eux des traits d’humanité qu’on n’en trouve du côté allemand. Du coup, on leur voue encore fréquemment une haine inextinguible.
Pourtant, cette aptitude à la violence n’était pas inscrite dans les gênes. Ainsi, au cours de la guerre russo-japonaise (1904-05), le traitement humanitaire des prisonniers russes fut partout vanté comme exemplaire, alors même que les pertes nippones avaient été lourdes. Même constat avec les prisonniers allemands en 1914-18, le Japon combattant alors du côté de l’Entente. Et, depuis 1945, peu de peuples sont autant que le japonais attachés à la paix, et aussi hostiles au militarisme. Comment rendre compte de cette surprenante dualité comportementale ?
L’armée japonaise exalta comme peu d’autres des valeurs d’insensibilité et des pratiques de violence permanente dans ses propres rangs. On était formé « à coup de claques », et les soldats vétérans martyrisaient les « bleus », avec l’assentiment de l’encadrement. Les sanctions (souvent la mort) tombaient au moindre acte de défaillance ou de révolte. Lors d’une retraite, celui qui traînait la patte put se voir demander par son chef : « quand mourras-tu enfin ? ». A l’encontre des autres, plus faibles que lui, le soldat déversait les humiliations et vexations subies.
Dans la société autant que dans l’armée, le sacrifice de soi fut exalté.
On évoquait en 1944 les « cent millions de kamikazes » (y compris donc les 25 millions de colonisés) qui devaient se jeter –les civils avec des lances de bambou acérées- contre les chars américains une fois ceux-ci débarqués. Mais, dès 1932, chaque enfant scolarisé connaissait les noms des trois « héros-bombes » de Shanghai, qui s’étaient jetés avec des ceintures d’explosifs sur les tranchées chinoises. Les mères lancent à leurs fils partant à la guerre un stupéfiant « ne reviens pas vivant », ce qui aurait été une marque de lâcheté. Et les capturés refusent que la Croix Rouge communique à leur famille la nouvelle de leur survie.
Les peintures de Foujita, alors peintre officiel de la Marine, sont dès 1938 –bien avant la période des défaites- centrées sur le « sacrifice glorieux », bien plus que sur la victoire. Ce sacrifice de soi a pour contrepartie la propension à sacrifier l’autre sans aucun complexe, surtout quand, comme les PG, il ne s’est pas montré capable de combattre jusqu’à la mort. 蜉 On en trouvera une part de l’origine dans les guerres féodales (XIIe-XVIe siècles), revivifiées par l’éducation, la littérature et l’art : la rançon du prisonnier y étant inconnue, le massacre des vaincus (femmes et enfants inclus) était très fréquent, ce que ces derniers tentaient de prévenir par le suicide collectif.
Le culte impérial, imposé même aux populations conquises, se confond avec un ultra-nationalisme. Le Japon est un « pays divin », ce qui participe au mépris (qui n’est pas une haine raciale) pour les colonisés. On se bat en une « guerre sainte », qu’on tentera de traduire par jihad dans les terres musulmanes occupées – avec un succès mitigé. L’empereur est un dieu, mais plus un primus inter pares qu’un Pantocrator : au sanctuaire shinto de Yasukuni, à Tokyo, viennent résider mystiquement les esprits des 2 600 000 « soldats-dieux » sacrifiés pour l’Empereur.
La société nippone adhère profondément au projet d’expansion impériale, au militarisme, à la croyance dans la victoire finale. Même dans les camps de PG japonais, même chez les infirmières capturées, on massacre à l’occasion ou on ostracise ceux qui, §§après le 15 août 1945, ont l’audace d’ajouter foi à la nouvelle de la défaite. Et, à la différence des autres pays fascistes, le Japon n’a pas connu le moindre mouvement de résistance, pas même dans la très nombreuse émigration outremer.蜉 Cette adhésion est liée à une propagande permanente et de plus en plus insensée (les défaites y sont converties en victoires…), à l’éducation à la guerre et à la « loyauté » envers les supérieurs, dès l’école primaire ; enfin, à de multiples structures de mobilisation de masse – associations de voisinage distribuant les aides, associations de jeunes, de femmes, de réservistes, etc, à l’adhésion quasi-obligatoire.
Avec une efficacité moindre, ces armes idéologiques sont transportées dans les colonies et dans les pays occupés, où les fêtes nationales sont celles du Japon, et où les jeunes apprennent tant la langue japonaise que des chansons patriotiques, dont ils se souviennent encore aujourd’hui.
Il convient de ne pas exagérément singulariser le Japon. Il participe aussi au « temps du monde » : société de masse, uniformisation des valeurs et comportements, règne de l’Etat comme horizon et recours. Il est une composante un peu particulière (mais laquelle ne l’est pas ?) de la grande marée mondiale du fascisme, auquel il voue publiquement une véritable fascination. Il en partage le culte de l’Etat total, absorbant la société, la mobilisation permanente, la militarisation universelle, l’agressivité extérieure. Il en tire la légitimation d’une instrumentalisation sans complexe des vaincus (dénommés « bûches de bois » -maruta- par l’unité 731, qui travaillait aux armes bactériologiques avec des cobayes humains), et même des Japonais dans la dernière période (civils d’Okinawa utilisés comme boucliers humains, et parfois forcés à tuer leurs enfants, ou à se suicider).
La proximité de la période féodale (terminée en 1868, avec la rénovation Meiji) constitue une circonstance aggravante : être admis dans l’armée (où le port –symbolique- du sabre est réintroduit au milieu des années trente) assimile les roturiers aux prestigieux samouraïs, soit à la classe nobiliaire. Pas étonnant que les plus radicalement fascistes et jusqu’auboutistes des officiers soient alors d’origine paysanne, et que l’armée joue sur le « prestige » concédé aux soldats issus du peuple pour leur imposer une obéissance absolue, perinde ac cadaver, et éventuellement le sacrifice ultime.
Les « femmes de réconfort » représentent-elles le plus grand crime de guerre japonais ?
L’air du temps va dans ce sens : focalisation de la sensibilité contemporaine sur les crimes sexuels, et gigantesque campagne en Corée du Sud (où la question est un enjeu majeur de politique internationale) comme au niveau mondial. Pourtant, à l’époque de la guerre et ensuite, le cas des prostituées sous contrainte de l’armée japonaise (terme plus approprié que l’euphémisme employé alors, et depuis) fut assez peu évoqué, malgré un procès à Batavia condamnant à mort les responsables de l’asservissement sexuel de quelques dizaines d’internées néerlandaises. Pourquoi un tel silence, qui étonne et choque aujourd’hui ?
D’abord, l’énormité des crimes nippons, l’immensité des souffrances subies par des dizaines (voire centaines) de millions d’Asiatiques noyait quelque peu le malheur particulier de quelques centaines de milliers de femmes, dont, de plus, la grande majorité avait survécu. D’autre part, les crimes sexuels, comme on l’a dit, débordèrent très largement la prostitution aux armées, et furent fréquemment ressentis comme plus barbares que cette dernière, la violence étant là ouverte, et fréquemment étendue aux familles et voisins : à Nankin, davantage de femmes relativement âgées que de jeunes filles périrent, ce qui s’explique par la tentative des premières de s’opposer au viol des secondes. C’est aussi parce que cette brutalité nue n’exista guère en Corée coloniale que les femmes de réconfort y demeurent si centrales. Enfin, à l’époque de la guerre, le phénomène apparaissait assez banal, voire normal, la prostitution et ses douteuses pratiques étant presque partout légales, ou tolérées, et les armées de l’ensemble des belligérants ayant des pratiques prostitutionnelles point si différentes de celles des Japonais.蜉
La spécificité japonaise en la matière semble cependant avoir été triple : immense étendue et massivité des flux de prostituées, d’un bout à l’autre de l’énorme empire de guerre ; rôle de la Corée comme principal centre de recrutement, même si le chiffre de 80% de Coréennes paraît exagéré ; organisation et convoyage par l’armée, en train ou en bateau.
A l’encontre du maximalisme militant de certains groupes, relayés par de nombreux auteurs, on avancera cependant que rien ne prouve que les « femmes de réconfort » aient été plus maltraitées que la moyenne des prostituées asiatiques, coréennes en particulier. Beaucoup ont connu des souffrances, voire une mort liées à la guerre, mais moins fréquemment que leurs clients. Tout indique qu’en Corée, à la différence des pays occupés, elles furent bien plus souvent victimes de tromperies (sur leur destination, leur emploi) que d’enlèvements ou de viols.
Et qu’assez souvent il y eut de leur part une forme de consentement (avec toute l’ambiguïté du terme quand on est tenaillé par la misère et une tradition d’oppression masculine) ; elles furent parfois aussi l’objet d’une vente par leurs parents ou leur mari. Le précieux « cheptel » féminin n’était pas particulièrement brutalisé, les débordements de certains soldats pouvant être sévèrement punis. Et le sort des Coréennes, forcées ou non, différa peu de leurs consoeurs japonaises, toutes volontaires.
Enfin, elles disposaient de contrats à durée déterminée, et recevaient la moitié du prix (élevé) des passes. Qu’elles aient en général presque tout perdu de leurs gains, placés directement à la banque postale japonaise, fut essentiellement dû à la très forte inflation de l’immédiat après-guerre. Mais ce fut alors une expérience commune…
Le plus dérangeant, dans les actuelles campagnes d’opinion, c’est que la mise en avant des « femmes de réconfort » dissimule un autre drame, et des turpitudes. L’autre drame, c’est celui des quelques 800 000 travailleurs forcés coréens (environ 600 000 autres furent volontaires), parmi lesquels beaucoup de femmes.
Leur sort misérable demeure presque inaudible, et leur rancœur, du coup, va aux autorités sud-coréennes plus qu’aux japonaises. Les turpitudes, ce sont celles de la collaboration coréenne avec le Japon en guerre, extrêmement massive, parfois enthousiaste, alors que la faible résistance, nationaliste ou communiste, était rejetée sur les marges extérieures du pays (Kim Il-sung passa la guerre en Sibérie orientale). A quelques boucs émissaires près, on n’en parle pas, ou on l’excuse (cas des criminels de guerre coréens condamnés, traités par les Coréens unanimes en victimes de guerre).
Hiroshima était-il nécessaire ?
A lire sur les Clionautes, concernant les conséquences de la bombe dans le Japon d’après-guerre :
Clio-Geek – Pop culture et enseignement
La question, cruciale et récurrente, est généralement mal posée en Occident. Le Japon, tout d’abord, n’était pas prêt à se rendre à l’été 45, quoique sa défaite, à terme, ait été inévitable, surtout depuis la destruction de l’essentiel de ce qui lui restait de flotte lors de bataille du Golfe de Leyte (octobre 1944). Il disposait encore d’un vaste empire, son territoire métropolitain n’était pas entamé, plusieurs millions de soldats étaient prêts à le défendre, et rien n’indique que l’ « arrière » ait été sur le point de craquer, malgré les ébranlements causés par la famine et les bombardements conventionnels des villes de l’archipel. Les dirigeants militaires et civils décidés à se battre jusqu’au bout furent nettement majoritaires jusqu’au 10 août. Il fallut le triple choc des deux bombes A (6 et 9 août) et de l’entrée en guerre de l’URSS (8 août) pour les faire en partie changer d’avis, le rôle de l’empereur étant sur ce point décisif.
L’utilisation de la bombe fut l’expression de la démocratie américaine : impossible de négliger la lassitude d’une population démobilisée par la victoire sur l’Allemagne, impossible aussi de justifier par la suite la non-utilisation d’une arme (son existence aurait fini par être connue) qui aurait pu préserver de nombreuses vies américaines. Aucun des alliés de temps de guerre n’émit de réserves face à l’utilisation des bombes atomiques.
La bombe n’était pas en réalité destinée à avertir ou défier l’URSS – mythe constamment développé dans les milieux hostiles aux USA, sans aucune preuve concrète, alors que les archives de la période sont depuis longtemps ouvertes. La coïncidence avec l’entrée en guerre de cette dernière fut un hasard, la rencontre de deux calendriers non préétablis : celui de la mise au point de la bombe, celui de la défaite du Reich, qui devait être suivie à 90 jours par l’attaque soviétique, réclamée par les Etats-Unis… En réalité, en 1945, ce sont ces derniers qui défendent la ligne d’un compromis global avec l’URSS, au point par exemple de lui céder sans barguigner la moitié de la Corée, et d’entretenir d’excellentes relations (meilleures qu’avec Chiang Kaï-shek) avec son allié communiste chinois ; et c’est Moscou qui avance ses pions au maximum, tirant avec sa guerre de huit jours (8-15 août) contre le Japon d’énormes bénéfices (sud de Sakhaline, îles Kouriles, nord de la Corée, Mandchourie – qui servira de base de départ à la conquête de la Chine par le PCC), alors que ce sont les USA qui avaient brisé la machine de guerre nippone.
Le principal « oubli » des Occidentaux critiques de l’utilisation de l’arme nucléaire – il montre leur méconnaissance décomplexée de ce que fut cette guerre – réside dans ce fait incontournable : les quelque 250 000 morts des deux bombes A permirent de préserver la vie d’un nombre incalculable, mais en tout cas de nombreuses fois supérieur d’Asiatiques, auxquels on ajoutera une large part des quelque 200 000 Occidentaux, militaires et civils, alors détenus par le Japon. En effet, les activités économiques civiles s’étaient à ce point partout effondrées, les communications avaient à ce point été coupées, et le Moloch militaire avait à ce point aspiré force de travail et biens qu’une part rapidement croissante des populations se trouvait à la limite de mourir de faim (y compris au Japon), sans parler des effets directs catastrophiques de la guerre. Selon Werner Gruhl蜉, en 1945, le bilan hebdomadaire moyen des pertes humaines en Asie-Pacifique était de 149 000 (avec une marge d’erreur de 30%), chiffre effrayant, à peine croyable, et en constante augmentation. Les témoignages du temps montrent partout une situation terriblement dégradée… et l’enthousiasme incrédule ressenti à la brusque capitulation du Japon : on échappait à une mort souvent ressentie comme imminente.
Par contre, le « million de soldats américains tués », évoqué bien après la guerre par des membres de l’équipe Truman pour justifier l’usage de la bombe atomique, ne repose sur rien. L’armée avait évalué à 80 000 les pertes probables dans ses rangs lors d’une invasion du Japon, – cela aurait cependant presque doublé les pertes américaines de la guerre du Pacifique.
Il faut enfin rappeler cette évidence : contrairement à ce qu’affirment la droite révisionniste japonaise et une partie de la gauche américaine (elles sont souvent d’accord pour accabler Washington), la bombe atomique ne fut pas « raciale ». Elle avait été conçue contre Hitler, par des physiciens européens qui avaient de fortes raisons d’en avoir peur, et c’est là encore par un hasard de calendrier que le Japon en fut la seule victime. Quant aux bombardements classiques sur l’Allemagne, ils avaient été encore plus systématiques et meurtriers que ceux subis par le Japon.
Ces considérations d‘historien n’épuisent certes pas le débat sur la légitimité de la bombe atomique en général, de celles de 1945 en particulier. La discussion a des composantes philosophiques, voire théologiques au moins aussi légitimes que sa composante historique. Mais il importe au moins que la question soit bien posée, sous toutes ses facettes.
Blois 2015 Conférence avec Jean-François Souyri –Japon, automne 1945, le démantèlement de l’Empire