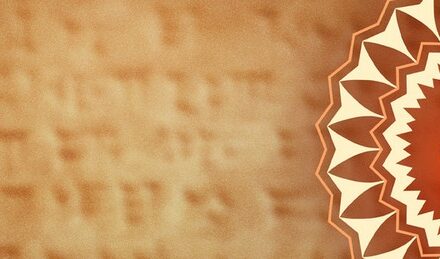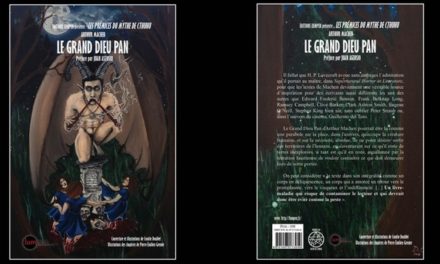Le 10 juin 2013, dans les salons feutrés de la résidence du Premier ministre japonais, Shinzō Abe paraphe un document qui va redéfinir la diplomatie culturelle nipponeCool Japan – The Project That Transformed Japan Into a Cultural Powerhouse. Le Cool Japan Fund reçoit officiellement 50 milliards de yens (500 millions de dollars) sur 20 ans, avec l’objectif ambitieux de quadrupler d’ici 2033 les ventes de contenus culturels japonais à l’étranger, principalement anime, manga et jeux vidéo, pour atteindre 20 000 milliards de yens (130 milliards de dollars)The Soft Power of Cool: Japanese Foreign Policy in the 21st century, Roberto Nisi. Parmi les vecteurs privilégiés : le manga. Mais que se passe-t-il lorsque ces « simples » bandes dessinées véhiculent des récits sur les épisodes les plus controversés de l’histoire japonaise ? Comment une planche de manga devient-elle un enjeu géopolitique, associant diplomatie et pouvoir mémoriel ?
L’affaire éclate à l’automne 2014 : la sortie du film Eien no Zero (永遠の0), adapté du roman de Hyakuta Naoki et bientôt décliné en manga, provoque une onde de choc en Asie orientaleDebate still rages over Abe-endorsed WWII drama. Hayao Miyazaki, le maître du Studio Ghibli, dénonce publiquement l’œuvre comme « un tissu de mensonges » sur la guerre, tandis qu’à Séoul, des manifestants dénoncent une « glorification du militarisme japonais« https://fr.wikipedia.org/wiki/Kamikaze,_le_dernier_assaut. À Tokyo, le gouvernement de Shinzō Abe garde le silence, mais les recettes du film dépassent les 8,76 milliards de yens, devenant le plus grand succès du cinéma japonais de 2013. Symbole de cette ambiguïté : le manga devient simultanément instrument de réconciliation et pomme de discorde.
Cette anecdote révèle une réalité méconnue : le manga japonais de guerre est devenu un acteur à part entière des relations internationales. Non par intention délibérée, mais par la force des choses. Car derrière chaque case, derrière chaque bulle, se cache une vision du monde, une interprétation de l’histoire, une projection de l’identité nationale.
Soft power et diplomatie culturelle – L’empire des signes réinventé
La doctrine du Cool Japan : quand la culture devient stratégie
Le concept de Cool Japan, théorisé en 2002 par le journaliste américain Douglas McGray dans son article fondateur « Japan’s Gross National Cool » (Foreign Policy, mai-juin 2002), postule que la culture populaire japonaise constitue une ressource stratégique comparable aux matières premières. Cette doctrine, rapidement adoptée par l’État japonais sous l’impulsion du ministre des Affaires étrangères Tarō Asō (lui-même amateur de manga), transforme le manga en ambassadeur culturel non officiel.
L’institutionnalisation de cette stratégie prend forme dès 2005 avec la création du Content Industry Strategy Committee au sein du ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI). En 2010, le Creative Industries Promotion Office voit le jour, suivi en 2011 par la Cool Japan Strategy Office directement rattachée au bureau du Premier ministre. L’architecture bureaucratique révèle l’ambition : faire du soft power culturel un pilier de la diplomatie japonaise.
Mais cette instrumentalisation soulève une question fondamentale : peut-on contrôler la réception internationale d’une œuvre culturelle ? L’exemple de notre corpus est révélateur. Tokkō no Shima (特攻の島, L’île des téméraires) de Satō Shūho, œuvre critique questionnant la logique militaire japonaise, a été perçue en République populaire de Chine comme une tentative de justification des actions militaires nippones. La traduction, les contextes de réception, les filtres culturels transforment radicalement le message initial.
L’exportation mémorielle : une géopolitique des récits
L’analyse des traductions et adaptations internationales des œuvres de guerre japonaises révèle des dynamiques géopolitiques complexes, documentées par plusieurs cas concrets :
Shigeru Mizuki : un cas d’étude antimilitariste
Comme évoqué dans les précédents épisodes de ce dossier, Shigeru Mizuki (1922-2015), était mangaka japonais ayant perdu son bras gauche pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s’est imposé à travers ses oeuvres comme une figure majeure du manga antimilitariste. Ses œuvres, notamment sa série Showa: A History of Japan, offrent une critique impitoyable du militarisme japonais basée sur son expérience personnelle de soldat. Mizuki « n’a pas glissé dans une vision confortable de ‘victime’ de la guerre » mais a exploré « toute la gamme de l’expérience de guerre japonaise » à travers ses mangas non-fictionnels.
Tensions culturelles historiques entre le Japon et la Corée
Les relations culturelles entre le Japon et la Corée du Sud restent marquées par les tensions historiques liées à la colonisation japonaise (1910-1945). La réception des productions culturelles japonaises en Corée a longtemps été problématique, avec des interdictions officielles jusqu’en 1998. Après cette date, la Corée a levé l’interdiction sur la culture populaire japonaise, mais les tensions persistent.
Les controverses autour du manga Kenkanryu (« Détester la vague coréenne ») illustrent cette complexité : ce manga critique de la popularité de la culture coréenne au Japon témoigne de la persistance des tensions culturelles bilatérales.
Distribution internationale documentée
Au niveau de la diffusion internationale, les œuvres de Mizuki ont été publiées au Japon, en Corée du Sud, en France et en Espagne. L’éditeur canadien Drawn & Quarterly a joué un rôle pionnier dans la publication en anglais des œuvres de Mizuki, notamment sa série historique Showa, qui a remporté l’Eisner Award en 2012 dans la catégorie « Best U.S. Edition of International Material – Asia ».
En France, les éditions Cornélius ont publié plusieurs œuvres de Mizuki, incluant Yokaï en 2017 et À l’intérieur des yôkai en 2018, contribuant à une réception européenne plus axée sur l’aspect culturel et artistique que politique.
Les stratégies étatiques japonaises de diplomatie culturelle
Institutions et programmes documentés
Japan Book Publishers Association (JBPA)
La Japan Book Publishers Association organise des activités de promotion du livre japonais à l’international, notamment via sa participation à la Foire du livre de Francfort. L’association travaille en étroite collaboration avec les bibliothèques et institutions éducatives pour promouvoir la lecture.
The Japan Foundation : un acteur majeur confirmé
La Japan Foundation fournit ainsi un soutien financier aux éditeurs étrangers pour traduire et publier des ouvrages liés au Japon, couvrant une partie des coûts de traduction et de publication. Depuis 1995, la Fondation organise régulièrement des expositions de dessins animés asiatiques et des conférences au Japan Foundation Asia Center de Tokyo.
La Japan Foundation, établie en 1972, est l’unique institution japonaise dédiée aux programmes d’échanges culturels internationaux. Sa bibliothèque numérique propose plus de 1 800 titres gratuits dans diverses catégories incluant le manga.
Programmes culturels spécifiques
La Japan Foundation a organisé des expositions manga spécialisées, comme « Manga Hokusai Manga: Approaching the Master’s Compendium from the Perspective of Contemporary Comics« . Ses programmes incluent l’invitation de lauréats du Japan International Manga Award et l’organisation de festivals de films japonais dans 67 pays/régions.
Recherche académique sur la diplomatie culturelle japonaise
Koichi Iwabuchi : expert reconnu

Dans son ouvrage « Recentering Globalization », Iwabuchi explore comment la culture populaire japonaise (Pokémon, anime, musique pop, dramas télévisés) circule en Asie et constitue un secteur économique important.
Approche méthodologique de la diplomatie culturelle
Dans l’après-guerre, la diplomatie culturelle japonaise était motivée par la nécessité d’adoucir les perceptions anti-japonaises, notamment en Asie du Sud-Est. À la fin des années 1980, la popularité de la culture médiatique japonaise en Asie a commencé à attirer l’attention des décideurs politiques.
Résistances et dissidences mémorielles – Les voix qui dérangent
Le paradigme Sasaki : quand la résistance devient récit
L’histoire de Sasaki Tomoji (佐々木友次, 1923-2016), adaptée dans le manga Fushimi no Tokkōhei (不死身の特攻兵) d’après l’œuvre de l’auteur japonais Kōkami Shōji, bouleverse le narratif traditionnel en révélant l’existence d’un pilote kamikaze qui a survécu à neuf missions. Cette histoire, longtemps occultée, révèle l’existence d’une résistance silencieuse au sein même de l’appareil militaire japonais.
Sasaki ne refuse pas d’obéir frontalement : il sabote subtilement ses missions, invente des pannes moteur, simule des problèmes de navigation, revient systématiquement à la base avec des explications techniques crédibles. Sa stratégie n’est ni héroïque ni spectaculaire, mais pragmatique et méthodique. Il choisit la vie contre la mort programmée, l’intelligence tactique contre l’obéissance aveugle, la ruse contre l’héroïsme mortifère.
Cette figure dérange car elle révèle que l’unanimité patriotique était un mythe soigneusement construit. Elle suggère que d’autres formes de résistance ont existé, moins visibles que la désertion ou la rébellion ouverte, mais tout aussi efficaces à l’échelle individuelle. Le manga transforme cette résistance individuelle en paradigme générationnel : et si les jeunes Japonais d’aujourd’hui avaient quelque chose à apprendre de Sasaki ? »
La transgression des tabous : cartographie de l’indicible
L’analyse des contenus de manga de guerre révèle une cartographie de l’indicible dans la société japonaise contemporaine, qui peut être mise en perspective avec le système d’approbation des manuels scolaires (kyōkasho, 教科書) par le ministère de l’Éducation. Cette cartographie semble évoluer selon différentes temporalités :
Tabous persistants :
- Les crimes de guerre spécifiques : le massacre de Nankin (1937), les expérimentations de l’unité 731, ou le système de l’esclavage sexuel militaire (ianfu, 慰安婦) restent largement absents du manga mainstream (voir entre autres lectures Philippe Pons, Le négationnisme dans les mangasou encore le travail fondamental de Manga et mémoire de la seconde guerre mondiale au japon[/footnote].
- La responsabilité impériale directe : l’empereur Hirohito n’apparaît que rarement comme personnage dans les mangas de guerre.
Un manga rare du Hiro Hito … il faut attendre 2017 !
- Les divisions internes au sein de l’armée et les critiques frontales du système tennō restent des sujets sensibles.
Sujets en évolution :
- L’absurdité de certaines tactiques militaires commence à être questionnée dans certaines œuvres contemporaines.
- La souffrance des soldats ordinaires, popularisée notamment par Mizuki Shigeru, est désormais plus acceptée.
- L’opposition silencieuse au militarisme trouve une expression dans des œuvres comme Fushimi no Tokkōhei.
Nouveaux tabous potentiels :
- La responsabilité des civils dans le soutien à la guerre
- Les parallèles entre militarisme passé et nationalisme contemporain
- La critique de l’alliance américano-japonaise
- La question des réparations de guerre
Cette évolution suggère que le manga contribue à faire évoluer les représentations sociales de la guerre, chaque transgression narrative préparant potentiellement une évolution des mentalités.
Générations et transmission : la guerre des mémoires
Si l’on s’intéresse aux réceptions exploitables sur les forums nippons, l’observation de la réception des mangas historiques au Japon semble révéler des différences générationnelles dans l’approche de ces œuvres. Pour simplifier voici un tableau synthétique :
- Les générations qui ont vécu la guerre ou l’immédiat après-guerre tendent à privilégier l’authenticité testimoniale, particulièrement dans les œuvres comme celles de Mizuki Shigeru qui s’appuient sur l’expérience vécue.
- Les générations de la croissance économique utilisent souvent ces mangas comme médiation avec un passé familial parfois tu par leurs parents, cherchant à comprendre l’expérience de leurs aînés (ce qui est au cœur de Eien no Zero).
- Les générations plus récentes abordent ces œuvres avec moins de charge émotionnelle directe, développant une approche plus distanciée qui peut privilégier les aspects artistiques et narratifs.
- Les jeunes générations découvrent parfois l’histoire de la Seconde Guerre mondiale principalement à travers ces médias populaires, révélant un transfert des vecteurs de transmission historique traditionnels.
Cette évolution générationnelle dans la réception explique en partie pourquoi certaines œuvres comme Eien no Zero de Naoki Hyakuta rencontrent un succès large : elles tentent une synthèse entre authenticité historique et accessibilité narrative.
La mémoire officielle face à la mémoire populaire : un rapport de force
L’École et le manga : tensions pédagogiques
L’introduction progressive du manga dans l’enseignement japonais révèle les tensions permanentes entre mémoire officielle et mémoire populaire. Le ministère de l’Éducation (Monbukagakushō, 文部科学省) maintient depuis 1947 un contrôle strict sur les contenus pédagogiques via le système d’approbation des manuels (kyōkasho kentei seido, 教科書検定制度). L’irruption du manga comme support éducatif bouleverse cette logique de contrôle.
Le cas emblématique d’Hadashi no Gen (はだしのゲン, Gen d’Hiroshima) de Nakazawa Keiji illustre cette complexité. Cette œuvre, publiée entre 1973 et 1985, présente une critique féroce de la guerre et de ses conséquences sur la population civile japonaise. Témoignage autobiographique du bombardement d’Hiroshima, le manga dépeint sans concession la souffrance des victimes tout en questionnant les responsabilités du gouvernement japonais dans le conflit.
L’œuvre a fait l’objet de débats récurrents dans le système éducatif japonais, révélant les tensions entre différentes conceptions de l’histoire et de la mémoire. D’un côté, certains y voient un témoignage essentiel sur les horreurs de la guerre et un plaidoyer pour la paix. De l’autre, des voix s’élèvent pour dénoncer une vision trop critique du Japon impérial susceptible de « décourager la fierté nationale ».
Les résistances institutionnelles
L’émergence du manga historique comme vecteur éducatif suscite des résistances au sein des institutions japonaises. Ces résistances s’articulent autour d’une préoccupation centrale : l’influence de ces œuvres sur la formation de l’identité nationale des jeunes générations.
Sanae Takaichi, figure conservatrice du Parti libéral-démocrate et députée de la préfecture de Nara depuis 1993, incarne cette position critique. Connue pour ses positions nationalistes, elle s’est régulièrement opposée aux contenus culturels jugés trop critiques envers l’histoire japonaise.
Le débat dépasse la simple question pédagogique pour toucher aux fondements de l’identité nationale contemporaine. Les détracteurs du manga historique dénoncent ce qu’ils perçoivent comme un « masochisme historique » (masokizumu, マゾキズム), terme forgé par certains intellectuels conservateurs pour critiquer l’autocritique japonaise sur la période de guerre.
Ces résistances institutionnelles révèlent que le manga dérange. Non par son contenu explicite, mais par sa capacité à rendre l’histoire sensible, émotionnelle, questionnable. En humanisant les soldats, en montrant l’absurdité des tactiques, en révélant les résistances individuelles, le manga fait de l’histoire une expérience vécue plutôt qu’un récit officiel. Cette dimension expérientielle constitue sa force subversive.
Politiques, mémoire officielle et mémoire populaire
La tension entre mémoire officielle et mémoire populaire au Japon trouve dans le manga un terrain d’expression particulièrement révélateur. Ces œuvres, par leur accessibilité et leur pouvoir émotionnel, remettent en question les récits convenus et ouvrent des espaces de débat sur l’histoire nationale. Face à cette influence grandissante, les institutions éducatives et politiques tentent de maintenir un contrôle sur les contenus, révélant ainsi les enjeux profonds de la construction mémorielle contemporaine.
Le manga historique, par sa capacité à transformer l’histoire en expérience personnelle, constitue un défi permanent pour toute tentative d’imposer une version unique du passé. Cette dynamique continue d’alimenter les débats sur l’enseignement de l’histoire au Japon et sur le rôle des médias populaires dans la formation de la conscience historique collective.
Implications géopolitiques : le manga comme acteur international
L’effet « Rashomon » : multiplicité des réceptions
L’analyse de la réception internationale de notre corpus révèle un effet « Rashomon » d’une complexité géopolitique redoutable : chaque pays lit les mêmes œuvres avec ses propres filtres culturels et politiques, produisant des interprétations contradictoires.
L’expression effet « Rashomon » fait ici référence au célèbre film d’Akira Kurosawa de 1950, Rashomon, qui illustre comment un même événement peut être perçu et raconté de manières complètement différentes selon la perspective de chaque témoin.
Le principe de base : dans le film de Kurosawa, un crime est raconté par quatre témoins différents – chacun donnant une version totalement contradictoire des faits. Aucune version n’est présentée comme « la vérité », montrant que la réalité peut être subjective et multiple.
Appliquons ceci à la réception des mangas historiques
Exemples concrets possibles :
Un manga sur la Seconde Guerre mondiale sera lu :
- Au Japon : comme un témoignage sur les souffrances du peuple japonais
- En Corée du Sud : comme une possible minimisation des crimes japonais en Asie
- Aux États-Unis : à travers le prisme de Pearl Harbor et de la guerre du Pacifique
- En France : avec une perspective européenne sur la guerre
Pourquoi cet « effet » se produit-il ?
- Filtres historiques : chaque pays a sa propre mémoire de la guerre
- Contexte politique : les relations diplomatiques actuelles influencent la lecture
- Références culturelles : les codes narratifs varient selon les cultures
- Enjeux mémoriels : ce qui est sensible diffère d’un pays à l’autre
Ainsi une même œuvre pourra créer des tensions diplomatiques, alimenter des polémiques internationales, révéler des non-dits historiques ou encore mettre en lumière des rapports de force géopolitiques. L’effet « Rashomon » montre donc qu’il n’existe pas une seule bonne lecture d’une œuvre culturelle, mais autant d’interprétations qu’il y a de contextes culturels et politiques pour la recevoir.
Eien no Zero : un cas d’étude de l’effet Rashomon
Eien no Zero (永遠の0, « L’Éternel Zéro ») illustre parfaitement ce phénomène de réception différentielle selon les contextes géopolitiques.
L’œuvre et son succès initial
Adapté du roman à succès de Naoki Hyakuta (2006), le film réalisé par Takashi Yamazaki en 2013 raconte l’histoire d’un jeune homme découvrant que son grand-père était un pilote kamikaze pendant la Seconde Guerre mondiale. L’œuvre connaît un succès commercial retentissant au Japon, rapportant 8,76 milliards de yens et devenant le film japonais le plus rentable de 2014.
Les réceptions contrastées
Au Japon : réconciliation générationnelle
L’œuvre rencontre un écho particulier auprès du public japonais, qui y trouve un récit de réconciliation avec l’histoire familiale. Le film permet à la troisième génération d’après-guerre de se réapproprier l’héritage des grands-pères à travers une narration qui humanise les pilotes kamikazes. Cette approche séduit un public en quête de sens sur cette période traumatique de l’histoire nationale.
En Asie orientale : tensions mémorielles
Dans les pays voisins du Japon, particulièrement en Corée du Sud et en Chine, l’œuvre suscite des réactions bien différentes. Ces nations, qui ont subi l’occupation japonaise, perçoivent dans le film une tentative de réhabilitation du militarisme japonais. Les sensibilités historiques encore vives dans ces régions rendent problématique toute représentation sympathique des forces armées japonaises de cette époque.
En Occident : distance culturelle
La réception occidentale tend à être plus distanciée, l’œuvre étant souvent appréhendée comme une curiosité anthropologique offrant un regard sur la mentalité japonaise. Cette distance géographique et historique permet une approche moins passionnelle, mais peut également conduire à une dépolitisation de l’œuvre.
Un révélateur des enjeux mémoriels contemporains
Ce cas illustre comment une même œuvre culturelle peut cristalliser des tensions géopolitiques durables. Eien no Zero révèle que les questions mémorielles liées à la Seconde Guerre mondiale demeurent des sujets sensibles en Asie orientale, où les héritages du conflit continuent d’influencer les relations diplomatiques et les perceptions mutuelles.
L’effet Rashomon joue ici pleinement : chaque public national lit l’œuvre à travers ses propres traumatismes historiques, ses relations actuelles avec le Japon, et ses enjeux politiques internes. Cette multiplicité des lectures révèle l’impossibilité d’une réception culturelle neutre dès lors que l’histoire et la mémoire sont en jeu.
Cette multiplicité des réceptions transforme le manga en prisme géopolitique : chaque pays y projette ses propres anxiétés historiques, révélant autant sur le récepteur que sur l’émetteur.
La diplomatie culturelle à l’épreuve du manga
Le manga pose un défi conceptuel majeur à la diplomatie culturelle japonaise : comment promouvoir une culture populaire qui interroge parfois de manière critique l’histoire nationale ? Cette tension traverse les réflexions des institutions culturelles japonaises depuis l’émergence du manga comme vecteur de soft power.
Un dilemme stratégique complexe
Le ministère des Affaires étrangères japonais, à travers son département de diplomatie publique, fait face à une contradiction fondamentale. D’un côté, le manga représente l’un des produits culturels japonais les plus exportables et appréciés mondialement. De l’autre, certaines œuvres du genre traitent de sujets historiques sensibles susceptibles de créer des tensions diplomatiques, particulièrement avec les pays voisins d’Asie orientale.
Les approches possibles
Face à ce dilemme, plusieurs stratégies théoriques s’offrent à la réflexion :
L’universalisation
Cette approche consisterait à présenter le manga historique comme une réflexion universelle sur la condition humaine en temps de guerre, en gommant sa spécificité historique japonaise. L’avantage serait de réduire les risques de polémiques géopolitiques. L’inconvénient majeur résiderait dans l’appauvrissement du message original et la perte d’authenticité culturelle.
La contextualisation
Une seconde voie impliquerait d’accompagner systématiquement la diffusion internationale de ces œuvres d’un appareil critique expliquant leur contexte historique et culturel. Cette stratégie permettrait de maintenir la richesse du contenu tout en aidant les publics étrangers à en saisir les nuances. Le risque serait une intellectualisation excessive qui pourrait rebuter le grand public.
L’assomption
Une troisième approche consisterait à assumer pleinement la dimension politique et critique de ces œuvres, en revendiquant la liberté créatrice comme valeur démocratique fondamentale. Cette stratégie aurait l’avantage de l’authenticité mais présenterait le risque de tensions diplomatiques accrues.
Les enjeux du soft power
Cette problématique révèle une question plus large sur la nature du soft power culturel. L’efficacité d’une diplomatie culturelle repose-t-elle sur la présentation d’une image lissée et consensuelle, ou au contraire sur l’expression authentique d’une société, y compris dans ses questionnements et ses autocritiques ?
Le cas du manga historique japonais illustre parfaitement cette tension. Ces œuvres, par leur capacité à interroger le passé national, témoignent d’une société démocratique capable de réflexion critique. Paradoxalement, cette dimension critique, qui constitue une force dans une perspective de soft power « authentique », peut devenir un obstacle dans les relations diplomatiques immédiates.
Une stratégie en construction
Le gouvernement japonais semble encore chercher l’équilibre optimal entre ces différentes approches. Cette hésitation stratégique, loin d’être une faiblesse, pourrait révéler une approche pragmatique adaptée à la complexité du contexte géopolitique régional.
L’évolution de cette stratégie culturelle constituera un indicateur intéressant de la manière dont le Japon conçoit son rôle culturel international et gère l’héritage complexe de son histoire du XXe siècle.
Vers une géopolitique de la mémoire dessinée
L’émergence d’un nouvel acteur diplomatique ?
L’analyse de notre corpus révèle une mutation géopolitique majeure : le manga japonais de guerre s’impose comme un acteur diplomatique non-étatique d’une puissance certaine. Cette transformation dépasse largement le cadre culturel pour investir le champ des relations internationales contemporaines.
Trois phénomènes convergents documentent cette émergence :
- La diplomatisation du culturel
Les incidents diplomatiques liés aux mangas démontrent que ce support n’est plus un simple produit de divertissement mais un enjeu de souveraineté narrative. Chaque planche devient potentiellement un casus belli mémoriel.
- La culturalisation du politique
Les stratégies gouvernementales révèlent une instrumentalisation croissante de la production manga. Le Cool Japan Fund ne finance plus seulement la créativité : il forge l’influence. Les milliards de yens investis transforment les mangakas en ambassadeurs involontaires d’une certaine vision de l’histoire japonaise.
- La politisation du lecteur
Ces œuvres peuvent influencer la vision des relations internationales du Japon. Le manga devient dans cette perspective un vecteur de socialisation géopolitique pour des millions de citoyens.
Les limites du contrôle narratif
Cette puissance nouvelle révèle paradoxalement l’impuissance des États face à la circulation mondiale des récits. Cette perte de contrôle génère trois défis stratégiques majeurs :
- Le défi de la cohérence : comment l’État japonais peut-il simultanément promouvoir le manga comme soft power et nier sa dimension politique ? Cette contradiction mine la crédibilité de la diplomatie culturelle nippone.
- Le défi de la prévisibilité : l’imprévisibilité des réceptions internationales transforme chaque publication en risque diplomatique potentiel. Il peut s’agir d’anticiper les polémiques, mais ceci équivaudrait à une bureaucratisation croissante de la création.
- Le défi de l’authenticité : l’instrumentalisation politique du manga risque de dénaturer sa force créatrice. Les témoignages d’éditeurs pointent une autocensure croissante, les auteurs adaptant leurs récits aux impératifs diplomatiques plutôt qu’à leur vision artistique.
Mais au fait, ce contrôle est-il seulement réellement possible ?
L’archipel invisible : cartographie des silences géopolitiques du manga de guerre
Le paradoxe de l’absence : quand le non-événement devient révélateur
Derrière les œuvres circulant à l’international comme celles de Shigeru Mizuki ou les adaptations autour de Eien no Zero, le corpus étudié permet d’explorer une autre piste de réflexion. Nos trois enquêtes successives – sur 343 Sword Squad de Souichi Sumoto, L’île des téméraires de Syuho Sato, et l’insaisissable Pilote sacrifié – révèlent un phénomène géopolitique d’une importance qui ne peut être passée sous silence : l’existence potentielle d’un archipel invisible de la production manga de guerre. Ces œuvres, pourtant ancrées dans les thématiques les plus sensibles de l’histoire japonaise, demeurent hermétiquement closes dans leurs bulles linguistiques et culturelles nationales.
Cette cartographie de l’absence interroge fondamentalement les mécanismes de la diplomatie culturelle japonaise. Comment expliquer que des œuvres traitant des sujets les plus polémiques – les kamikazes, les torpilles-suicide Kaiten, la résistance silencieuse au militarisme – n’aient généré aucune controverse internationale ? Cette invisibilité géopolitique constitue-t-elle un échec stratégique du Cool Japan, ou révèle-t-elle au contraire une forme sophistiquée de gestion des risques mémoriels ?
La stratification invisible du soft power manga
L’analyse comparative de nos trois cas d’étude avec les exemples polémiques évoqués dans l’étude principale (Eien no Zero, les œuvres de Mizuki Shigeru) dessine une architecture géopolitique à deux niveaux :
Niveau 1 : les œuvres-scandales ou œuvres-témoins
Celles qui peuvent déclencher des incidents diplomatiques, alimenter les débats internationaux et transformer leurs auteurs en ambassadeurs involontaires. Ces œuvres franchissent les barrières linguistiques par la controverse même qu’elles suscitent. Dans le cadre de témoignages, traduites et reconnues internationalement pour leur valeur artistique ou testimoniale, elles participent du soft power que l’on pourrait qualifier d’acceptable.
Exemples : Hadashi no Gen (Barefoot Gen) de Keiji Nakazawa, les œuvres de Shigeru Mizuki ou encore Eien no Zero.
Niveau 2 : les œuvres-fantômes
C’est ici que se situent nos trois autres exemples. Des œuvres qui, malgré leur potentiel polémique, demeurent confinées dans l’espace culturel japonais ou dans des niches de traduction ultra-limitées. Cette invisibilité pose question.
L’hypothèse du « containment culturel »
Une première piste pourrait renvoyer à l’existence d’une stratégie japonaise de containment culturel : certaines œuvres sensibles seraient délibérément maintenues dans un état de circulation restreinte pour éviter les incidents diplomatiques. Cette stratégie pourrait s’articuler autour de trois leviers :
Le filtre éditorial international
Les éditeurs étrangers, conscients des enjeux géopolitiques, pratiquent une forme d’auto-censure en évitant de traduire des œuvres jugées trop sensibles. 343 Sword Squad, malgré sa publication française récente, illustre cette logique : aucun éditeur anglo-saxon n’a pour l’heure pris le risque de sa traduction sauf erreur de ma part. Et pourtant ceci interroge ; l’histoire, réelle, de cette unité, a fait l’objet d’un livre particulièrement documenté, « Genda’s Blade : Japan’s Squadron of Aces – 343 Kokutai« écrit par Henry Sakaida et Koji Takaki, publié chez Classic (Hersham, Surrey) en 2003. C’est une mine, non traduite à ce jour en français, illustrant l’intérêt porté outre Pacifique pour cette histoire. La traduction en anglais du manga de Souichi Sumoto dans les années à venir serait donc logique, il y a un publique.
Le contrôle par la non-promotion
L’absence de campagnes de promotion internationale pour ces œuvres suggère une volonté délibérée de limiter leur diffusion. Contrairement aux productions mainstream du Cool Japan (anime, mangas grand public), ces œuvres ne bénéficient d’aucun soutien institutionnel pour leur exportation.
La barrière linguistique stratégique
L’absence systématique de traductions anglaises – langue véhiculaire des débats géopolitiques internationaux – constitue un verrou efficace contre la viralisation polémique.
L’énigme Fushimi : quand l’absence devient symptôme
Le cas de Fushimi no Tokkōhei mérite une attention particulière. Cette œuvre, mentionnée dans votre document source comme révélatrice de l’existence d’une résistance silencieuse au sein même de l’appareil militaire japonais, semble avoir été effacée de l’espace informationnel international.
Cette disparition totale des radars médiatiques internationaux ne peut être fortuite. Elle suggère soit :
- Une stratégie délibérée de non-diffusion pour éviter les polémiques
- Une forme d’auto-censure de l’industrie éditoriale internationale
- L’existence de pressions diplomatiques officieuses
Si cette dimension se vérifiait, elle pourrait déboucher sur des pistes de recherche complémentaire :
- La théorie du « soft power négatif »
L’efficacité diplomatique résiderait non dans ce qu’on diffuse, mais dans ce qu’on choisit de ne pas diffuser. Le silence comme arme géopolitique.
- L’étude des « non-événements culturels »
L’analyse systématique des œuvres qui « auraient dû » faire polémique mais ne l’ont pas fait révélerait les mécanismes cachés de la diplomatie culturelle.
- La cartographie des filtres éditoriaux internationaux
L’identification des critères implicites qui président aux choix de traduction pourrait révéler l’architecture invisible du contrôle géopolitique de la culture.
Un continent noir du manga géopolitique ?
En explorant cette piste, l’existence de cet archipel invisible, une dimension méconnue de la diplomatie culturelle japonaise pourrait être approfondie : la gestion stratégique de l’invisibilité. Dans cette perspective le véritable soft power ne résiderait pas seulement dans la capacité à faire rayonner sa culture, mais dans la maîtrise sophistiquée de ce qu’on choisit de rendre visible ou invisible sur la scène internationale.
Derrière la vitrine chatoyante des productions grand public se cacherait ainsi un mécanisme subtil de gestion des risques mémoriels. Ainsi le Japon ne se contenterait pas de promouvoir sa culture : il orchestrerait savamment ses silences. Oui mais la réalité est nettement plus complexe.
L’underground géopolitique
Quelques recherches suffisent pour prendre la mesure d’un écosystème parallèle de circulation culturelle qui échappe totalement aux mécanismes de contrôle étatique et éditorial supposé. Les données que j’ai pu extraire confirment l’existence de cette circulation souterraine :
MangaDex, Bilibili Comics (plateforme chinoise) proposent de nombreuses œuvres échappant à toute forme de contrôle direct venant du Japon. Ainsi sur MangaDex trouve-ton par exemple 343 Sword Squad sous le titre de Shinden Kai 343, titre faisant directement référence au Shiden, l’avion exploité par cette escadrille d’élite dont il est question dans le manga.
Quant à Bilibili Comics, si la majorité des œuvres proposées relève des manhua, les mangas chinois, certaines œuvres nippones relatives à la seconde guerre sont présentes, comme par exemple The Cockpit de l’immense Leiji Matsumoto.
Cliquez sur l’image pour rejoindre
Il n’est donc pas possible de concevoir un « containment culturel » orchestré par l’État japonais car en réalité existe une diplomatie culturelle sauvage.
Ces œuvres circulent bel et bien à l’international, mais par des canaux complètement déconnectés des circuits officiels. Cette circulation parallèle révèle :
1. L’impuissance du contrôle étatique
L’État japonais ne peut plus contrôler la diffusion de ses productions culturelles sensibles. Les communautés de fans créent leurs propres réseaux de traduction et de diffusion.
2. L’émergence d’une géopolitique « peer-to-peer »
Les enjeux mémoriels se négocient désormais dans des espaces numériques transnationaux, échappant aux canaux diplomatiques traditionnels.
3. La fragmentation des publics
Ces œuvres touchent des communautés de niche hyper-spécialisées, créant des micro-polémiques invisibles aux radar médiatiques mainstream.
Un exemple dans notre corpus ? Fujimi no Tokkouhei, en français « Pilote Sacrifié » que l’on peut trouver traduit en … russe, même de nombreux commentaires se lamentent sur les forum de ne pas pouvoir disposer de traductions en espagnol ou anglais.
Il existe donc un soft power clandestin qui opère dans les marges du système officiel. Cette approche est essentielle car elle montre que la véritable bataille géopolitique des récits ne se joue plus uniquement dans les salons feutrés des ambassades, mais dans les forums de fans et les plateformes de scanlation.
Cette circulation souterraine pose des questions géopolitiques majeures : que se passe-t-il quand des œuvres potentiellement explosives circulent dans des communautés internationales de passionnés, hors de tout contrôle diplomatique ?
***
Le manga japonais de guerre, par sa capacité à transformer des lecteurs en acteurs géopolitiques, révèle que la culture n’est plus le supplément d’âme des relations internationales mais leur nouveau terrain d’affrontement. Dans cette bataille des imaginaires, l’enjeu n’est plus seulement de contrôler les territoires mais de façonner les représentations. Et dans cette guerre des récits, celui qui dessine l’histoire détient assurément de puissants leviers mémoriels.
…. to be continued avec l’épisode 4 – L’approche anthropologique : ritualiser la mort, sacraliser la mémoire
Image de présentation générée par IA