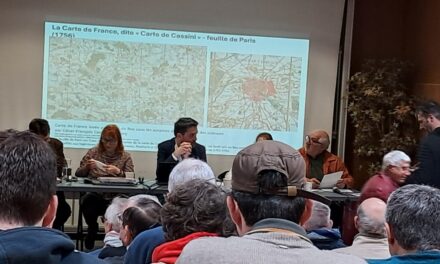Table ronde, carte blanche proposée par le RUCHE, l’AHPNE et le Comité d’Histoire de l’Environnement et du Développement Durable
Anna TRESPEUCH BERTHELOT, maîtresse de conférences à l’Université Caen Normandie, introduit cette table ronde qui est associée à la récente publication de La nature en révolution – Une histoire environnementale de la France en 3 tomes, deux déjà publiésLa nature en révolution – Une histoire environnementale de la France, 1780-1870 (vol.1), Jean-Baptiste Fressoz, François Jarrige, Thomas Le Roux, Corinne Marache, Julien Vincent, La Découverte, 2025 – Les natures de la République – Une histoire environnementale de la France, 1870-1940 (vol. 2), Pierre Cornu, Stéphane Frioux, Anaël Marrec, Charles-François Mathis, Antonin Plarier, La Découverte, 2025 et le troisième à venir.
Elle présente ensuite les structures qui réunissent les chercheurs qui s’intéressent à l’histoire environnementale le RUCHE, l’AHPNE et le Comité d’Histoire de l’Environnement et du Développement Durable et les intervenants.
L’approche environnementale de l’histoire remet en cause une approche purement économique. La question écologiste était déjà présente sous la Révolution française.
Comment l’histoire environnementale réoriente le récit de l’histoire de France
Pour Emilie-Anne PEPY, maîtresse de conférences à l’Université Savoie-Mont Blanc, l’histoire environnementale embrasse le vivant non-humain, ce qui pose la question de la chronologie. Les découpages classiques ne correspondent plus. Elle montre la relation entre les ressources et les acteurs par rapport à la forêt « Les forêts de la Grande Chartreuse : l’exploitation d’une ressource industrielle, XVIIe – XVIIIe siècle », in Andrée Corvol et al., ed., Forêt et montagne. Evolution et aménagement, Paris, L’Harmattan, 2015, dans un micro territoire. À l’époque moderne, l’État impose une politique contre les acteurs locaux et l’utilisation traditionnelle. Dès le XVIIe siècle, on perçoit une angoisse environnementale à propos du déboisement.
François JARRIGE, maître de conférences à l’Université de Bourgogne, propose une définition de l’histoire environnementale ; elle n’est pas une histoire du milieu. Il s’agit de relire des objets classiques à partir du regard environnemental, mettre au centre les interactions mutuelles nature/culture. Le moment de bascule chronologique se situe entre la Révolution et 1870. La question écologique apparaît sous la Révolution : forêt, énergie avec une utilisation militaire accrue. On voit naître un discours sur la nature. La prise de conscience des limites d’exploitation de la nature est ancienne, pas une nouveauté des années 1960.
Charles-François MATHIS, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, précise que les deux volumes de Une histoire environnementale de la France sont un point d’étape de 25 ans de recherches. Le découpage chronologique a fait l’objet de nombreux débats entre les auteurs.
Si on pose la question : comment la Troisième République s’est emparée de la question énergétique, on va étudier quels choix et quels discours sur ces choix. La France a peu d’énergie fossile dans la course à la puissance, la réflexion porte sur le développement d’autres sources d’énergie, d’où le développement de l’hydroélectricité. La réflexion sur les pollutions n’est pas absente. On peut étudier les conséquences sur l’environnement, sur la santé des ouvriers en complément d’une approche par les flux.
Gabrielle BOULEAU, socio-politiste à l’INRAE, travaille sur le regard porté aujourd’hui sur les 30 Glorieuses et leurs effets sur l’environnement. Elle évoque le renoncement au projet de transformation sociale. Dans le tome 3 d’Une histoire environnementale de la France, il sera question de diplomatie climatique.
Peut-on parler d’une singularité française ?
La question porte à la fois sur le contexte colonial et sur celui de la mondialisation.
E P : L’ouverture au monde est réelle dès les temps modernes. La circulation des hommes et des matières s’accélère. Le XVIIIe siècle marque un basculement avec les colonies quand en 1763 le choix de la canne à sucre est fait aux dépens de l’Ouest.
F J : Une singularité liée aux formes politiques. L’empire colonial s’accompagne après 1870 d’un accroissement des flux de matières, mais l’interrogation sur l’épuisement des sols coloniaux existe déjà.
Le caractère paysan de la société française et la petite propriété font que l’exode rural fut tardif. L’apogée démographique des campagnes, c’est le Second Empire.
On constate aussi un développement tardif des parcs naturels, par rapport aux autres pays.
Les choix énergétiques, pour éviter l’emploi du charbon, sont différents de ceux de l’Angleterre.
C-F M : Il part des représentations, de l’imaginaire. Il rappelle le poids du monde paysan sous la Troisième République, la tension identitaire et en même temps la nécessité de répondre aux enjeux de la concurrence internationale (expositions universelles à Paris).
La politique paysagère de la France répond au sentiment des petits pays, glorifiés par le Tour de France par deux enfants qui invite à la découverte de la terre de France, ses ressources et ses paysages. Le pays est aménagé pour permettre le développement du tourisme, donner accès aux beautés du paysage.
G B : Aujourd’hui, domine le discours sur l’indépendance énergétique, malgré la réalité : la croissance du PIB est // aux importations de charbonEncore 3 millions de tonnes importées en 1973 et de pétrole. Le développement du nucléaire repose sur l’importation de l’uranium.
Le laboratoire de l’historien
Quelles sources, quelles archives ? La littérature grise produite par les ingénieurs, les documents iconographiques…
E P : Il suffit de piocher dans les archives avec un regard, un questionnement nouveau.
Par exemple, pour aborder la nature en ville, on a les archives des pépinières royales. Comment apparaît, dans les sources, la notion de nuisible.
L’imaginaire environnemental est marqué par le tourisme aristocratique, avec le développement des gravures, une étude au croisement de l’histoire culturelleParcours thématique : Histoire du tourisme dans les Alpes, Anne-Marie Granet-Abisset – D’une image à l’autre ? Perceptions et représentations de la montagne. Nicolas Rocher, IA IPR d’histoire-géographie de l’Académie de Clermont-Ferrand, Parcours INA. Il y a peu d’espaces non anthropisés, déjà à l’époque médiévale.
F J : Il n’y a pas de sources spécifiques pour une histoire environnementale; Jérémie Foa débute une histoire environnementale dans l’histoire des guerres de religion.
Mais il y a des archives de l’écologie politique à investiguer. Un projet vise à collecter ces archives : archives d’associations, sources privées pour lutter contre l’invisibilisation de l’action environnementale.
Il y a aussi les sources techniques écrites par des agronomes, des naturalistes
Exemple de la disparition des escargots à la fin du XIXe siècle étudiée par Marie Chaidron, « La disparition de la mye des sables (Mya arenaria) dans la région du Bas-Escaut : une enquête malacologique à la fin du XIXe siècle » in Colloque Mollusques, histoire et sciences sociales Exploitation, domestication, extinction, avril 2025, Université de Bourgogne…
Les séries administratives : forêts, eau, justice (conflits entre l’administration et les communautés paysannes), archives communales (règlement d’affouage), enquêtes avant installation d’une installation industrielle. Le décret de 1810 ,relatif aux Manufactures et Ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommodent, permet en fait de réguler les installations, de protéger le développement économique contre les recours des opposants.
C-F M : Il est important de récolter les sources associatives, des archives souvent méconnues, parfois menacées.
La pluridisciplinarité permet la reconstitution des environnements passés, des paysages. Le végétal peut être une source (exemple étude de l’évolution génétique des roses). Un travail est en cours sur les herbiers qui nous renseignent sur le rapport au monde naturel.
C G : Le terrain, les témoins peuvent être une source pour aborder les pratiques populaires face aux textes émis par les classes supérieures (ex à Fos-sur-mer à propos des luttes contre la pollution).
Une histoire écrite à la lumière du présent
A T-B demande aux intervenants de choisir un événement néfaste pour l’environnement
E P : Pas vraiment un événement, mais une juxtaposition de faits ayant des racines plus ou moins anciennes. La « marchandisation » de la nature s’impose avec la Renaissance et les élites urbaines méditerranéennes, temps des consommations secondaires.
Les fluctuations du Petit âge glaciaire avec des phases de surplus qui favorisent la marchandisation. Le modèle de plantation extractive se met en place, aux Antilles, au XVIIe siècle.
F J : Les émissions de CO2 du XIXe sicle correspondent aux émissions actuelles de 2 ou 3 ans. Il est intéressant d’articuler temps court/temps long.
L’anthropocène débute avec le brevet d’usage de la machine à vapeur en 1784, mais ça ne correspond à rien en France. Il est difficile de définir une date pour le début de l’anthropocène.
C-F M : Une série d’inflexions, exemple : le procédé Haber-Bosch d’industrialisation de l’ammoniac qui permet à la fois la fabrication d’explosifs et d’engrais, modifie sans doute la cycle de l’azoteVoir : Le cultivateur et l’engrais – Une histoire de la chimisation de l’agriculture, Laurent Herment, Presses Universitaires François Rabelais, 2024 ?
G B : Après la guerre, le mouvement d’accélération perdure. Exemple, à FeyzinFeyzin (1959-1971) : Composer avec les débordements de l’industrie dans le sud lyonnais par Gwenola Le Naour, in Débordements industriels – Environnement, territoire et conflit (XVIIIe-XXIe siècle) Sous la direction de Michel Letté et Thomas Le Roux, PUR, 2019 : 1964, des oppositions locales et plus lointaines, 1970, incendie et d’importants dégâts, pourtant on ne remet pas en cause la dépendance au pétrole au nom de l’indemnisation, de la notion de compensation.
Une table ronde riche qui donne envie de se plonger dans La nature en révolution – Une histoire environnementale de la France.