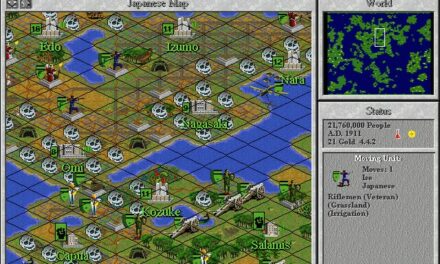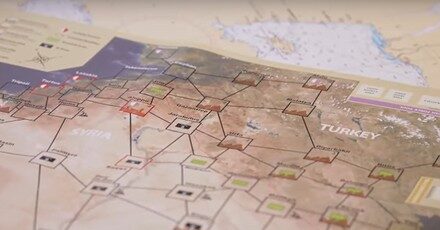36 heures. C’est le temps qu’il a fallu aux forces ukrainiennes pour reprendre l’aéroport d’Hostomel en février 2022. Si les Russes avaient tenu 24 heures de plus, raconteriez-vous aujourd’hui la même guerre ? Michael Kofman, senior fellow à la Carnegie Endowment et l’un des principaux analystes occidentaux du conflit russo-ukrainien, formule la question autrement : « Si nous rejouons cette guerre 100 fois, combien de fois l’Ukraine s’en sort-elle aussi bien ? »
Cette interrogation révèle un problème philosophique central qui traverse son travail de terrain obstiné — tous les 3 à 4 mois en Ukraine depuis février 2022 : l’impossibilité fondamentale de la prescience militaire. Dans une magnifique interview de 90 minutes réalisée par Alexandre Jubelin dans le cadre de son excellent podcast Le Collimateur, Michael Kofman documente une rupture épistémologique radicale. La guerre ne ressemble plus aux manuels. Les « tranchées » dont parlaient les médias en 2022 ? « Il n’y a personne dans les tranchées », tranche-t-il. Les « lignes de front » ? « La cartographie devient métaphysique. »
Retrouvez toutes les émissions en ligne en cliquant sur l’image
Or, cette angoisse de l’imprévisibilité fondamentale structure aussi certaines œuvres de pop culture, notamment japonaises. Dans le roman Legend of the Galactic Heroes de Yoshiki Tanaka (1982, adapté par la suite en manga et anime), le stratège Yang Wenli répète : « Il n’existe pas de stratégie invincible. Si elle existait, l’histoire de l’humanité se serait arrêtée depuis longtemps. » Makoto Yukimura, à travers son manga Vinland Saga (2005-présent), montre comment le guerrier Thorfinn découvre que maîtriser le combat ne sert à rien sans maîtriser la construction, la logistique, la coopération.
Pourquoi associer une analyse de la guerre en Ukraine et deux œuvres de pop culture ?
Cet article ne prétend pas que ces œuvres « prédisent » la guerre en Ukraine. Il suggère plutôt qu’elles révèlent comment, dans d’autres traditions culturelles — notamment le Japon post-Hiroshima — les mêmes questions ontologiques sur la guerre (contingence, incertitude, impossibilité de la prescience) ont été théorisées avec profondeur. C’est un appel à élargir nos sources : la pensée stratégique ne se limite pas aux think tanks occidentaux. Des créateurs de fiction, libérés des contraintes institutionnelles, ont parfois exploré l’impensé avec plus de radicalité que les doctrines officielles.
Le cœur de cet article reste l’analyse brillante de Michael Kofman — ses observations, sa méthodologie, ses conclusions sur la guerre en Ukraine. La pop culture intervient comme caisse de résonance culturelle, révélant que ces questions traversent les époques et les continents.
Mais cet article est aussi un plaidoyer pour la sortie de silo
L’émission d’Alexandre Jubelin avec Kofman, entièrement en anglais, a suscité quelques retours négatifs de la part d’habitués de Le Collimateur, parfois troublés par le non-emploi du français. Cette réticence linguistique est symptomatique d’un problème plus large : notre tendance à nous enfermer dans des zones de confort intellectuelles. Si nous refusons l’anglais — alors même que des outils de traduction performants existent aujourd’hui — comment accepterons-nous d’aller chercher des insights dans la pop culture japonaise ? Si nous ignorons War on the Rocks, qu’Alexandre Jubelin cite régulièrement comme référence incontournable, sous prétexte que c’est anglophone, combien d’analyses de qualité manquons-nous ?
Je suis un partisan absolu de cette sortie de silo
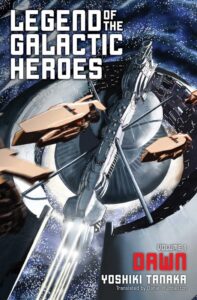
Cet article assume donc une double ambition : explorer les analyses de Kofman ET défendre l’idée que nos sources doivent s’élargir — géographiquement, linguistiquement, culturellement. La barrière de la langue n’est plus une excuse valable à l’ère des sous-titres automatiques et des outils de traduction — étant entendu qu’il reste préférable de maîtriser la langue pour ne pas dépendre d’un outil, aussi puissant soit-il. La méfiance envers la pop culture comme source de réflexion stratégique relève souvent d’un préjugé académique non interrogé.
Sinon, nous continuerons à redécouvrir des vérités que d’autres ont déjà théorisées ailleurs, enfermés dans nos silos confortables, pendant que le monde pense la guerre autrement, dans d’autres langues, à travers d’autres médiums. C’est aussi, et je dirais même surtout, de ceci dont il s’agit ici : élargir des horizons de recherche pour nourrir une réflexion plus riche, plus complète, plus honnête sur ce que la guerre révèle de nous-mêmes.
La contingence radicale : quand l’histoire bascule sur 36 heures
Hostomel : l’anatomie d’un point de bifurcation
Dans les premières heures du 24 février 2022, des hélicoptères d’assaut russes Mi-8 atterrissent à l’aéroport d’Hostomel, à dix kilomètres au nord-ouest de Kiev. L’objectif : sécuriser une tête de pont pour un pont aérien massif. Pendant 36 heures, la bataille fait rage. Le 26 février, les Russes se replient. L’opération échoue.
Michael Kofman pose une question qui hante toute son analyse : « Il y a un grand contrefactuel à avoir sur ce qui se passe si Hostomel — si les Russes tiennent Hostomel pendant quelques heures ou quelques jours de plus et qu’ils font ce pont aérien… essentiellement à l’intérieur de Kiev. »
Mais il va plus loin, exprimant un doute méthodologique rare chez un analyste de ce calibre : « Il est toujours peu clair pour moi si nous vivons dans la chronologie des événements la plus probabiliste. » Autrement dit : nous ne savons pas si l’issue de cette guerre était la plus probable. Peut-être habitons-nous une chronologie à 20%, 30% de probabilité.
Kofman identifie ainsi ce qu’il appelle le « biais du survivant » : « En tant qu’êtres humains, nous jugeons naturellement que tout ce qui s’est passé était le cours d’événements le plus probable. » Nous construisons des récits rétrospectifs qui rendent l’histoire cohérente. Kiev a tenu ? C’était inévitable. Mais que se passe-t-il si on « rejoue » 100 fois avec des paramètres légèrement différents ?
Cette question force à quantifier l’incertitude plutôt qu’à l’éliminer. Ce déplacement grammatical — du passé certain vers le conditionnel probabiliste — constitue une révolution méthodologique centrale dans cet échange. Décidément, qu’il serait dommage de passer à côté !
L’écart entre l’analyste et l’historien
Kofman insiste : « Quand vous êtes analyste sur la guerre, vous n’avez pas les archives, vous ne savez pas comment la guerre se termine… Vous avez de très grandes lacunes dans la connaissance. »
L’historien, vingt ans après, accède aux archives déclassifiées. L’analyste contemporain navigue dans un brouillard informationnel permanent. Prenons la planification russe initiale. Avant les documents capturés, les analystes extrapolaient : « D’accord, quels sont les meilleurs cours d’action pour l’armée russe ? Que suggérerait la doctrine ? »
Problème : cette rationalisation supposait que les Russes suivraient leur doctrine. Or ils ne l’ont pas fait. L’invasion privilégiait la vitesse sur la durabilité, présumait un effondrement politique ukrainien rapide. « Il aurait été très difficile de prédire cela », admet Kofman.
D’où sa formule : « L’opération militaire par elle-même d’un point de vue stratégique militaire n’avait pas beaucoup de sens. Elle était basée sur des hypothèses politiques clés. »
Astarte : une bataille fictive, une angoisse identique
Dans Legend of the Galactic Heroes, la Bataille d’Astarte met en scène une situation analogue. L’Alliance des Planètes Libres est sur le point d’être encerclée. Le stratège Yang Wenli prend une décision : arriver 30 minutes plus tôt que prévu sur un secteur spatial critique. Ces 30 minutes changent tout.
Le parallèle structurel avec Hostomel mérite attention :
| Hostomel (2022) | Astarte (fiction, 1982) |
|---|---|
| Pont aérien russe échoue de justesse | Yang arrive juste à temps |
| 36 premières heures décisives | 30 minutes décisives |
| Si Russes tiennent 24h+ → Kiev menacée | Si Yang arrive 30min+ tard → Alliance disparaît |
Yoshiki Tanaka, écrivant en 1982, n’a évidemment jamais entendu parler d’Hostomel. Mais il explore une angoisse philosophique similaire : dans la guerre, l’histoire bascule sur des décisions prises avec information incomplète, sous pression extrême, par des humains faillibles.
La citation centrale de Yang : « Il n’existe pas de stratégie invincible. Si elle existait, l’histoire de l’humanité se serait arrêtée depuis longtemps. » Cette phrase pourrait servir d’épigraphe à l’analyse de Kofman.
Ce qui rend ce dialogue pertinent, ce n’est pas que Tanaka « prédisait » en quelque sorte Hostomel. C’est qu’il théorisait, dans un contexte de science-fiction militaire japonaise post-Hiroshima, l’impossibilité structurelle de la certitude stratégique — observation que Kofman formule empiriquement 40 ans plus tard.
Épistémologie du brouillard : ce que les généraux ne peuvent pas savoir
L’asymétrie informationnelle
« Le plus grand déficit de connaissance était effectivement du côté ukrainien de l’équation. »
Cette phrase de Kofman devrait résonner dans les écoles militaires. En février 2022, l’establishment occidental possédait une connaissance sophistiquée de l’armée russe. Des analystes avaient passé des années à disséquer les réformes russes, les exercices stratégiques, l’intervention en Syrie. En revanche, l’armée ukrainienne ? « Je défierais quiconque de nommer les experts sur l’armée ukrainienne qu’ils connaissent des années 2014 à 2022 aux États-Unis. »
Pourquoi cette asymétrie ? Kofman l’explique : « L’écosystème de recherche en défense est très concentré sur des types spécifiques de questions comme les capacités militaires adverses. » Les budgets vont à l’étude des menaces, pas des partenaires.
Résultat : double aveuglement. Surestimation russe (on pensait qu’ils exécuteraient leur doctrine) + sous-connaissance ukrainienne (on ignorait leur capacité d’improvisation).
Le piège du « worst-case »
Kofman identifie également un biais structurel : « Vous devez présumer que les adversaires seront capables de faire les choses qu’ils peuvent parce que vous ne pouvez pas juste entrer dans une pièce et dire ‘Hé… je suis assez sûr qu’ils ne peuvent pas le faire.’ »
Ce biais est rationnel : sous-estimer l’ennemi peut être catastrophique. Mais il produit un effet pervers : on finit par surévaluer systématiquement. L’armée russe post-2014 ? Réformée, modernisée, testée en Syrie. Donc présomption : probablement très compétente.
Sauf que non. Les faiblesses cachées étaient multiples : exercices « fortement scriptés », compromis de structure de force, capacité organisationnelle faible. « Nous savions qu’ils étaient fortement scriptés », dit Kofman. « Le problème était qu’on ne pouvait pas dire grand-chose… sur ce que la force pouvait vraiment faire. »
Cycles de perception
Kofman résume l’oscillation analytique avec une formule devenue célèbre : « L’armée russe n’est ni 12 pieds de haut ni 4 pieds de haut… peut-être qu’elle est juste moyenne. »
Les cycles : 1990s-2000s (décrépite) → 2008 Géorgie (confirmation faiblesse) → 2014-2015 (surprise Crimée/Syrie) → 2016-2021 (surcorrection, surestimation) → Février 2022 (choc échec initial).
Chaque phase corrige la précédente en surcompensant, créant un nouveau biais. « Il y a eu effectivement une surcorrection visible dans notre domaine d’analyse », reconnaît Kofman.
« Nous avons tous des angles morts »
Cette phrase récurrente n’est pas, je le crois, de la fausse modestie. C’est une posture épistémologique. Kofman développe des méthodologies pour atténuer ces angles morts :
Multi-niveaux : engager au niveau stratégique (Kiev), opérationnel (brigade), tactique (bataillon/compagnie).
Multi-fonctions : parler aux brigades de manœuvre, d’artillerie, de drones, de défense aérienne.
Multi-secteurs : aller sur différentes parties du front.
Équipe multi-nationale : travailler avec Rob Lee (américain), Franz Stefan Gady (autrichien), Konrad Muzyka (polonais). « Chacun apporte des biais différents. »
Mais même avec ces précautions, « vous avez de très grandes lacunes ». L’opacité est structurelle.
D’où son mantra : « J’ai souvent au moins deux opinions sur un sujet. Je débats avec moi-même. » Face à un système complexe avec information incomplète, maintenir plusieurs modèles mentaux en parallèle plutôt que s’enfermer dans une certitude prématurée.
Yang Wenli et l’humilité stratégique

Yang dira ainsi à un amiral impérial capturé lors de l’épisode de la Forteresse d’Iserlohn : « Vous pensez que j’ai tout prévu ? Je navigue dans le brouillard comme vous. J’ai juste eu plus de chance. »
Cette convergence n’est pas anodine. Yoshiki Tanaka, écrivant en 1982 dans un Japon post-Hiroshima marqué par la catastrophe de la guerre du Pacifique, explore l’impossibilité de la certitude stratégique. Yang refuse les certitudes martiales. Il ne dit jamais « nous allons gagner ». Il dit « nous pouvons peut-être survivre si nous adaptons vite ».
Kofman adopte exactement cette posture. Il ne proclame pas « l’Ukraine va gagner ». Il dit : « Je vois cette guerre comme une guerre de rendements décroissants pour la Russie » mais ajoute immédiatement : « Nous ne savons pas comment ça se termine jusqu’à ce que nous regardions en arrière depuis le futur. »
Cette humilité épistémologique radicale distingue Kofman de nombreux commentateurs. Elle suggère aussi que ces questions — doute productif, impossibilité prescience — sont pensées ailleurs, dans d’autres traditions culturelles, avec profondeur comparable.
Toute la philosophie de cette oeuvre en un échange puissant
Géographie de l’impossible : quand les lignes disparaissent
« Il n’y a personne dans les tranchées »
En août 2024, Kofman fait une observation bouleversante : « Il n’y a personne dans les tranchées. Il n’y a pas de forces tenant de grands nombres de tranchées. Ce qui se passe c’est que l’Ukraine a une série de piquets avant. »
Depuis le début, le récit dominant comparait le conflit à la Première Guerre mondiale avec des dronesLes exemples sont légions, en voici un, assez typique : Tranchées en Ukraine : comme les poilus de la Première Guerre mondiale, les soldats s’enterrent pour survivre, Le Figaro, décembre 2022.
Mais Kofman, au contact direct des brigades, voit autre chose. Les « positions avant ne tiennent pas vraiment le terrain ». Pourquoi ? « Rareté de main-d’œuvre et faible densité de forces. » Les forces ukrainiennes sont organisées en piquets dispersés, pas en lignes continues.
Conséquence tactique radicale : « Les forces russes s’infiltrent parce qu’elles passent à travers. » L’objectif russe n’est pas d’attaquer les positions mais de les contourner. Nouvelle tactique observée en 2024 : « Groupes de deux fantassins chacun… avançant 2×2, 2×2, le long de multiples chemins. » Petits nombres, haute intensité quotidienne.
Face à cette infiltration, l’Ukraine défend avec une « défense de zone avec des drones ». Pas de tenue physique du terrain. Plutôt : zones de contrôle de feu par drones, mines, artillerie.
La cartographie devient « métaphysique »
Conséquence vertigineuse : la cartographie devient problématique. « Alors la ligne avant de troupes n’est de plus en plus pas une ligne avant de troupes parce que ce n’est pas une ligne. »
Qu’est-ce alors ? « C’est plus une zone grise d’un ensemble chevauchant de zones de contrôle de feu par vos drones et les drones ennemis. »
Exemple concret, presque surréaliste : « Dans une ligne d’arbres il pourrait y avoir une position de deux, trois hommes d’un côté qui est ukrainienne et une position russe de trois hommes de l’autre côté… qui contrôle la ligne d’arbres, ou personne ne contrôle la ligne d’arbres ? »
Kofman décrit les débats entre analystes : « Quelle est la différence entre une avance, une brèche, une percée ? » Ces questions deviennent cruciales parce que les catégories analytiques traditionnelles ne correspondent plus au réel observé.
L’exemple de Toretsk : « Forces co-mélangées où dans un bloc ce sont des Ukrainiens, un autre bloc ce sont des Russes… Qui contrôle le centre ? Cela devient presque comme un exercice métaphysique. »
Métaphysique. Le terme signifie que la cartographie militaire — discipline supposément objective — est devenue question d’interprétation philosophique.
L’espace de Tanaka : une anticipation possible
Dans Legend of the Galactic Heroes, Tanaka place son récit dans l’espace. Ce choix pourrait être philosophique. Car dans l’espace, selon la logique de l’œuvre, il semble impossible de « tenir des lignes » au sens terrestre.
Une citation de Yang Wenli résume : « Dans l’espace, il n’y a ni haut ni bas, ni avant ni arrière. Celui qui pense en termes de lignes de front a déjà perdu. »
Le parallèle avec ce que Kofman observe en Ukraine mérite attention. Tanaka, écrivant de la science-fiction 40 ans avant les drones FPV, aurait ainsi théorisé la dissolution des fronts fixes. Pas parce qu’il prédisait la technologie des drones, mais parce qu’il réfléchissait aux conséquences logiques d’un environnement où le contrôle territorial physique devient problématique.
Ce dialogue n’est évidemment pas causal. Mais il suggère que certains créateurs de fiction ont théorisé des problèmes stratégiques avant qu’ils ne se matérialisent empiriquement — révélant que ces questions circulaient dans d’autres traditions intellectuelles.
Structure de force > capacités
L’obsession des systèmes d’armes
Kofman critique le focus excessif sur les capacités technologiques : « Nous parlons beaucoup trop de capacités et nous ne parlons presque pas assez de structure de force. »
Dans les médias, on discute sans fin des HIMARS, Leopard 2, drones Shahed. Mais Kofman insiste : les capacités individuelles importent moins que la façon dont la force est structurellement organisée. « Comment elle est façonnée par la stratégie militaire, la doctrine, et ce que la force est effectivement conçue pour faire. »
Son analogie : « Une armée construite pour combattre en Europe ne va pas nécessairement faire très bien dans la contre-insurrection en Irak. » Une force optimisée pour le scénario A ne performera pas nécessairement dans le scénario B, même si B est théoriquement « plus facile ».
Les compromis fatals russes
La découverte majeure vient de documents capturés. « Ils ont fait de grands compromis… Ils ont coupé la composante infanterie de la force, ils ont réduit la préparation pour… obtenir plus grand, plus et plus de formations sur papier. »
L’armée russe voulait paraître plus grande. Pour y arriver sans exploser le budget : couper l’infanterie, réduire la préparation, gonfler sur papier. Ces compromis étaient invisibles aux analystes avant la guerre.
Kofman et Rob Lee ont publié : « Not Built for Purpose » (2022). La force russe n’était pas adaptée à l’objectif qu’elle devait remplir. Conçue pour un blitzkrieg, elle s’est révélée incapable de soutenir une guerre d’attrition.
Empire vs Alliance : une parabole organisationnelle
Dans Legend of the Galactic Heroes, le contraste organisationnel est central :
Empire : hiérarchie rigide, commandement centralisé, planification méticuleuse
Alliance : structure démocratique, initiative décentralisée, adaptation rapide
L’Alliance gagnerait souvent des batailles malgré infériorité numérique parce que sa structure organisationnelle permettrait l’adaptation rapide. L’Empire ferait de meilleurs plans, mais s’effondrerait quand la réalité dévie.
Ce contraste suggère une thèse : les armées autoritaires ont une faiblesse structurelle — l’incapacité à adapter quand les subordonnés ne peuvent prendre d’initiatives. Les armées décentralisées ont une force cachée — la résilience par improvisation.
Le parallèle avec l’analyse de Kofman est apparent. Les Russes ont une culture de commandement centralisée. Quand le plan échoue (février 2022), l’adaptation est lente. L’Ukraine a une culture d’initiative décentralisée. « L’initiative et la motivation des commandants et troupes ukrainiens… sont responsables de leur capacité à initialement vaincre le plan russe. »
Technologie agnostique
La thèse centrale
L’observation la plus profonde de Kofman : « La technologie est agnostique en termes de culture militaire et style de leadership. La technologie peut permettre différentes façons de combattre. »
« Agnostique » signifie : la technologie par elle-même n’impose pas un usage spécifique. Les mêmes outils (drones + C2 numérique) peuvent produire des résultats radicalement opposés.
Drones : empowerment ou micro-management ?
Kofman observe sur le terrain ukrainien deux usages des mêmes drones :
Usage positif : les commandants utilisent les flux vidéo pour comprendre la situation, identifier où leurs unités ont besoin de soutien, permettre aux subordonnés de prendre initiatives avec meilleure information.
Usage négatif : d’autres commandants « voient cela comme une opportunité de centraliser le commandement et le contrôle et microgérer tout le monde… Ils peuvent tout voir. Ils peuvent appeler tout le monde en temps réel. Et ces gens sont presque comme un jeu de stratégie en temps réel pour eux. »
Même technologie. Deux usages opposés.
Les Russes souffrent d’une culture de commandement centralisée. Les C2 numériques renforcent la centralisation. Résultat : « Ils continuent à faire des plans par armées ou corps, mais la force tactiquement ne peut pas les exécuter. »
Vaisseaux identiques, commandement différent
Dans Legend of the Galactic Heroes, un thème récurrent semble être que l’Empire et l’Alliance utiliseraient des vaisseaux de classes similaires, mais obtiendraient des résultats différents.
La différence ? Style de commandement. L’Empire donnerait des ordres détaillés. L’Alliance (sous Yang) donnerait des ordres généraux, laissant les capitaines libres d’exécuter. Résultat suggéré : adaptation rapide aux imprévus.
Ce parallèle structurel avec l’observation de Kofman mérite attention : même technologie + culture commandement différente pourrait produire résultats opposés.
Le retour aux fondamentaux
L’artillerie n’a pas diminué
En août 2024, Kofman fait une observation contre-intuitive. Après avoir documenté que les drones infligent 70-80% des pertes, il constate : « L’emploi de l’artillerie et l’utilisation de munitions d’artillerie n’avaient pas substantiellement diminué. »
Pourquoi ? Plusieurs raisons :
Limitations météorologiques : « Les drones continuent à lutter pour travailler dans de mauvaises conditions météorologiques. Et les Russes attaqueront typiquement quand le temps est mauvais. »
Effets de suppression : « L’artillerie a des effets de façonnement et de canalisation très importants… si vous n’avez pas d’artillerie, vous n’auriez pas de forces russes attaquant en petits groupes d’infanterie. » Pourquoi les Russes n’attaquent plus en formations de 100-30 hommes ? Parce que toute concentration serait décimée par l’artillerie.
Moral : « Le moral des troupes monte vraiment quand ils voient l’artillerie venir dans le combat. »
Kofman conclut : « C’est une combinaison de choses. » Pas « les drones remplacent l’artillerie » mais « drones + artillerie + mines + terrain = système intégré ».
Yang Wenli et l’obsession logistique
Dans Legend of the Galactic Heroes, Yang Wenli serait célèbre pour son obsession de la logistique. Il refuserait des batailles glorieuses si les lignes de ravitaillement sont vulnérables. Une scène : Yang refuse d’attaquer la capitale ennemie sans défense parce que ses lignes logistiques seraient trop étendues. Ses officiers protestent. Yang répond : « Une armée sans munitions ni nourriture n’est qu’une foule. »
Cette priorité donnée à la logistique sur l’opportunité tactique serait présentée comme la marque du vrai stratège. Le parallèle avec l’analyse de Kofman sur février 2022 est direct. Les Russes ont privilégié la vitesse sur la durabilité logistique. Colonnes avançant rapidement sans sécuriser les lignes de communication. Résultat : « L’armée russe a avancé sur tant d’axes qu’elle était effectivement en compétition avec elle-même pour la logistique. »
Compétition avec elle-même. Formule extraordinaire révélant l’échec structurel.
Thorfinn : du guerrier au constructeur
Vinland Saga, manga de Makoto Yukimura (2005-présent), offre un contrepoint viscéral à ces réflexions théoriques. L’œuvre suit Thorfinn, jeune guerrier viking d’élite piégé dans un cycle de vengeance, qui découvre progressivement que la maîtrise du combat ne suffit pas.
L’Arc de Farmland : la découverte des fondamentaux
Après des années de violence, Thorfinn est réduit en esclavage dans une ferme danoise. Cette descente aux enfers devient initiation. Il apprend l’agriculture, la construction, la gestion des conflits sans violence. Un passage clé : Thorfinn réalise « J’étais le meilleur guerrier. Mais je ne savais pas construire une maison, cultiver un champ, ou tenir une promesse. »
Cette reconnaissance n’est pas romantique. Elle est pragmatique. Les compétences martiales individuelles — aussi extraordinaires soient-elles — ne créent rien de durable. Elles détruisent efficacement, mais ne construisent pas. Or construire (infrastructure, confiance, coopération) requiert des fondamentaux différents : patience, constance, humilité.
La colonie du Vinland : l’échec par négligence des fondamentaux
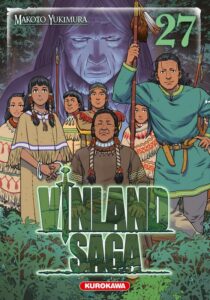
Mais la colonie échoue. Pourquoi ? Les fondamentaux manquent :
- Provisions insuffisantes : calculs logistiques défaillants
- Conflits internes : méfiance entre membres de l’expédition
- Absence de leadership moral : incapacité à arbitrer disputes sans violence
- Incompréhension culturelle : échec à établir relations pacifiques avec populations locales
Yukimura démontre visuellement que l’excellence individuelle au combat (Thorfinn reste un combattant redoutable) ne compense pas les défaillances organisationnelles et logistiques. Une colonie n’est pas un raid. Elle requiert génération de ressources, gestion de communauté, maintien de cohésion — exactement les « fondamentaux » que Kofman identifie comme critiques dans la guerre moderne.
Parallèle avec l’analyse de Kofman
La trajectoire de Thorfinn illustre une vérité que Kofman verbalise : « La technologie est vraiment intéressante, mais me ramène toujours aux conversations sur la structure de force, la capacité organisationnelle, comment vous organisez le commandement et le contrôle. »
Les Vikings de Vinland Saga ont de meilleures « capacités » (armes, navires). Mais leur « structure » (organisation sociale, logistique, leadership) est défaillante. Résultat : échec malgré supériorité technique.
De même, l’armée russe en février 2022 possédait des capacités avancées (reconnaissance-frappe, artillerie guidée). Mais sa structure organisationnelle (compromis fatals, software militaire immature) l’a condamnée. Kofman le répète : structure bat capacités.
Le bushido réinterprété
Vinland Saga prolonge naturellement la réflexion sur le « bushido numérique » (voir article « Rising Lion » sur l’adaptation culturelle japonaise). Le manga propose une réinterprétation radicale du code guerrier :
Première partie : bushido traditionnel (honneur par violence, vengeance, courage martial)
Deuxième partie : bushido transformé (honneur par construction, pardon, courage de la non-violence)
Thors, père de Thorfinn, mort au début de l’histoire, laisse un enseignement : « Un vrai guerrier n’a pas besoin d’épée. » Cette phrase paradoxale hante Thorfinn. Qu’est-ce qu’un guerrier sans épée ? Réponse progressive : quelqu’un qui possède force, discipline, courage — mais les emploie pour construire plutôt que détruire.
Ce bushido réinterprété résonne avec l’observation de Kofman sur l’adaptation ukrainienne. Face à une armée russe numériquement supérieure, l’Ukraine a dû transformer sa culture militaire : de la défense statique (doctrine soviétique héritée) vers l’initiative décentralisée, l’adaptation technologique rapide (drones), la résilience. Pas un nouveau bushido, mais une transformation culturelle sous pression analogue.
Conclusion : le détour par le viscéral
Là où Legend of the Galactic Heroes théorise abstraitement (espace, flottes, stratégies à grande échelle) et où Kofman analyse empiriquement (terrain ukrainien, données, interviews), Vinland Saga incarne viscéralement. Le lecteur voit Thorfinn échouer, souffrir, apprendre. La leçon des fondamentaux n’est pas intellectuelle mais émotionnelle.
Cette triangulation — théorie (LoGH), analyse (Kofman), incarnation (Vinland Saga) — renforce l’argument central : les fondamentaux battent toujours le brillant. Construction patiente bat destruction spectaculaire. Logistique obscure bat tactique flashy. C’est vrai dans l’espace fictif de Tanaka, sur le terrain ukrainien de Kofman, dans l’Amérique médiévale de Yukimura.
L’indétermination du jugement
« Nous ne savons pas jusqu’à regarder depuis le futur »
Vers la fin de l’interview, on demande à Kofman : « Comment ça se termine ? » Sa réponse : « Nous ne savons pas comment ça se termine jusqu’à ce que nous regardions en arrière dessus depuis le futur. »
Ce n’est pas une esquive. C’est une thèse sur l’impossibilité du jugement contemporain. Kofman développe :
Scénario A : un accord avec engagements de sécurité, Ukraine viable, indépendance préservée → jugement positif.
Scénario B : le même accord, mais Russie réattaque deux ans après → jugement négatif du même accord initial.
Le point crucial : le même événement sera jugé différemment selon ce qui suit. L’accord lui-même n’est ni bon ni mauvais intrinsèquement. Son évaluation dépend de la durabilité temporelle.
Legend of the Galactic Heroes : qui a « gagné » ?
Dans Legend of the Galactic Heroes, la guerre entre Empire et Alliance se terminerait de façon ambiguë : Reinhard « gagne » militairement mais meurt jeune. L’Empire se démocratise partiellement. L’Alliance disparaît politiquement mais ses valeurs survivent.
Alors, qui a « gagné » ? Question que l’œuvre laisserait ouverte. La citation finale de Yang : « L’histoire n’est pas écrite par les vainqueurs. Elle est écrite par ceux qui survivent assez longtemps pour raconter. »
Cette thèse — le jugement historique est toujours provisoire, sujet à révision selon ce qui suit — converge avec Kofman. Tous deux refusent le jugement immédiat sur qui gagne/perd. Tous deux insistent sur la temporalité longue.
Conclusion et réflexion méthodologique
Note sur le statut épistémologique de la fiction
Avant de conclure, une clarification méthodologique s’impose. Cet article a établi des parallèles entre l’analyse contemporaine de Kofman et des œuvres de fiction (principalement Legend of the Galactic Heroes, secondairement Vinland Saga). Que prouvent exactement ces convergences ?
Ce qu’elles ne prouvent PAS :
- Que Tanaka (1982) ou Yukimura (2005) « prédisaient » la guerre en Ukraine
- Que la fiction influence directement les décisions stratégiques occidentales
- Que Legend of the Galactic Heroes est une « source » académique au même titre que Clausewitz
Ce qu’elles suggèrent :
- Les mêmes questions ontologiques (nature de la contingence, impossibilité prescience, primauté fondamentaux) traversent différentes traditions intellectuelles
- Des créateurs de fiction, libérés des contraintes institutionnelles (financement, peer review, policy implications), peuvent explorer ces questions avec radicalité parfois supérieure aux think tanks
- La culture stratégique japonaise post-Hiroshima a développé une sensibilité particulière à l’incertitude radicale et aux limites de la technologie
L’argument central n’est donc pas : « La pop culture prédit/explique la guerre. » C’est plutôt : « La pop culture révèle que, dans d’autres contextes culturels, ces questions sont pensées autrement. C’est un appel à élargir nos sources. »
Les analystes occidentaux ont tendance à chercher des insights stratégiques uniquement dans :
- Think tanks (RAND, Carnegie, RUSI)
- Académiques (war colleges, universités)
- Mémoires militaires
- Doctrines officielles
Mais si Legend of the Galactic Heroes a théorisé en 1982 des problèmes que nous « découvrons » en 2024, cela suggère que nous avons des angles morts culturels. D’autres traditions — notamment japonaise, mais potentiellement chinoise, coréenne, etc. — pensent la guerre différemment. Ignorer ces sources par préjugé (« c’est juste de la fiction ») revient à s’amputer d’une partie du champ intellectuel.
Les limites de cet exercice :
- Les convergences identifiées restent partiellement interprétatives. Un autre lecteur pourrait voir différences plutôt que similarités. Donc ces lignes sont bien entendu soumises à la critique.
- L’accessibilité très limitée de Legend of the Galactic Heroes en Occident (œuvre quasi-inconnue) rend l’argumentation invérifiable pour 95% du lectorat. Du coup je vous encourage à découvrir l’œuvre !
- Le risque d’analogisme existe : voir des parallèles structurels là où il n’y a que ressemblances narratives superficielles.
Mais : ces limites n’invalident pas, je crois, la démarche. Elles appellent simplement à la prudence. Cet article ne prétend pas établir des vérités définitives. Il propose une lecture croisée qui, au minimum, révèle que les questions posées par Kofman — contingence, humilité épistémologique, structure vs capacités — ne sont pas nouvelles et méritent d’être pensées avec les outils d’autres traditions.
Synthèse des convergences : dialogues philosophiques entre Kofman et les œuvres explorées
| Thème | Kofman | Œuvres (LoGH / Vinland Saga / Autres) | Convergence |
|---|---|---|---|
| Contingence radicale | « Si nous rejouons 100 fois la même bataille, les résultats seront différents. » | LoGH : Bataille d’Astarte — 30 minutes de retard changent le cours de l’histoire. | L’histoire est façonnée par des événements minuscules et imprévisibles, pas par un déterminisme. |
| Impossibilité de la prescience | « Nous avons tous des angles morts, même les stratèges. » | Yang Wenli : « Il n’existe pas de stratégie invincible. » | La limite cognitive et l’incertitude sont inhérentes à la guerre et à la décision. |
| Géographie floue | « Il n’y a personne dans les tranchées » → Zones grises, espaces indéfinis. | LoGH : L’espace cosmique rend les « lignes de front » impossibles à fixer. | La géographie physique ou stratégique est souvent ambiguë, défiant les doctrines classiques. |
| Structure > Capacités | « Nous parlons trop de capacités individuelles, pas assez des systèmes. » | LoGH : L’Alliance bat l’Empire malgré son infériorité numérique grâce à une meilleure structure logistique et décisionnelle. Compromis russes fatals (ex. : 1941–42). | La supériorité organisationnelle l’emporte sur les ressources brutes. |
| Technologie agnostique | « Les drones peuvent être un outil d’empowerment ou de micro-management, selon la culture. » | LoGH : Les deux camps utilisent les mêmes vaisseaux, mais leur commandement diffère radicalement (centralisé vs. décentralisé). | La technologie est neutre ; son impact dépend de la doctrine et de la culture qui l’utilise. |
| Fondamentaux éternels | « Logistique, génération de force, C2 (Command & Control) restent les piliers. » | Yang Wenli : « Les guerres se gagnent dans les entrepôts. » Thorfinn (Vinland Saga) : « Apprendre à construire est plus important que savoir détruire. » | Les bases matérielles et humaines (logistique, formation, chaîne de commandement) sont intemporelles. |
| Jugement indéterminé | « On ne sait pas qui a gagné avant de regarder depuis le futur. » | LoGH : « Qui a vraiment “gagné” ? L’Histoire jugera. » (fin ambiguë : Reinhard victorieux, mais à quel prix ?) | La victoire est toujours provisoire ; son sens dépend du recadrage historique. |
Ces convergences invitent donc à repenser la stratégie au-delà des dogmes
: où les boucles de rétroaction (logistique, moral, structure) comptent plus que les plans initiaux.
: reconnaître ses angles morts (Kofman) ou l’absence de stratégie invincible (Yang) est une force, pas une faiblesse.
: comme le souligne LoGH, les « vainqueurs » d’aujourd’hui peuvent devenir les « perdants » de demain (et vice versa).
Pourquoi ces convergences importent
Ces convergences révèlent que les questions fondamentales de la stratégie traversent les époques et les cultures. Elles ne sont pas résolues. Elles sont structurelles.
Yoshiki Tanaka en 1982, Makoto Yukimura en 2005, Michael Kofman depuis 2022 — séparés par décennies et continents — arrivent à des conclusions similaires : la guerre est fondamentalement contingente, imprévisible, et se joue moins sur les capacités que sur l’architecture organisationnelle et l’humilité de ceux qui la conduisent.
Cette convergence suggère une vérité désagréable : nous continuons à réapprendre les mêmes leçons. Chaque génération semble redécouvrir que la certitude stratégique est illusoire, que les fondamentaux battent la technologie, que l’histoire bascule sur des hasards.
Peut-être que lire Legend of the Galactic Heroes (ou regarder les Anime) ne rendra pas un analyste meilleur. Mais cela pourrait lui rappeler que d’autres, ailleurs, se posent les mêmes questions — et que l’humilité intellectuelle n’est pas une faiblesse mais une force.
L’analyste du futur
« J’ai souvent au moins deux opinions sur un sujet. Je débats avec moi-même. »
Cette phrase de Kofman devrait être inscrite au fronton de toute institution qui prétend analyser la guerre. Car elle reconnaît ce que les certitudes martiales occultent : dans un système complexe avec information structurellement incomplète, maintenir plusieurs modèles mentaux en parallèle est la seule posture intellectuelle honnête.
Nous avons un potentiel vainqueur ….
…. ou pas !
Les commentateurs qui proclament « l’Ukraine va gagner » ou « la Russie va s’effondrer » ou inversement gagneraient à adopter l’approche de Kofman : « Je continue à faire des allers-retours avec moi-même… Je ne sais pas. »
C’est cette posture — l’humilité stratégique comme sagesse — qui pourrait définir les analystes du futur. Non ceux qui prédisent avec arrogance, mais ceux qui naviguent l’incertitude avec lucidité.
Yang Wenli, personnage fictif créé il y a 40 ans dans un Japon post-catastrophe, l’aurait peut-être approuvé.
Interview dans son intégralité