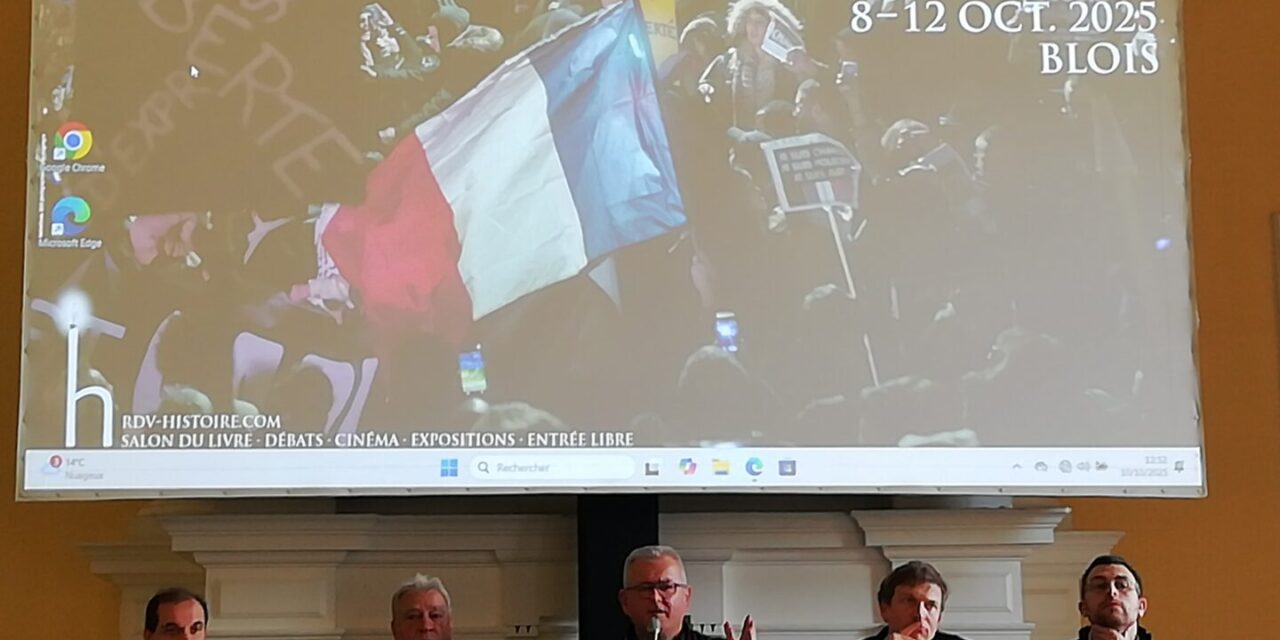Présentation de la table ronde
Dernière grande page héroïque de notre histoire nationale, la période de la Libération (1944-1945) occupe une place importante dans notre mémoire collective. Elle incarne la liberté retrouvée après l’humiliation de l’Occupation, symbolise la participation de la France à la victoire alliée et le redressement militaire du pays après la défaite traumatisante de 1940, représente un moment de refondation du fait des réformes de structures pensées au sein de la Résistance et mises en place par le GPRF. Tout cela fait de la période 1944-1945 l’un des éléments majeurs dans la fabrication de la Nation française, à la fois comme moment historique dont l’héritage perdure aujourd’hui à travers la Vème République, mais également comme une référence qui reste omniprésente dans le discours public.
Alors que les commémorations du 80ème anniversaire se terminent, les principales Fondations mémorielles (Fondation maréchal Leclerc de Hauteclocque, Fondation de Gaulle, Fondation de la Résistance et Fondation de la France libre) se proposent de revenir sur la façon dont les représentations de la Libération ont pu évoluer dans les médias, les programmes scolaires et les commémorations officielles depuis la fin de la guerre. Il s’agira notamment d’insister sur les grandes phases commémoratives (le 20ème anniversaire, avec la panthéonisation de Jean Moulin, le 50ème anniversaire en 1994 centré sur le rôle des Alliés, le 70ème anniversaire qui pour la première fois évoque la question des victimes civiles des bombardements). Cette table ronde sera également l’occasion de dresser un bilan des commémorations du 80ème anniversaire et d’évoquer des pistes pour l’avenir, alors que se profile l’année du centenaire en 2045.
Les intervenants :
Antoine Broussy, directeur de la Fondation Charles de Gaulle
Fabrice Grenard, directeur scientifique de la Fondation de la Résistance
Jérôme Maubec, directeur historique de la Fondation de la France libre
Yves Rousset, président de la Fondation maréchal Leclerc de Hauteclocque
Christophe Gendry, directeur départemental de La Nouvelle République du Loir-et-Cher
Pluralité des discours originels, qui deviendront des mémoires différentes
Les résistants ont vécu un moment transcendant, la fraternité dans l’engagement. La Résistance est un événement qui va devenir métahistorique : un moment qui dépasse l’événement et s’intègre dans la grande Histoire. Les résistants ont conscience du caractère absolument libre et pur de leur engagement, d’avoir choisi le Bien. Mais la pluralité des discours sur la Résistance est immédiate : discours communiste et discours gaulliste. Dès l’époque du RPF, De Gaulle est perçu par certains de ceux qui l’ont suivi de la France occupée, comme un dictateur.
65 à 70 000 Français libres ont combattu à l’extérieur du territoire national. De retour sur le territoire métropolitain, ils ont le sentiment de ne pas être reconnus, et c’est pire encore pour ceux qui ont combattu sous l’uniforme britannique (SAS, commando Kieffer) ou dans des réseaux britanniques (SOE). Ils vont donc chercher à territorialiser la mémoire de leurs actions extérieures par des monuments, à Paris (station Bir Hakeim), en Bretagne, au Mont-Valérien etc.
Henri Frenay propose à De Gaulle le Mont-Valérien comme haut lieu de commémoration de la Résistance. Dans la crypte sont déposés 15 cercueils de résistantes (deux) et de résistants, symboles de la diversité de la Résistance. Après 1958, De Gaulle utilise le Mont-Valérien pour mettre la mémoire gaulliste en avant. Il fait réhabiliter la crypte et ériger la Croix de Lorraine. La dualité de la crypte et de la clairière perdure : la clairière où furent fusillés plus de mille résistants et otages, reste le lieu de la mémoire communiste. Il faudra attendre 2008 pour qu’un Président parle dans la clairière.
Fabrice Grenard montre que, de 1944 à la fin des années 1960, les commémorations sont constitutives des mythes qui se sont développés autour de la Résistance. Il faut faire oublier l’humiliation de la défaite de 1940 et les quatre années de collaboration. Dans la forêt de Fontainebleau en 1946, on érige une stèle sur le lieu de l’assassinat de Georges Mandel : l’inscription dit qu’il l’a été par « les ennemis de la France ». On ne dit pas que c’est la Milice, on laisse même croire qu’il s’agit des allemands.
Ainsi se construit un mythe, mais attention à ne pas mal interpréter le terme : la Résistance n’est pas un mythe, elle a existé ! Ses composantes sont les suivantes : survalorisation de la lutte armée, des grandes « batailles » des maquis (Les Glières, le Vercors) ; affirmation de l’union de la résistance, qui culmine avec la panthéonisation de Jean Moulin ; affirmation de la Résistance comme héritière des combats républicains.
Leclerc : une grande figure fédératrice
Ses obsèques furent un grand moment de ferveur et d’unanimité nationale. Yves Rousset souligne trois dates clés :
18 juin 1945 : Leclerc à la tête de la 2e DB défile sur les Champs Elysées
28 novembre 1947 : Leclerc meurt à Colomb-Béchar, son corps est rapatrié, les dockers de la CGT saluent sa dépouille au port de Marseille.
24 juin 1952 : Vote unanime de l’Assemblée nationale, alors très divisée par le conflit de la Communauté européenne de Défense, pour l’ériger en maréchal.
Leclerc est le second nom, après Victor Hugo, le plus donné en France à des rues, avenues, boulevards, places etc.
Pourquoi une telle unanimité ? C’est un aristocrate, mais il a réuni autour de lui des femmes et des hommes d’une immense diversité, de nationalités (il y en 22 différentes), d’opinion politiques, de religions.
La Fondation maréchal Leclerc de Hauteclocque a voulu se donner une assise territoriale, par la création de la Voie de la 2e DB. 2900 communes ayant été traversées par la 2e DB depuis Saint-Martin de Varreville (sur cette commune, à Utah Beach, débarqua la 2e DB), jusqu’à Strasbourg (puis à Berchtesgaden), il s’agit de les relier par la pose de bornes symboliques. La Voie de la 2ème DB s’apparente à la Voie de la Liberté dont elle a repris le symbolisme, mais s’en distingue par son tracé qui suit le chemin parcouru par la Division Leclerc. Les Bornes du serment de Koufra ont l’aspect des bornes de la Voie de la Liberté, avec notamment : le flambeau de la statue de la Liberté sortant des flots de l’Atlantique, l’insigne Ⓐ de l’Armée Patton sur le flambeau, les 48 étoiles de la bannière américaine de l’époque, mais s’en distinguent par l’insigne de la 2ème DB, l’inscription « Borne du serment de Koufra », l’inscription « Voie de la 2ème D.B. 1944-1945 », la distance entre St Martin de Varreville et le lieu de la borne.
Le pouvoir politique investit les commémorations
De Gaulle au pouvoir entend ignorer les commémorations du Débarquement de Normandie dont il avait été informé qu’au dernier moment et auquel les Français n’ont quasiment pas participé (excepté les hommes de Kieffer). Par contre il participe aux commémorations du débarquement de Provence. Ses discours sont très sélectifs dans les termes utilisés.
En 1984, Mitterrand entend commémorer le Débarquement de Normandie. Les élus de droite du Calvados s’efforcent de faire échouer les cérémonies (Serge Barcellini, conseiller Mémoire de Mitterrand, en témoigne). « Pour les gaullistes, la Normandie, c’est Bayeux. Pour Mitterrand, c’est Caen ». A partir de 1984, autour du cérémonial, on voit se développer le tourisme mémoriel. Mitterrand invite les Alliés, et en 1994, les Allemands.
Le 80e anniversaire de la Libération accorde une grande importance au Débarquement de Normandie et met donc en valeur le rôle des Alliés. Les journalistes cherchent des Français présents ce jour là, en particulier les hommes de Kieffer, qui avaient fait le choix de l’uniforme britannique, pour des raisons d’efficacité, et qui avaient disparu des commémorations. De Gaulle était même allé jusqu’à exiger de résistants du SOE ayant joué des rôles essentiels dans certaines région, de quitter le territoire. De même, il avait interdit la publication de la traduction française de l’Histoire du SOE de Michael Foot.
Réflexions sur les commémorations du 80e anniversaire et perspectives
Ce fut la dernière grande commémoration avec la présence des Anciens (il reste aujourd’hui 100 Français libres, 22 Anciens de la 2e DB). Les combattants de la 1ère Division française libre ont été de nouveau oubliés, comme les SAS en Bretagne. Les projets et les initiatives ont été nombreux. On parle de « foisonnement », sans doute de par la volonté présidentielle de ne rien oublier, y compris de plus en plus les civils (monuments aux victimes des bombardements à Falaise) et des étrangers (panthéonisation de Manouchian). En 2044, on sera dans l’Histoire. L’évolution devrait conduire à s’intéresser aux invisibles de la Résistance (les helpers, les passeurs du lac Léman).