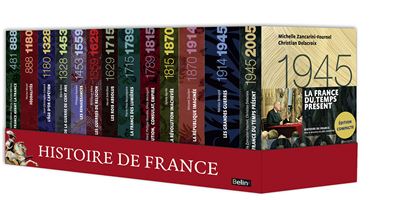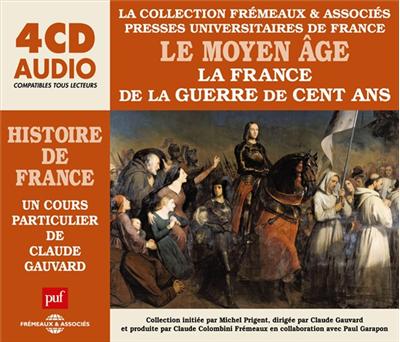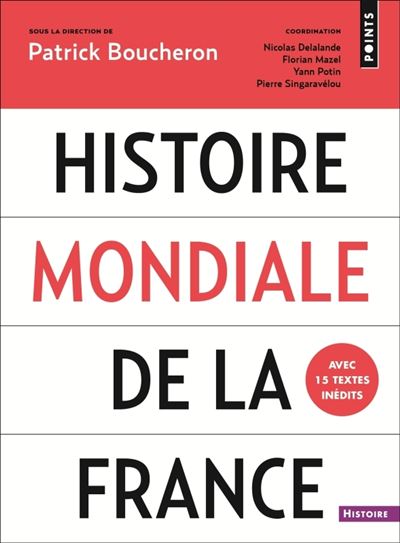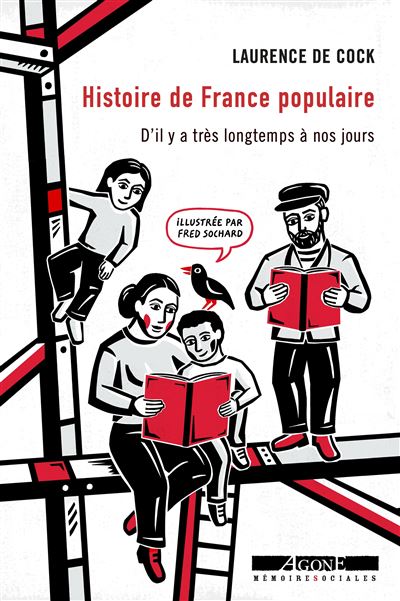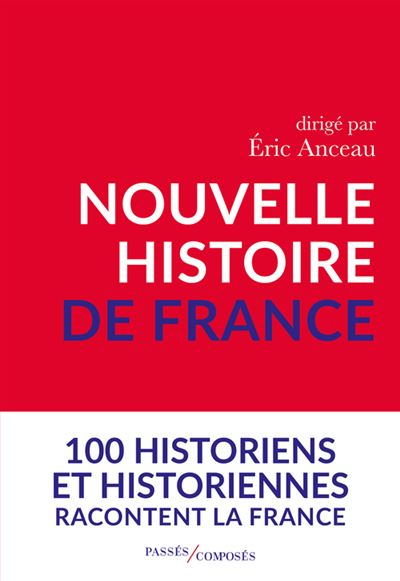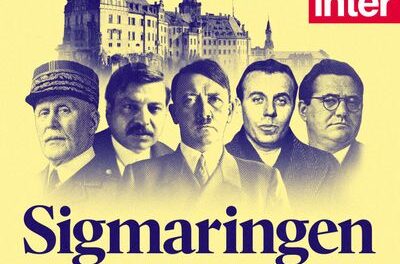Comment et pourquoi historiennes et historiens se lancent-ils, au début du XXIe siècle, dans l’écriture de nouvelles histoires de France ? Depuis une petite dizaine d’années, le cadre national est de retour. Qu’elle soit populaire, mondiale, environnementale, économique ou tout simplement sans adjectif, l’histoire de France est là : pour quoi dire ? Pour quoi faire ?
Emmanuel Laurentin s’entretient à l’occasion de la publication de leurs ouvrages avec Patrick Boucheron (dir.), L’Histoire mondiale de la France, Le Seuil ; Laurence de Cock, L’Histoire de France populaire, Agone ; Éric Anceau (dir.), Nouvelle histoire de France, Passés Composés ; Joël Cornette, directeur de la collection « Histoire de France », Belin (puis Folio) et Claude Gauvard, directrice de la collection « Histoires personnelles de France », PUF.
Emmanuel Laurentin introduit la table ronde : les « dernières » Histoire de France se caractérisent par un adjectif : populaire, mondiale, personnelle.
Les « dernières » Histoire de France
Joël Cornette explique la genèse de la collection Histoire de France, publiée à partir de 2009 par les éditions Belin. Réunir de jeunes chercheurs pour écrire une nouvelle histoire de France à un moment, les années 2000 où dominaient les histoires globales. Pas de littérature grise, mais une grande importance accordée à l’image au cœur du texte, car l’image est une source. Ajouter la « cuisine de l’histoire », ce sont les « ateliers de l’historien », présents à la fin de chacun des 13 volumes, qui présentent les sources, les débats et les enjeux. Il fut difficile de trouver un éditeur pour ce projet, jusqu’à la rencontre avec Belin, une maison d’édition créée au XVIIIe siècle et qui n’était pas effrayée par les illustrations, étant un éditeur de manuels scolaires. C’est un changement de programme qui a permis de financer le projet.
13 volumes, 17 auteurs, publiés entre 2009 et 2013, puis réédités dans la collection folio, des éditions Gallimard, soit plus de 400 000 exemplaires.
Claude Gauvard : j’ai commis un premier ouvrage audacieux, en 1996, qui embrassait 10 siècles d’histoire médiévale, La France au Moyen Âge du Ve au XVe siècle PUF, et réédité en 2015. Les PUF, associés à l’éditeur de CD Frémeaux & Associés ont lancé, en 2010, une collection de cours, édités en CD et complétés d’un court texte en version papier, des histoires personnelles, projet auquel j’ai participé Le moyen âge – la France des Capétiens, La France de la guerre de Cent-Ans
Des textes qui donnaient un sentiment d’oralité, de petits fascicules à lire dans le train. Les différents auteurs s’inscrivaient dans l’analyse d’un nœud historiographique : Bruno Dumézil, Histoire de France – des Gaulois aux Carolingiens, Emmanuel Fureix, un des meilleurs historiens pour l’histoire des mentalités du XIXe siècle, La France Du XIXe siècle de 1814 À 1914, Olivier Coquart, La France Des Lumières Et Des Révolutions de 1715 À 1815.
Patrick Boucheron : En 2017, notre Histoire mondiale de la France a été pensée pour mettre du plaisir, de la joie, pour partager à partir de surprises pour une bonne vulgarisation. Cette aventure éditoriale avec les éditions du seuil, proposait de transmettre avec un nouveau regard. L’ histoire de France sera toujours nouvelle.
En 2009, j’ai publié l’Histoire du monde au XVe siècle, je suis spécialiste de l’Italie, mais l’histoire de France est dominante dans l’enseignement français. Avec l’Histoire mondiale de la FranceRVH Blois 2017 :Histoire mondiale de la France : la discussion continue on a voulu monter que la France est mondiale, une tentative pour réconcilier le mondial et le national. C’est une histoire par date sur la longue durée. Le livre a été attaqué, mais une deuxième édition est en cours qui rajoute une vingtaine de dates. Dans une quinzaine de pays, sauf le Royaume-Uni, on été écrites des « histoire mondiale de… ».
Laurence de Cock
Reprenant l’idée de Gérard Noiriel, avec Une Histoire populaire de la France – De la guerre de Cent Ans à nos jours et de Michelle Zancarini-Fournel Les luttes et les rêves – Une histoire populaire de la France de 1865 à nos jours, j’ai cherché à proposer une lecture pour le grand public, Histoire de France populaire – D’il y a très longtemps à nos jours.
Mon travail sur la transmission de l’histoire, je le dois à ma rencontre avec Suzanne Citron. J’ai donc cherché à déconstruire le « roman national », mais on m’a questionnée sur les personnages : Clovis…
Je me suis donc posé la question : comment écrire un récit court, substitut au « roman national », tout en restant enchanteur.
Une enquête réalisée auprès des jeunes de 12 à 17 ansLe Récit du commun – L’histoire nationale racontée par les élèves, Françoise Lantheaume, Jocelyn Létourneau, Presses universitaires de Lyon, 2016, en réponse à la consigne : Raconte l’histoire de ton pays, a montré que sur 6 000 questionnaires, une grande majorité répond par le mythe national : les Gaulois etc., un récit très événementiel, même si on n’enseigne plus le roman national.
J’ai donc tenté d ‘écrire une histoire pour les enfants, inspirée des travaux de Noiriel. Le projet a évolué vers une histoire écrite pour mes voisins. Ce n’est pas un travail de recherche, mais un ouvrage de vulgarisation en cherchant à retrouver la « tendresse » qui émane du petit Lavisse, avec de petits résumés, en fin de chapitre, pour que les gens comprennent.
Éric Anceau, notre projet est une approche savante et ludique.
À la fin de chaque chapitre, un encart apporte en quelques lignes une courte bibliographie (pas plus de 5 titres), un événement marquant, 3 à 4 éclairages.
Toutes nos histoires sont différentes, mais complémentaires. Le constat de départ de mon projet est que la France connaît une crise, économique, sociale, politique, culturelle ; il faut donner aux Français un récit dépassionné en évitant le roman national qui devient identitaire et, aussi, l’histoire déconstruite, pour rassembler, sans angles morts. Cette Nouvelle histoire de France est au fait des évolutions historiographiques. L’historien est un savant et un citoyen
Une citation en référence à Marc Bloch.
L’organisation de livre :
Régimes et violences : un récit des Capétiens aux violences contemporaines
puis trois parties thématiques :
Pouvoirs et spiritualités, une histoire des politiques publiques et spiritualité
Sociétés et altérités, espaces et société, plus géographique
Patrimoines et Identités avec un Chapitre de Gérard Noiriel : le peuple et un de moi-même : la nation. La notion de patrimoine s’ouvre à la chanson, le cinéma…
Débat
E C polémique avec P B autour d’une citation de Michelet : est-ce la France qui inspire le monde ou le monde qui inspire la France ?
C G revient sur qui était Michelet, un homme de son temps, un patriote et un anticlérical, c’est ainsi que cela intervient dans son étude de Jeanne d’Arc.
-
- E L : Est-ce qu’on peut tout couvrir ?
E A : j’ai dû supprimer 2 chapitres : fiscalité et laïcité, à la demande de l’éditeur, mais les notions ont été ajoutées dans des éclairages.
L d C : Les historiens qui ont servi à l’écriture sont cités en bibliographie, mais pas dans le texte. Les débats historiographiques sont difficiles pour le grand public. Mon livre veut répondre au succès de l’extrême-droite et à l’instrumentalisation de l’histoire. Je cherche à offrir un récit qui ne tourne pas à l’exclusion. Mon écriture est « politique », mais ce n’est pas un « roman national de gauche ». Je n’ai pas l’ambition de dire la vérité. Ce qui est au cœur de mon travail : un savoir émancipateur.
J C : on pose la question de l’histoire militante. L’histoire est toujours politique. Notre projet, par ces nombreux auteurs, garantit une pluralité de récits pour transmettre, mais pas une doctrine. Nous ne sommes plus au temps de Lavisse qui dans son Louis XIV, dont le plan était un programme politique pour la 3e République. L’atelier de l’historien montre les débats et ce qu’on ne sait pas. C’est important ce qu’on ne sait pas.
C G : Je ne veux pas laisser Jeanne d’Arc à l’extrême droite. Elle appartient au roman national, mais qu’est ce que j’en fais ? Je la remets dans le contexte de l’époqueJeanne d’Arc – Héroïne diffamée et martyre, Claude Gauvard, Gallimard : elle a été qualifiée de sorcière et de putain aussi par des Français, les Bourguignons, et dans son procès de réhabilitation, il n’est pas question des visions, elle aurait été hérétique. Jeanne d’Arc est le roman national du XIXe siècle. Ce que je veux montrer, c’est l’importance du personnage, à son époque..
P B : On a cherché le moyen d’écrire l’histoire, pour nous rassurer sur l’intérêt que notre récrit de l’histoire de France pouvait avoir pour le public. Il n’y avait pas l’idée d’une version définitive. Un regret, en 2017, on a un peu fanfaronné, notre histoire ne serait nouvelle que si elle rencontrait un public.
E A : En fait, avec P B, nous sommes d’accord sur beaucoup de points. La polémique a été créée par la presse. La Nouvelle histoire de France est une vulgarisation, mais 1 100 pages et 1,5kg, ce n’est pas un livre de plage. Le but : mettre la science à la portée du lecteur.
-
- E L : Pensez-vous retravailler vos ouvrages ?
J C : En fait lors de l’édition de poche, le dernier tome a été prolongé, pour intégrer l’histoire du temps présent. Oui l’historiographie évolue et on ne peut plus traiter de la St Barthélémy comme lors de la première édition ; il faudrait la réécrire à la lumière des travaux de Jérémy FoaTous ceux qui tombent – Visages du massacre de la Saint-Barthélemy, La découverte, 2024. Je viens de lire l’histoire de la révolution depuis le vécu d’un Parisien par Timothy TackettJours de gloire et de tristesse, Une histoire extraordinaire de la Révolution par un Parisien ordinaire, Albin Michel, 2025, cette histoire au ras-du-sol, me donne l’idée d’un nouveau projet : une histoire de France vue par les témoins pour chaque période.
Remarque : même si le mot n’a pas été prononcé, on ne peut que penser à une introduction de la micro-histoire qui a fait l’objet d’une table ronde cette année à Blois : Entre microhistoire et histoire globale : Faire surgir des vies minuscules (XVIIe-XIXe siècle)
P B : pour la 2e édition, on a rajouté des dates pour élargir le récit. C’est le mouvement naturel du savoir et de la curiositéEn référence à une citation de Paul Veyne. On a commencé plus tôt, en intégrant le contact entre les Néandertaliens et les SapiensLa première édition commençait avec la grotte Chauvet. Les Catalans, dans leur histoire mondiale remontent jusqu’à 1 M d’années, leur histoire est nationaliste..
L d C : Je me suis, bien sûr, poser la question des bornes chronologiques. Le public s’interroge aujourd’hui, jusqu’à quand. Rappelons que pour Lavisse, la Première Guerre mondiale est présente dans son manuel dès l’édition de 1919.
Mon livre veut redonner une place « aux gens ordinaires ». J’ai intégré l’histoire de gens que j’ai rencontrés. Pas exemple, lors d’une visite au musée des mines d’Alès, le guide, bien documenté, parlait de ces femmes de mineurs montées à Paris pour manifester sous les fenêtres d’Anne-Aymone Giscard d’Estaing. J’ai donc cherché la trace de cette manifestation, en vain. Je l’ai gardé sous la formule : « il se raconte encore à Alès…
J’envisage une forme de science participative, ouvrir aux témoignages sur des événements que les gens pensent susceptibles d’entrer dans l’histoire.
Conclusion : Une table ronde riche et animée devant un public attentif et très nombreux.