Cette conférence aborde cette question via quatre historiens, spécialistes, respectivement, de la guerre de 100 ans, du XVIIe et XVIIIe siècle, du second empire coloniale et de la seconde moitié du XXe siècle.
Intervenants :
- David Fiasson : ATER à l’université de Reims
- Paul Vo-ah : Maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
- Stephanie Soubrier : Maitre-assistante en histoire contemporaine Université de Genève
- Walter Bruyère-Ostells : Professeur des universités en Histoire contemporaine a l’Université Science Po Aix.
Avant toute chose, il convient de revenir sur l’importance de la ponctuation, tant dans le titre de la conférence, que dans le choix du thème des Rendez-vous de l’histoire de Blois. Le point d’interrogation participe à la mise en perspective et en réflexion des thématiques abordées lors des conférences, il interroge la nature intrinsèque des sujets afin de les replacer dans les contextes historiques adéquats et appropriés.
Les limites historiques françaises

Mourir pour la France implique de mourir pour une entité à la fois politique et géographique délimitée concrètement. C’est là le premier point de la réflexion de cette conférence. Les soldats engagés dans les différentes guerres que cette conférence balaye, ne meurent pas pour le même territoire. Un soldat auvergnat combattant pour le roi de France lors de la guerre de 100 ans (carte ci-contre, ne défendra pas le même territoire qu’un soldat colonial engagé dans la conquête du Dahomey à l’extrême fin du XIXe siècle. La délimitation du territoire français a grandement varié entre les différentes annexions, projections et guerres de défense auxquelles elle a eu à faire face dans son histoire. Concrètement, les enjeux de frontières sont indispensables à définir au préalable de la formulation de quelques réflexions que ce soit sur le sujet. On remarque cependant que l’allégorie que représente la France personnifiée est réduite à ce qu’elle a de plus essentiel dans sa composition afin de pouvoir en partager une idée commune qui puisse être facilement force d’adhésion et de motivation pour l’engagement.
Quelles motivations pour mourir pour la France ?
Concernant le Moyen Âge et l’époque moderne, mourir pour la France relève de l’anachronisme historique. Les motivations pour mourir pour la France, et avant cela, pour s’engager dans les armées, trouvent des points communs qui traversent les époques : l’aspect financier (ou l’appât du gain) et l’honneur conféré sur le champ de bataille. Il y a des motivations cependant, qui sont intrinsèques aux époques. L’esprit de découverte, selon les recherches de S.Soubrier, est souvent un moteur d’engagement pour les soldats du second empire colonial, même si le cas des tirailleurs sénégalais, intégrés aux contingents des troupes françaises, offre une autre nature de leur engagement. En effet, selon leurs supérieurs, les tirailleurs sénégalais sont qualifiés comme n’étant pas assez « civilisés » pour comprendre l’amour de la patrie qui animait les officiers, ce qui leur laissait croire que ces hommes mourraient avant tout par dévouement pour leurs supérieurs. Cela relève avant tout d’une vision paternaliste de la colonisation et des populations rencontrées et soumises.
Si l’appât du gain et l’honneur sont deux composantes essentiels de l’engagement des soldats, on observe une autre raison faisant son apparition dans la seconde moitié du XXe siècle comme le constate W.Bruyère-Ostells : l’idée que les hommes d’armées, du soldats au général en passant par le lieutenant, portent des valeurs universelles de paix et de civilisation dans les pays dans lesquels ils interviennent via des OPEX (opérations extérieures). En portant l’uniforme, ils garantissent l’influence de la France au travers du monde. La dimension idéologique et politique, surtout contre le communisme à cette époque, compose ces schémas de valeurs des armées françaises. Avec la professionnalisation de l’armée française à partir de 1997, cette idée de porter les valeurs universelles françaises en dehors de ses frontières s’ancrent, notamment chez les officiers supérieurs, dans les girons matrices politiques de la droite et de l’extrême droite.
De la gloire du champ de bataille, en passant par l’élévation sociale que l’engagement confère, à la promesse de revenus conséquents ou simplement par haine des Anglais pendant la guerre de 100 ans, les finalités d’engagement des soldats pour la France, qu’elles soit volontaires ou subit, déterminent ‘engagement des soldats formant les contingents français.
Qui meurt pour la France ?
La diversité des profils composants les armées trouvent régulièrement comme dénominateur les motivations des engagées, différence faite néanmoins de l’obligation ou non de l’engagement dans les armées. Au travers des périodes, on note une constante de l’implication de mercenaire dans les contingents des armées françaises, comme lors de la guerre de 100 ans, où les mercenaires, d’origine écossaise, notamment, sont près de 15 000 entre 1419 et 1424. Meurent-ils pour la France ? S’ils ne sont pas considérés comme une armée de défense française par les Français eux-mêmes, il est notable que la valeur de leur sang est moins importante à leurs yeux.
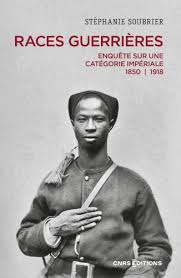
Les guerres du XVIIIe siècle étant meurtrière, elles nécessitent des levées d’hommes nombreuses et aux profils variés, incluant souvent des étrangers. On retrouve par exemple la mention de « nègre » dans les registres du contrôle des régiments de cavalerie du maréchal de Saxe en 1749, le maréchal de Saxe étant lui-même d’origine prussienne.
Durant le second empire coloniale français, les troupes engagées souffrent de la théorie des races guerrières qui sert de matrice de recrutement des troupes coloniales. Jusqu’à la guerre 14-18, nombre des troupes coloniales françaises sont issus de l’ethnie des Bambara (Soudan et Mali actuel notamment), ils sont utilisés comme bataillons combattant, pour leur aptitude supposée à la violence. À l’inverse, toujours cette théorie du début du XXe siècle, les populations malgaches et indochinoises, jugées moins fiables, garnissent les usines d’armements.
La diversité sociologiques des profils découle des aspirations qu’offre l’armée aux hommes qui en garnissent les rangs.
Conclusion :
Mourir pour la France implique d’en établir les contours, les compositions d’armées, et les volontés des engagées. À cette question posée en introduction, il n’existe pas de réponse unique traversant les âges, mais une diversité de facteurs qu’ils convient de prendre en compte pour en saisir les définitions intrinsèques aux époques.
















