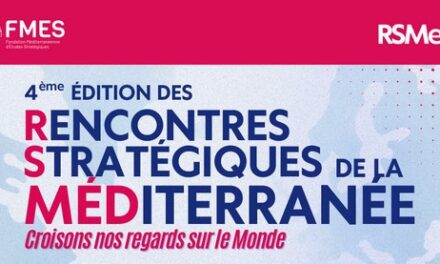Réarmement intellectuel et résilience : préparer la jeunesse française aux défis de demain, comme une évidence. Face aux bouleversements géopolitiques en cours, marqués par le retour de la force et des conflits armés à l’encontre du monde Occidental qui s’en pensait préservé, mais aussi par une montée des identités et des sentiments nationaux et par la prolifération des menaces hybrides (désinformation, cyberattaques, guerre économique, ingérence), la jeunesse devient une cible. Cette génération, hyperconnectée, confrontée à une série de crises, sanitaire, environnementale, sociétale et économique, doit affronter tous ces défis.
En France, le réarmement intellectuel et la résilience de la jeunesse, non seulement dans sa capacité à tenir face aux chocs, mais également à valoriser l’esprit critique, la culture stratégique et à comprendre les évolutions du monde avec lucidité, sont dès lors primordiaux pour gagner la bataille des idées. Une table-ronde riche des ces RSMED 2025 ayant à coeur de s’intéresser aux jeunes.
Modérateur
Gildas Leprince (Mister Géopolitix), créateur de contenu géopolitique depuis 9 ans sur YouTube, TikTok et Instagram, où il vulgarise des sujets stratégiques pour plus de 70% de moins de 40 ans.
Intervenants
- Sarah M’Roivili : Étudiante en master 2 à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et responsable du comité Afrique des Jeunes IHEDN, première association européenne générationnelle sur les questions de stratégie et de défense.
- Claire Daudé : Étudiante en deuxième année à Sciences Po Paris, campus de Menton (Méditerranée-Moyen-Orient), 17 ans, engagée dans l’association «Des Territoires aux Grandes Écoles» et sur les questions de justice climatique.
- Muriel Domenach : Magistrate à la Cour des comptes, ancienne ambassadrice de France auprès de l’OTAN (2019-2024), ex-déléguée interministérielle à la prévention de la radicalisation, fondatrice de l’initiative citoyenne «Fraternité générale – Parlons Stratégie».
- Youssef Halaoua : Directeur du campus méditerranée Moyen-Orient de Sciences Po à Menton depuis deux ans, précédemment chef de cabinet du directeur de Sciences Po Paris et cadre au sein du comité Paris 2024.
Dans une salle bien remplie, la table ronde s’ouvre sur un parti pris affiché : pas d’experts qui monopolisent la parole pendant dix minutes, mais un échange ouvert où les questions du public pourront s’intégrer au fur et à mesure. Cette volonté d’horizontalité reflète déjà l’esprit du débat : comprendre comment une jeunesse plurielle fait face aux défis d’un monde en recomposition.
Portraits croisés – Quand la jeunesse rencontre l’expérience
Gildas Leprince ouvre le bal en invitant chaque intervenant à se présenter et à expliciter son lien avec la jeunesse. L’exercice révèle immédiatement la diversité des profils réunis autour de la table.
Le créateur face à 70% de moins de 40 ans
À 34 ans, Gildas Leprince produit depuis neuf ans des vidéos de vulgarisation géopolitique, se rendant sur le terrain pour rendre accessibles des sujets complexes. Son audience ? 70% de moins de 40 ans, majoritairement française, mais avec 30% de francophones d’Afrique de l’Ouest, du bassin méditerranéen et d’autres pays francophones. Qu’il parte en Ukraine, suive des unités de l’OTAN le long de la frontière russe, enquête sur le braconnage au Congo ou embarque sur le porte-avion Charles de Gaulle, sa démarche reste identique : parler à des gens qui s’intéressent sans être experts. Ce dialogue permanent avec la jeunesse lui confère une connaissance fine de ses questionnements, de ses codes, de ses attentes.
L’étudiante au cœur des réseaux
Sarah M’Roivili porte elle-même cette double casquette de jeune et de passeur. Étudiante en master 2, elle dirige le comité Afrique des Jeunes IHEDN, association qui revendique le titre de première organisation européenne générationnelle consacrée aux questions stratégiques. L’ADN de la structure ? Créer une plateforme d’engagement où étudiants, jeunes actifs et jeunes professionnels organisent visites, conférences, publications, veille stratégique. L’objectif n’est pas seulement d’informer, mais de mobiliser une communauté sur des sujets jugés primordiaux pour tous.
La benjamine porte-voix du rural
Claire Daudé apporte une dimension radicalement différente. À 17 ans, elle est la plus jeune de la table ronde et étudie à Sciences Po Menton, campus spécialisé sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Issue d’un milieu rural du sud-ouest, elle espère porter la voix d’une jeunesse parfois oubliée dans les débats parisiens. Son engagement prend deux formes : d’une part, l’association « Des Territoires aux Grandes Écoles », qui aide les lycéens de tous milieux à ne pas s’autocensurer, organise du mentorat et des concours d’éloquence. D’autre part, un intérêt marqué pour la justice climatique et la perception qu’ont les jeunes de l’environnement. Son profil illustre la diversité socio-économique d’une génération trop souvent réduite à des stéréotypes urbains et privilégiés.
La diplomate au parcours sécuritaire
Muriel Domenach, 52 ans, apporte le poids de l’expérience institutionnelle. Haute fonctionnaire au parcours essentiellement consacré aux affaires de sécurité, elle a servi dans la filière stratégique du Quai d’Orsay, traitant longuement de la menace russe et du terrorisme. Consule générale à Istanbul entre 2013 et 2016, elle a été confrontée à des jeunes Français rejoignant le théâtre syro-irakien pour y faire le djihad. Cette mission l’a conduite à devenir déléguée interministérielle pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation à Paris, puis ambassadrice auprès de l’OTAN entre 2019 et 2024. Aujourd’hui magistrate à la Cour des comptes sur la transition écologique, elle s’investit dans des actions citoyennes via l’association « Fraternité générale » et son initiative #ParlonsStratégie formellement lancée aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois cette année.
Son rapport à la jeunesse ? Une conviction : « La force d’une nation ne réside pas dans celle de ses murailles ni dans celle de ses vaisseaux », rappelle-t-elle en citant Thucydide, « mais dans le caractère de ses citoyens. » Elle insiste : les jeunes sont les contribuables et citoyens de demain, et ils doivent comprendre pourquoi on doit réarmer. Elle ajoute avoir trois enfants de 19, 17 et 13 ans avec lesquels elle entretient un dialogue exigeant sur la nature des menaces.
Le directeur d’un «laboratoire de paix»
Youssef Halaoua, directeur du campus méditerranée Moyen-Orient de Sciences Po à Menton depuis deux ans, apporte la perspective institutionnelle de l’enseignement supérieur. Ancien étudiant de ce même campus entre 2006 et 2008, il a ensuite œuvré au comité de candidature Paris 2024, puis comme chef de cabinet du directeur de Sciences Po Paris, avant de rejoindre l’Agence nationale du sport. Son retour à Menton marque un engagement personnel : diriger un lieu où 400 étudiants de 65 nationalités cohabitent. Les six premières nationalités étrangères représentées cette année ? États-Unis, Italie, Royaume-Uni, Espagne, Roumanie, Bulgarie, Turquie. Au quotidien, entouré de ce collectif étudiant multiculturel, il exerce pleinement sa mission. Le campus fête d’ailleurs son 20e anniversaire cette année, créé en 2005 avec une vision : faire de Menton un lieu de formation des futurs artisans de la paix méditerranéenne.
Cette première séquence de présentations dévoile la richesse du dialogue à venir : une jeunesse en prise directe avec les réseaux sociaux, des parcours institutionnels lourds de responsabilités sécuritaires, une diversité générationnelle et sociale qui promet des regards croisés féconds.
Cartographie des défis – Une jeunesse, des combats
Gildas Leprince pose la question centrale : le titre même de la table ronde sous-entend-il qu’on n’est pas prêt aujourd’hui ? Et surtout, quels sont les grands défis actuels et ceux de demain qui attendent cette jeunesse ? La désinformation à cette ampleur, la guerre hybride, le dérèglement climatique aux conséquences géopolitiques, la menace russe : autant d’enjeux qui n’existaient pas, ou pas sous cette forme, par le passé.
L’inventaire des menaces et des inquiétudes
Sarah M’Roivili ouvre le feu en évoquant la désinformation, mais aussi le manque d’information. La jeunesse n’est pas toujours formée aux enjeux évoqués. Elle rappelle les débats du matin même : le monde est en recomposition face à une grande crise multiforme. L’enjeu environnemental, pour elle, reste également primordial.
Claire Daudé poursuit en soulignant que certains sujets touchent tous les jeunes : l’environnement, la guerre sous toutes ses formes — cyber, hybride, physique. Puis elle lâche une statistique qui fait froid dans le dos : en France, 20% des jeunes de 17 ans ont déjà souffert de troubles d’anxiété ou de dépression, et environ 8% ont déjà fait des tentatives de suicide1. À une échelle individuelle, la santé mentale constitue un défi qui s’ajoute à tout le reste.
La menace structurante : la Russie
Muriel Domenach prend alors la parole avec une clarté tranchante : « Menace la Russie, c’est la menace structurante. » Elle rappelle une citation de Julien Freund : « C’est l’ennemi qui vous désigne. Les pacifistes souvent n’ont pas d’ennemis parce qu’ils ne s’en veulent pas. C’est l’ennemi qui vous désigne. » L’autre menace ? Le terrorisme, avant tout islamiste, mais aussi un terrorisme d’extrême droite en montée en puissance en France.
Au-delà des menaces, elle identifie des défis : la polarisation de la société, la crise de la démocratie et du libéralisme économique, du libre-échange — autrement dit, la crise des piliers qui ont été ceux de notre développement et de notre prospérité. Le tout travaillé par les effets du changement climatique et l’anxiété que cela génère, particulièrement chez les jeunes.
La définition stratégique de la menace
Muriel Domenach apporte une précision capitale : « Une menace au sens stratégique, c’est la conjugaison d’une capacité et d’une intention. » C’est ainsi qu’on définit une menace, notamment au sein de l’OTAN. Dans le concept stratégique négocié et publié en 2022, deux menaces sont agréées : la Russie et le terrorisme. Cela ne signifie pas que le réchauffement climatique n’est pas menaçant, ni qu’il n’y a pas un défi chinois. Mais une menace, au sens de la guerre, c’est cela : capacité plus intention.
Or il est important de ne pas renoncer aux faits, insiste-t-elle. Il y a une objectivation du coût de l’inaction, par exemple en matière climatique. Mais cela ne menace pas nécessairement notre intégrité physique de la même manière qu’une agression militaire.
Gildas Leprince synthétise : peu importe les sujets, il y a un trait commun qui se dessine autour de la culture de l’information, de la nuance, de la capacité à débattre, de la capacité à être d’accord malgré les différences.
La bataille de l’information – Naviguer dans le chaos numérique
Si un consensus émerge, c’est bien celui-ci : l’accès à l’information, sa qualité, sa véracité, constituent le défi transversal à tous les autres. Gildas Leprince s’engage alors dans un décryptage du paysage informationnel dans lequel baigne la jeunesse.
Les bulles algorithmiques : mécanisme et conséquences
Gildas commence par expliquer comment fonctionnent les plateformes : faire en sorte que quelqu’un qui arrive passe le plus de temps possible. Plus de temps signifie plus de publicité, donc plus d’argent. Cette logique marketing n’est pas nouvelle, mais l’échelle et le domaine d’application posent problème.
Quand il s’agit de musique, pas de souci. Mais quand il s’agit de politique et de se construire une vision réaliste du monde, ça devient problématique. L’algorithme ne fonctionne pas en présentant des points de vue contradictoires. Il enferme. Le nombre d’informations que les algorithmes récupèrent pour comprendre le comportement humain est stupéfiant. Les machines, avec tout ce recul de données, construisent des schémas de pensée.
Le dilemme mortel de la fréquence
Gildas aborde un point qu’il qualifie de «mortel» pour les créateurs de contenu. Les plateformes utilisent des critères pour savoir si un contenu va être suggéré à de nouvelles personnes : le taux de rétention et surtout la régularité de publication. Ce dernier critère est un poison pour ceux qui veulent faire de l’information de qualité.
Il prend un exemple : quelqu’un qui part sur le terrain, qui prend du temps, qui donne la parole aux experts et qui fait trois vidéos, versus quelqu’un qui reste chez lui et publie trois vidéos par jour. Ce dernier revient avec 100 000 abonnés alors que l’autre en a à peine 5 000. Cette question de la fréquence crée une spirale où tout le monde doit suivre très vite, empêchant le recul, le jugement critique, les vidéos qui arrivent dix jours après un événement pour expliquer en profondeur.
Les jeunes ont accès à beaucoup plus de points d’information que leurs aînés. Simplement, il y a certaines formes de journalisme qui permettent de faire des liens logiques qui permettent la construction de réflexions profondes. C’est cela qui manque. Tout le système est construit pour qu’il y ait un hamster dans sa roue qui doit aller vite, et ce n’est pas compatible avec de l’information sur des enjeux de plus en plus complexes.
Typologie de la désinformation : une grille indispensable
Comment faire prendre conscience à la jeunesse de la manipulation de l’information à laquelle elle est soumise ? Gildas raconte une anecdote révélatrice. Dans un lycée prioritaire à Eschirolles, un jeune demande : «Madame, c’est quoi une fake news ?» Elle répond : «C’est quand une information est mauvaise». Aujourd’hui, il faut aller beaucoup plus loin.
Il faut que tous les jeunes sachent qu’il existe différents types d’informations fausses ou trompeuses. Comment peut-on falsifier une information ? Il existe une gradation : de la simple petite erreur journalistique où le titre est un peu mensonger, jusqu’à la désinformation pure et dure fabriquée par des pays étrangers qui ont pour objectif de nuire.
Des journalistes ont travaillé cette gradation, notamment Claire Wardle qui travaille pour First Draft News aux États-Unis. Avoir une structure mentale claire sur comment on peut être trompé est la meilleure manière pour que les jeunes puissent nager par eux-mêmes. Sous prétexte qu’un enfant pourrait se noyer dans l’eau, on ne va pas l’empêcher d’aller dans l’eau. On va lui apprendre à nager. C’est pareil sur les réseaux sociaux.
Il sait que l’Éducation nationale a rajouté des modules autour de la désinformation. Le problème, c’est que ça ne va pas à la vitesse de ce qui se passe sur internet. D’où l’avantage des créateurs indépendants qui peuvent travailler là-dessus en complément des professeurs.
Surinformation et absence de recul
Sarah M’Roivili rebondit sur la question de l’information et de la nuance. Sur les réseaux sociaux, à cause des bulles algorithmiques, on a tendance à toujours avoir les mêmes choses. On n’est pas encouragé à aller voir ailleurs. Pour elle, ce qui est primordial, c’est d’aller sur le terrain, d’en parler directement avec ceux qui savent.
Des initiatives d’associations comme les Jeunes IHEDN offrent des opportunités d’aller au contact. En mai dernier, le comité Afrique a visité la Direction générale des relations internationales et stratégiques (DGRIS) du ministère des Armées. Sans cela, si les jeunes continuent à s’informer seulement sur les réseaux sociaux, ils vont être non seulement enfermés dans une bulle, mais en plus désensibilisés. Toute la journée on peut voir des vidéos de guerre, en Ukraine, à Gaza. Au final, on est désensibilisé.
Elle insiste : pour mobiliser la jeunesse, il faut d’abord qu’elle ait l’information, et les bonnes informations. Pour pouvoir construire sa pensée, il faut du temps. Quand on parle de menaces, il y a une notion de temps. Il y a des choses menaçantes maintenant, et des choses comme l’environnement qui sont menaçantes pour plus tard. Mais on ne peut pas être nuancé quand on n’a que de l’information en direct. On n’a pas le temps d’y réfléchir. On est obligé d’être informé, mais on ne peut pas se faire une opinion à partir de l’information directe qu’on reçoit, parce qu’on n’a pas le temps de la penser, de la réfléchir, de l’aligner avec d’autres faits.
Réarmement intellectuel – Outils et institutions
Si le diagnostic est posé, reste à identifier les leviers d’action. Comment prépare-t-on concrètement une génération aux défis qui l’attendent ? Trois dimensions émergent du débat : l’ouverture institutionnelle, la refondation pédagogique incarnée par Sciences Po, et l’impératif du terrain.
L’ouverture institutionnelle française : un tournant stratégique
Gildas Leprince observe que les institutions françaises ouvrent désormais beaucoup de portes. Les armées françaises font venir énormément de créateurs de contenu. Il a eu la chance de passer une semaine sur le porte-avion Charles de Gaulle, de suivre des unités de l’OTAN le long de la frontière russe, de monter à bord d’un avion radar.
Lors d’événements de l’OTAN réunissant des créateurs de contenu européens, ces derniers lui disaient : «Comment tu arrives à faire ce genre de vidéo ?» Il faut reconnaître qu’en France, il y a eu une vraie mentalité nouvelle : il faut qu’on ouvre nos portes. Si on veut que la jeunesse se prépare aux défis, elle doit comprendre les défis. Pour comprendre, il faut que quelqu’un les explique, avec un langage qu’elle comprend. Là-dessus, la France est en avance.
Il cite également le ministère des Affaires étrangères. Gildas a eu l’occasion de suivre le ministre des Affaires étrangères en Ukraine, de suivre le président de la République deux fois à l’étranger. Il faut que les portes continuent à s’ouvrir, car il ne doit plus y avoir de fossé entre les grandes institutions et la jeunesse.
Une spécificité française ?
Autre élément : en France, il y a une certaine propension à avoir une culture stratégique, à s’intéresser à la géopolitique, à l’actualité. Il mentionne le phénomène Hugo Décrypte. C’est un créateur de contenu colossal. Si on passe dans n’importe quelle école en France et qu’on demande aux jeunes qui s’informent sur l’actualité, la grande majorité répondra «Hugo Décrypte». Il cumule plus de 22 millions d’abonnés. Il a pu interviewer le président Zelensky ou encore le président Macron.
Ce système n’existe qu’en France. Aux États-Unis, en Italie, il y a d’autres créateurs qui informent, mais ils n’ont pas cette ampleur. Il y a vraiment une spécificité française. Il faut utiliser ces atouts pour continuer à diffuser l’information.
Le modèle Sciences Po : 150 ans après la défaite
Youssef Halaoua apporte un éclairage historique qui résonne avec l’actualité. Sciences Po a un peu plus de 150 ans. Elle a été fondée en 1872, à Paris, sous le nom d’École libre des sciences politiques. Les conditions de sa création sont intéressantes.
En 1870, les armées impériales françaises avaient subi une défaite cuisante face à la Prusse. À Paris, il y avait tout un débat : comment faire pour que ça n’arrive plus ? Émile Boutmy, journaliste et homme de lettres, a eu l’idée de refonder la formation des élites parce qu’il considérait que ces dernières avaient une grande part de responsabilité dans cette défaite militaire et intellectuelle.
Les modalités de la formation définies à l’époque restent présentes aujourd’hui. Tout d’abord, l’ouverture à l’international. L’idée était que se former entre Français n’allait pas permettre de comprendre l’autre, surtout lorsque l’autre est menaçant. Donc rester ouvert à l’international, notamment par l’apprentissage des langues étrangères.
Ensuite, l’interdisciplinarité. Quand il s’agit d’affronter un problème complexe, pouvoir s’inspirer de toutes les sciences humaines et sociales peut aider dans le cadre de la formation des élites.
Dernier exemple : être au contact des réalités de son temps, et donc confier la formation non plus exclusivement à des professeurs, mais ouvrir la salle de classe à des praticiens. Pour enseigner les finances publiques, une personne du ministère de l’Économie et des Finances. Pour enseigner des enjeux stratégiques, une personne du ministère des Armées.
Menton, campus de la paix : vivre ensemble avant de négocier ensemble
Youssef Halaoua expose la vision spécifique de Menton. Ce n’est pas juste un slogan : «Menton, campus de la paix». La menace, c’est la guerre. Le défi, c’est la paix. Dans vingt ans, si on espère que la Méditerranée connaisse des temps plus apaisés, qui donc va s’en occuper ? Où sont-ils, les Américains, les Israéliens, les Iraniens, les Égyptiens, les Libanais, les Jordaniens qui seront assis dans une salle de réunion pour s’occuper de ça ? Où sont-ils formés ?
À Menton, ils se disent qu’il est possible qu’ils en aient quelques-uns chez eux. Quand il y a eu la guerre des douze jours en juin dernier (conflit Israël-Hezbollah), ils se sont assurés que les étudiants qui pour les uns étaient à Tel Aviv, pour les autres à Téhéran, étaient en bonne santé. Quelques semaines plus tard, ces personnes viennent à Menton vivre pendant deux ans ensemble. Être ensemble en cours, faire du sport ensemble, peut-être vivre ensemble.
Si le défi c’est la paix, et qu’il faut bien qu’il y en ait qui s’en occupent, peut-être qu’aujourd’hui dans des lieux de formation comme les leurs, on arrive à les accompagner à devenir pleinement eux-mêmes, tout en laissant la place aux autres. Dans des pays comme l’Iran ou Israël, on désigne l’autre pays comme étant le diable, l’ennemi.
Quand à Menton, on se retrouve avec un camarade qui a de l’humour, les mêmes loisirs, avec qui on se dit qu’il y a du commun, peut-être que dans vingt ans, on aura pu apporter notre pierre à cet édifice.
L’après 7 octobre : responsabilité des aînés
Youssef Halaoua reviendra sur un moment difficile vécu sur le campus. On a traversé des moments compliqués à la suite du 7 octobre 2023. Il s’est écrit beaucoup de choses dans la presse. Parfois, entre la réalité sur le terrain et la manière dont certains responsables politiques, la presse s’en emparent et instrumentalisent, il y a un fossé.
Ce qu’il essayait de répondre : d’abord, un peu d’indulgence. Ce sont des jeunes, parfois mineurs. Ils commencent une nouvelle vie. Souvenons-nous, ce n’est pas évident de partir de chez soi, d’apprendre à vivre seul, de gérer toute cette mécanique du quotidien, et en plus avec des études particulièrement exigeantes. Soyons indulgents parce que ce sont des jeunes, voire très jeunes, entre seize et dix-neuf ans.
Et puis, quand on allume sa télévision, quand on voit les extraits de vidéos de l’exemple que donnent les aînés à l’Assemblée nationale ou des responsables de partis politiques sur cette question du conflit au Proche-Orient, comment peut-on après venir tomber sur la jeunesse en disant : «Et alors l’esprit de nuance ? Et alors, pourquoi on ne garde pas son calme ?»
Il évoque des figures politiques du passé. Quand on regarde certaines vidéos du général de Gaulle, de certains responsables politiques des années soixante-dix ou quatre-vingt, ça donne envie d’ouvrir un livre, d’ouvrir un dictionnaire et de s’élever l’esprit. Aujourd’hui, il y a une forte responsabilité des aînés, de l’exemple qu’on donne, notamment dans la manière dont sont tenus les débats.
Le terrain comme école : initiatives associatives
Sarah M’Roivili insiste : avant de demander si les jeunes s’engageraient, il faudrait leur dire pourquoi. On ne veut pas demander à des jeunes de s’investir dans quelque chose qu’ils ne comprennent pas. On revient toujours sur le même sujet : les jeunes ont besoin de comprendre pourquoi et dans quelle mesure ils pourraient s’investir, que ce soit militairement ou autrement.
Elle rappelle l’importance des initiatives comme les Jeunes IHEDN. Elle ne pense pas que le service militaire tel qu’il a été autrefois en France soit aujourd’hui vraiment d’actualité. Le SNU était une version plus «soft». Effectivement, il faut qu’au cours du parcours défense des jeunes, ce soit un peu plus appuyé et qu’on leur fasse comprendre ce qu’ils pourraient faire.
Dans le fait de réarmer intellectuellement les jeunes, elle n’aurait pas envie de s’engager si elle ne savait pas pourquoi. Pour énormément de jeunes aujourd’hui, tout ça est un peu abstrait. Ils ne savent pas comment ça fonctionne, les institutions. Ils n’arrivent pas à le matérialiser parce qu’ils ne le voient pas.
Il est primordial qu’on puisse faire des ponts entre les jeunes et les institutions, les jeunes et le militaire, les jeunes et la défense. On parle de consentement, mais le consentement n’est valide que quand il est éclairé. On ne peut pas leur demander d’aller dans quelque chose qu’ils ne connaissent pas.
Avant d’arriver à cet engagement qui est vraiment primordial, il faut faire des communautés, des plateformes d’échange entre jeunes. D’abord, il faut leur montrer ce que c’est, donc créer des contacts entre les institutions et la jeunesse.
Le consentement démocratique à l’épreuve
La question du consentement traverse tout le débat comme un fil rouge. Si la France venait à être entraînée dans un conflit, les jeunes seraient-ils prêts ? Comment réagiraient-ils ?
Le témoignage de Dmytro Kouléba : le test estonien
Youssef Halaoua raconte un moment qu’il qualifie d’immense chance. En avril 2024, le campus de Sciences Po à Menton a accueilli Dmytro Kouléba, qui a été auprès du président Zelensky ministre des Affaires étrangères pendant quatre ans, de 2020 à 2024. Il ne l’était plus depuis le 3 septembre 20242. C’est lui qui a vécu au côté du président ukrainien les noires journées de février 2022, l’invasion, le début de la guerre.
Il a donné une conférence. Quelqu’un lui a posé la question sur, du point de vue ukrainien, que pouvez-vous nous dire sur l’avenir de l’OTAN ?
Monsieur Kouléba a fait le lien avec la nature des régimes politiques dans les pays, en disant que le consentement, par définition, n’est pas du tout le même dans un pays où les élites politiques sont fonction des suffrages ou dans les régimes autocratiques.
Le poids de la question
Il a donné un exemple très précis : «Vous savez, la Russie ne se risquerait pas à envoyer des drones sur la tour Eiffel. Ce sera beaucoup plus subtil que ça. Et la question qui vous sera demandée, à laquelle il vous sera demandé de répondre, elle sera bien plus difficile. Et je vous souhaite que vous n’ayez pas à y répondre, mais tous les signaux me conduisent à dire que vous devrez y répondre, comme nous en Ukraine on a dû y répondre alors que ce n’était pas prévu en février 2022.»
L’Estonie comme la France sont membres de l’OTAN. Imaginez-vous un jour, vous vous réveillez et vous voyez sur les réseaux sociaux un acte absolument atroce qui a eu lieu sur un soldat estonien, et tout porte à croire que c’est la Russie qui est derrière cet assassinat. La clause de solidarité voudrait que, ça y est, la guerre est déclenchée et la France entre en conflit armé contre la Russie.
Le poids décisif du consentement
Sur cette question du consentement démocratique de la population française, il a regardé la salle et il a dit : «Je demande à chacun et chacune d’entre nous, vous avez un ami qui est soldat et qui serait de ce fait mobilisé pour être envoyé dans un pays qui semble lointain depuis Menton, dans lequel vous n’êtes certainement jamais allé, qui est stratégiquement pour la France pas très important, petit, en plus à l’époque ça faisait partie de l’URSS, les gens là-bas parlent russe. Est-ce que vous seriez prêt à laisser votre camarade partir au risque qu’il ne revienne pas, ou est-ce que vous vous diriez pas plutôt : après tout, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce qu’on ne peut pas encore négocier ?»
Et bien, l’avenir de l’OTAN dépend de cette réponse à cette question. Il y a eu un silence. C’est la question que posent les Ukrainiens : est-ce que vous êtes prêts à y aller comme nous on n’a pas le choix, ou bien est-ce que ça va encore tergiverser ?
Dans les régimes démocratiques, il y a des opinions publiques à préparer. Et s’il n’y a pas de consentement du parlement ou de la population, c’est plus compliqué pour les dirigeants de s’engager dans des aventures aussi périlleuses.
Réflexions de Muriel Domenach : Ukraine, Russie et biais de projection
Muriel Domenach réagit avec émotion. Elle a commencé sa vie professionnelle en Ukraine. Ce qu’elle a vu au cours des années qui ont précédé la révolution de Maïdan en 2014, c’est une divergence profonde des sociétés russe et ukrainienne. Il y a eu vraiment des aspirations démocratiques au sein de la société ukrainienne. La société ukrainienne a gagné ses épreuves de force face au pouvoir, là où la Russie en perdait de plus en plus.
La société ukrainienne s’est profondément démocratisée. Ses amis ukrainiens se demandaient comment ils allaient réagir en cas de guerre, justement. Jusqu’au 24 février 2022, on ne voulait surtout pas donner du crédit aux rumeurs de guerre. C’était aussi pour protéger sa société, ce qui n’a pas empêché les autorités de préparer la résilience de la société.
Forces morales de systèmes opposés
Il s’est avéré que c’est la force morale de la société qui leur a permis de tenir. Cela révèle ce qu’on appelle le biais de projection affective. C’est-à-dire qu’on ne sait pas comment réagit une société en cas de guerre. Le discours pessimiste sur notre société, elle ne dit pas qu’on se trompe à 100%, mais profondément, on ne sait pas. Les Ukrainiens eux-mêmes ne savaient pas. On s’est aperçu que finalement la démocratisation de la société a été un levier.
À contrario, les régimes autoritaires ont d’immenses dysfonctionnements. Poutine était convaincu que les forces russes entreraient dans Kiev très facilement, qu’elles prendraient Kiev si facilement qu’il n’envoyait que des unités légèrement armées, qui ont été sorties très facilement. Staline n’a pas voulu donner crédit aux informations selon lesquelles l’Allemagne allait attaquer l’URSS. Les régimes autoritaires ne fonctionnent pas de manière si efficace que ça.
Sur le pessimisme sociétal, elle trouve que premièrement, ça donne le point à l’adversaire. Deuxièmement, en fait, on ne sait pas. Et troisièmement, elle est pour ni-ni. C’est-à-dire ni le déni face à nos forces et nos faiblesses, mais pas la panique non plus en disant «on n’est plus prêt, tout est foutu», parce qu’en fait, c’est autoréalisateur, la panique.
Service national universel et engagement effectif
Un militaire dans la salle prend la parole. Il rappelle avoir formé et mis au combat un certain nombre de jeunes. On se bat pour son pays. Il ne faut juste pas oublier que la fierté d’être français, ce n’est pas un gros mot, encore dans le cadre européen, dans le cadre de toutes les valeurs que nous défendons. Mais si ça n’est pas expliqué aux jeunes par leurs parents, par les systèmes éducatifs, le jour où ils vont se retrouver dans une situation qualifiée, ils ne l’auront pas entendu.
Il constate qu’en 2025, on a recruté 15 000 jeunes dans l’armée de terre. Ces 15 000 jeunes femmes et jeunes hommes sont venus parce qu’il y avait quelque chose pour eux. Il y avait une petite lumière qui était allumée. Cette fierté, ce sens de défendre ses valeurs, comment on fait passer ce sens au XXIe siècle ?
Muriel Domenach rebondit immédiatement. Elle est tout à fait d’accord. La différence entre une menace et un défi, entre la Russie et le changement climatique, c’est que la Russie nous attaque comme Français, elle attaque notre pays. Les attentats de 2015, la France était attaquée en tant que telle. Donc on doit se défendre en tant que tel aussi.
Elle intervient beaucoup dans les lycées avec l’association des profs d’histoire-géo. Elle est vraiment encouragée par la qualité de l’investissement des profs et la fierté d’être français qu’ils transmettent, y compris dans des zones difficiles. C’est la responsabilité des institutions d’ouvrir et de l’école d’accueillir aussi des militaires, d’accueillir ceux qui ont la fierté du drapeau.
Le conflit déjà là : on ne demandera pas le consentement
Une intervention vient d’un représentant de FMS (Fondation méditerranéenne d’études stratégiques). Il ne pense pas qu’on se trouve demain dans une configuration d’une forme de guerre qui appelle un consentement généralisé de la jeunesse. D’ailleurs, c’est sans doute pour ça qu’il n’y a plus aujourd’hui de service militaire obligatoire.
En revanche, il y a aujourd’hui déjà des formes de consentement anticipées par l’engagement dans la réserve. Mais on ne demandera pas aux jeunes s’ils consentent au conflit lorsque le conflit va arriver. Ils le subiront forcément, les jeunes comme les anciens, et ils le subissent déjà par tout ce qu’on a dit autour de la désinformation. Ce qui est difficile à prévoir, ce sont les formes que vont prendre ce conflit. C’est là qu’on verra comment la jeunesse réagira. On ne demandera pas de consentir à une chose qui va arriver et il faudra réagir.
Sarah M’Roivili rappelle un point important avant de conclure cette section. Il faut rappeler qu’il y a des jeunes qui s’engagent. Parfois, on a parlé de la jeunesse aujourd’hui comme une cible. Il faut informer la jeunesse, il faut aider la jeunesse. Mais la jeunesse, c’est avant tout une force de proposition et c’est avant tout un acteur dans toutes les crises. C’est important de rappeler que sur tous les fronts, les jeunes s’engagent et c’est important de ne pas l’oublier, de ne pas les voir juste comme une cible. Il y a plusieurs jeunesses et il y a une jeunesse qui s’engage et qui le fait tous les jours.
Transmission et responsabilité collective
Au-delà des mécanismes institutionnels et des débats stratégiques, une question traverse en filigrane toute la table ronde : quelle responsabilité portent les générations précédentes dans la préparation de la jeunesse aux défis actuels ?
L’exemple des aînés en question : déclin du débat politique
Youssef Halaoua développe ce point. Ce qui est la difficulté des réseaux sociaux, c’est la facilité. C’est tellement facile de donner son avis qu’on le donne avant. Il y a vingt ans, il avait encore des enseignants qui lui disaient : «Si tu n’as pas quelque chose d’intéressant à dire, tu te tais et tu vas d’abord lire, tu prépares ton sujet, et puis quand ça participera du débat collectif, tu prendras la parole.»
Aujourd’hui, avec le confort de l’anonymat et la facilité avec laquelle on peut écrire un texte, on a le sentiment d’être légitime, de donner son avis sur tout. On a la possibilité de préparer un repas trois étoiles au guide Michelin sans même savoir couper des oignons. Il y a des gammes, un peu comme au sport, avant de préparer une grande compétition. Il s’agit de se former avec méthode, avec rigueur, avec persévérance, avec abnégation.
La valeur de la lecture : se plonger dans un texte de plusieurs pages, le lire, peut-être ne pas céder à la facilité de demander à l’intelligence artificielle de le résumer, et parfois c’est même en langue étrangère. Prendre la parole, construire un raisonnement, s’exprimer en des termes clairs, dans des temps contraints : voilà tout un tas de processus qui, progressivement, préparent. C’est lutter contre la facilité que permettent parfois les réseaux sociaux.
Avant de pouvoir prétendre à donner son avis de manière légitime et éclairée, il faut passer par des gammes, par une formation, par une rigueur. Et ça, c’est ce qui manque parfois dans le débat public actuel.
Fierté nationale réhabilitée : pas un gros mot
Le militaire a posé une question fondamentale : comment faire passer ce sens de la fierté d’être français au XXIe siècle ? La fierté d’être français, ce n’est pas un gros mot, encore dans le cadre européen, dans le cadre de toutes les valeurs que nous défendons.
Muriel Domenach a rebondi avec force. Elle intervient beaucoup dans les lycées dans le cadre de son initiative «Fraternité générale — Parlons Stratégie». Elle est encouragée par la qualité de l’investissement des profs et la fierté d’être français qu’ils transmettent, y compris dans des zones difficiles.
Le militaire avait rappelé : en 2025, on a recruté 15 000 jeunes dans l’armée de terre. Ces jeunes sont venus parce qu’il y avait quelque chose pour eux. Cette fierté, ce sens de défendre ses valeurs, il ne peut que souscrire à l’idée qu’il faut les transmettre dans l’éducation.
Muriel Domenach avait rappelé que la différence entre une menace et un défi, entre la Russie et le changement climatique, c’est que la Russie nous attaque comme Français, elle attaque notre pays. Les attentats de 2015, la France était attaquée en tant que telle. Donc on doit se défendre en tant que tel aussi. Ce n’est pas du chauvinisme, c’est de la lucidité stratégique.
Questions du public — Débats et nuances
Trois questions du public cristallisent les dilemmes auxquels fait face cette génération.
Environnement vs sécurité : faux dilemme ?
Une jeune femme interpelle Muriel Domenach. Elle trouve intéressant la façon dont elle a dit que finalement la menace aujourd’hui est plus sécuritaire qu’environnementale. Mais est-ce qu’on ne penserait pas que l’environnement est lié à la menace sécuritaire ? Pour les jeunes, on est dans une perte de repères généralisée. On est dans un monde où on nous demande toujours de nous réadapter. Est-ce que se concentrer sur la menace militaire, ce n’est pas un biais qui prendrait du risque ?
Muriel Domenach répond de façon personnelle. Elle entend ce qui est dit, d’autant plus qu’elle l’entend chez elle avec ses trois enfants et qu’elle travaille sur les enjeux de transition écologique à la Cour des comptes. Elle voit la réalité de ce qui nous arrive.
C’est la difficulté qui va être celle de notre génération. On va devoir faire face à la fois à une incertitude sécuritaire et à une menace qui va croissant. Si l’Ukraine ne tient pas, cette menace va bondir. C’est pour ça que le soutien à l’Ukraine, c’est un investissement dans notre sécurité.
Deux défis cruciaux
Un, on a une menace qui va croissant, donc une nécessité d’investir dans notre outil de défense. Et là, c’est maintenant. On n’est pas seuls, on a des alliés, et le réarmement de nos partenaires européens est une bonne chose.
Deux, on a un défi environnemental, à la fois en terme d’adaptation au changement climatique et en terme d’atténuation. Les deux vont exiger un investissement considérable. On a une crise de la démocratie et un enjeu d’investissement dans notre cohésion sociale. Et quatre, on a un enjeu de production pour votre génération. Il va falloir innover et produire, parce que sinon, si on n’a rien à partager, on ne va rien redistribuer.
C’est toute la difficulté de votre génération. La bonne nouvelle, c’est que vous êtes informés et on ne part pas de rien. Elle ne dirait pas c’est l’un ou c’est l’autre, c’est tout à la fois.
Comment mobiliser sans choisir ? L’esprit critique comme boussole
Un jeune homme pose une question : comment réarmer la jeunesse si elle se trompe de combat ? Certains sont gagnés par l’idéologie écologiste, d’autres par une approche religieuse islamiste. On n’a pas tous envie de mener le même combat. Avant même de se réarmer, est-ce qu’on est aligné sur nos combats ? On est obligé de prioriser pour concentrer nos efforts sur la menace. L’écologie, c’est un défi. Attention à la sémantique. Il ne parle pas d’urgence ou de catastrophisme. Ce n’est pas une urgence. Une partie de la jeunesse se concentre sur des défis qui sont d’un second ordre d’après lui, et il trouve ça dommage puisqu’on devrait être aligné sur des défis prioritaires.
La force du témoignage
Claire Daudé répond avec fermeté et clarté. La jeunesse est plurielle. Elle raconte son propre parcours : paysanne d’origine, elle vit un grand écart entre son milieu rural et Sciences Po. Une amie lui parlait d’un stage chez Dior ; elle, elle rentrait faire un stage dans une mission locale où un jeune de 16 ans lui montrait fièrement de la ferraille récupérée en forêt pour la faire fondre et gagner de l’argent. La jeunesse en France vit des réalités radicalement différentes.
Chacun priorise selon sa perspective : un fils de paysan priorisera le dérèglement climatique parce que ça le touche personnellement. Quand on parle de réarmement intellectuel, on parle d’esprit critique, de nuance. On ne peut pas dire aux jeunes : «Vous devez prioriser certains sujets.» Non, on doit dire aux jeunes : «Il y a ces sujets, on les nuance, on y réfléchit, on se fait son propre avis dessus, et après on décide qui doit prioriser.» Ce n’est pas à l’État ou aux institutions d’imposer une hiérarchie. C’est un raisonnement personnel que doit faire la jeunesse, par la jeunesse, et pour la jeunesse.
Gildas Leprince synthétise : peu importe les sujets, il y a un trait commun qui se dessine autour de la culture de l’information, de la nuance, de la capacité à débattre, de la capacité à être d’accord malgré les différences. C’est un point essentiel sur lequel il faut mettre le paquet.
Conclusion
Dans la salle Raimu de Toulon, pendant plus d’une heure vingt, cinq intervenants aux parcours radicalement différents ont dessiné les contours d’un même constat : la jeunesse française, plurielle et informée comme jamais, fait face à des défis d’une complexité inédite dans un écosystème informationnel qui complique la construction d’un jugement éclairé.
Le consensus qui émerge du débat ne porte pas sur une hiérarchie des menaces — environnement contre sécurité, dette contre terrorisme –, mais sur les outils intellectuels nécessaires pour naviguer dans cette complexité : culture des faits, esprit critique, capacité à supporter la nuance et la contradiction, exigence méthodologique, ouverture au terrain et aux institutions.
La richesse des points de vue
Si Muriel Domenach rappelle avec force que la Russie et le terrorisme constituent les menaces structurantes au sens stratégique du terme, si Gildas Leprince décrypte les mécanismes pervers des bulles algorithmiques, si Sarah M’Roivili insiste sur l’impératif du contact direct avec les experts, si Claire Daudé défend la légitimité de chaque jeune à définir ses propres priorités, et si Youssef Halaoua expose la vision d’un campus méditerranéen où futurs adversaires apprennent à vivre ensemble, tous convergent vers une même conviction : le réarmement intellectuel passe par la transmission exigeante mais bienveillante d’une méthode, pas par l’imposition d’une doctrine.
Le témoignage de Dmytro Kouléba, posant aux étudiants de Menton la question du consentement démocratique face à un conflit impliquant l’Estonie, restera comme le moment le plus saisissant de cet échange. Il cristallise l’enjeu ultime : sommes-nous prêts, non pas à affirmer des principes abstraits, mais à les défendre concrètement, au risque de perdre ceux qu’on aime ? Muriel Domenach rappelle alors le biais de projection affective : on ne sait pas comment une société réagira. Les Ukrainiens eux-mêmes ne le savaient pas avant février 2022. Mais la force morale d’une société démocratisée peut surprendre.
S’engager oui, mais pourquoi ?
La fierté d’être français, réhabilitée sans chauvinisme par le militaire présent dans la salle et confirmée par l’expérience de Muriel Domenach dans les lycées, n’est pas un gros mot. C’est la condition du consentement éclairé. Comme le dit Sarah : on ne peut pas demander à des jeunes de s’engager pour quelque chose qu’ils ne comprennent pas. Le consentement n’est valide que quand il est éclairé.
Gildas Leprince conclut sur une note d’optimisme mesuré : il y a des défis immenses, la machine algorithmique tourne à plein régime, la désinformation prolifère, mais les institutions françaises ouvrent leurs portes, des créateurs de contenu comme Hugo Décrypte touchent des millions de jeunes, des associations comme les Jeunes IHEDN créent des ponts, des campus comme Menton tentent de former les artisans de paix de demain.
Cette table ronde, par la diversité des profils réunis — de 17 à 52 ans, du milieu rural à l’OTAN, du créateur de contenu à la haute fonction publique — aura incarné ce que peut être un débat de qualité : ouvert, nuancé, exigeant, sans complaisance mais sans défaitisme. Un moment fort des Rencontres Stratégiques de la Méditerranée 2025, qui rappelle que la jeunesse n’est pas seulement une cible à informer, mais une force à mobiliser et à respecter dans sa pluralité.