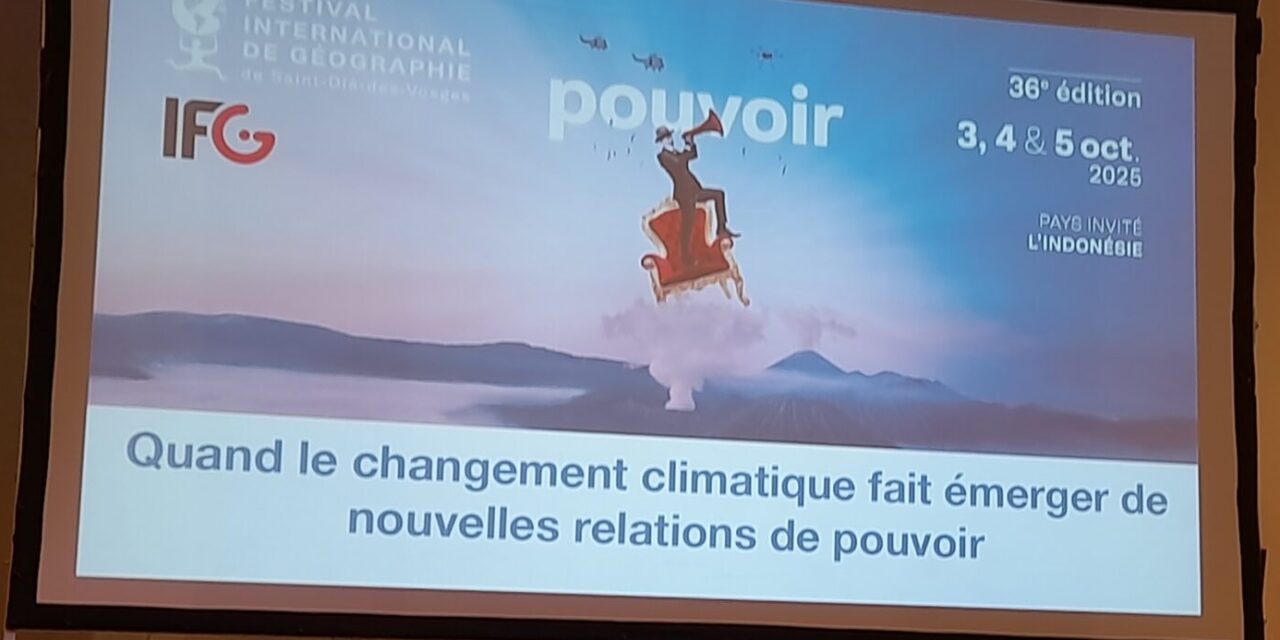La question environnementale doit-elle amener à repenser les questions de géopolitique ?
Amaël CATTARUZZA introduit la réflexion.
Les catastrophes (mégafeux, sécheresses, guerres) sont de plus en plus présentes. Quelles conséquences pour les géopoliticiens de l’Institut Français de Géopolitique ?
À quoi doit répondre la géopolitique : la guerre ou la crise environnementale ? Il faut penser les enjeux ensemble. La géopolitique doit se saisir du concept d’anthropocène ; Amaël Cattaruzza propose de parler de géopocènefootnote]Voir en complément : Géopocène. Repenser la géopolitique à l’heure de l’anthropocène[/footnote].
La géographie avance grâce aux thèses, comme le montre plusieurs exemples à propos des grands feux au CanadaD’objet de pouvoir à symbole de crise, évolution géopolitique des feux de forêt au Canada par Clara Aubonnet, les divers acteurs de la gestion forestière : une catastrophe naturelle, mais aussi humaine et géopolitique. Ou les travaux sur les mines de lithium en Serbie, refusées par la population (2021) et relancées par la Communauté européenne (2024). Ce sont des enjeux environnementaux à différentes échelles.
Les mêmes interrogations peuvent se poser à propos de la guerre en Ukraine avec les effets pour l’Afrique en matière d’accès au blé ; ou à propos des risques avec la centrale de Zaporijjia.
L’approche actuelle de la géopolitique peut-être territorialisée, c’est l’échelle pour une étude de la diversité des acteurs en jeu et des diverses formes de représentations.
Deux jeunes thésards vont confronter leurs approches et leurs résultats dans un dialogue. Justine HEYRAUD-CIOFOLO qui travaille sur la distribution de l’eau à Palerme et Robin LETERRIER qui nous emmène au Kazakhstan pour une étude de la mise sous pression de la ressource en terres arables, au nord du pays.
Quels narratifs sur la gestion de la ressource ?
Palerme
Théoriquement, la Sicile est autosuffisante en eau, mais les pertes du réseau sont énormes (52 % en moyenne) et les barrages ne peuvent être remplis totalement, faute d’entretien.
L’observation des pratiques des populations : les citernes individuelles sur le toit et la distribution illégale par camions-citernes à partir de sources privées permettent de contourner la difficulté, qui s’est accrue depuis 2 ans. Le mécontentement croît, surtout dans les quartiers périphériques où un rationnement a été mis en place. Le problème touche plus certains groupes sociaux, comme cela a été étudié pour Le Cap, en Afrique du Sud.
Se met donc en place une dialectique eau/société/pouvoir.
Kazakhstan
Au nord, il y a de très fertiles terres agricoles (sur les « terres noires », tchernoziom), longtemps le domaine d’un nomadisme pastoral. La mise en culture est récente, surtout après 1950, dans le cadre de vastes kolkhozes, avec une main-d’œuvre venue de Russie et d’Ukraine. La région produisait, au moment de la chute de l’URSS, 30 % du blé soviétique, mais sur des terres épuisées.
Après 1991, on assiste à une privatisation (en fait des baux sur 50 ans) et à la suppression de toute aide.
Aujourd’hui, le pays a l’ambition de multiplier par 3 la production d’ici 2030 sur des sols appauvris et soumis à la sécheresse.
Quelles logiques d’acteurs ?
Palerme
J. HEYRAUD-CIOFOLO évoque les acteurs : la région, une entreprise privée multinationale SICILIACQUEDétenue à 75% par Véolia et les consommateurs. Une large mobilisation citoyenne, partout en Italie, a tenté d’imposer une gestion publique de l’eau.
La contestation porte aussi, à Palerme, sur les tarifs. Malgré des condamnations en justice, la région a maintenu l’entreprise concessionnaire et soutient un projet de remise en route des unités de dessalement très polluantes, et ce malgré la critique citoyenne.
La logique entreprise/région est de temps court quand la société avance vers des solutions durables.
Kazakhstan
Robin LETERRIER décrit l’écosystème agricole privé sur de très vastes exploitations (> 10 000 ha), héritières des kolkhozes.
Après 1991, l’État a oublié le secteur agricole. Les intrants (machines, semences…) et même la recherche agronomique sont proposés par des multinationales comme Syngenta. La seule logique est productiviste, sans gestion durable de la ressource, des propositions de court terme. Il n’existe rien de comparable à l’atelier paysan de la Confédération paysanne, en France.
En Conclusion : Peut-on comparer les modes d’adaptation au changement climatique et la mobilisation des acteurs pour la gestion des biens communs : eau, sols ?
Les questions de la salle portent sur la place potentielle de la mafia dans la gestion de l’eau en Sicile : peu d’indicateurs au niveau de la ville, sans doute plus au niveau de la région ou à Agrigente.
Au Kazakhstan, pense-t-on à la rotation des cultures pour préserver les sols ? Oui, un peu depuis 10 ans, mais plus pour la recherche de nouveaux débouchés, par exemple le développement de la culture du tournesol pour des exportations vers le marché chinois : rentabilité économique sans souci de restauration des sols.
A. C.
Il existe un champ de géopolitique plutôt à l’échelle macro, mais l’IFG souhaite développer des études territorialisées car c’est le lieu de l’action, une échelle où on peut intégrer l’analyse systémique.
Est-ce que la géopolitique « classique » peut être un biais pour la prise en compte du changement climatique ? Il y a un intérêt pour l’étude sur des questions : comment les acteurs se représentent-ils le territoire, comme le disait Yves Lacoste, compte tenu des temporalités. Il y a des expériences, mais pas de généralisation.