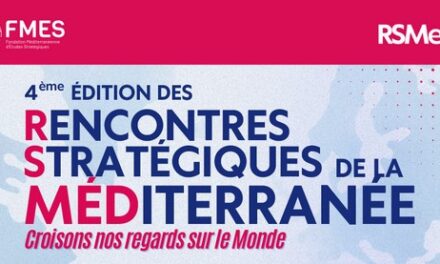Le 8 octobre 2025, dans le cadre de la 4ème édition des Rencontres Stratégiques de la Méditerranée à Toulon, une table ronde s’est penchée sur la politique intérieure américaine sous un titre évocateur : « Décrypter les États-Unis : identité, récit et intérêt au pluriel ». Face à une salle comble, Marie-Caroline Debray animait avec passion cette discussion visant à explorer les « pluriels » d’une société américaine traversée par des fractures profondes, et à déterminer dans quelle mesure ces phénomènes représentent une rupture ou une continuité dans l’histoire du pays.
Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025, les observateurs européens regardent les États-Unis avec un mélange de perplexité, d’inquiétude et de fascination. Comme le soulignait la modératrice en introduction, ce second mandat Trump a confirmé que les fractures sociales, culturelles et institutionnelles que traverse la société américaine ne sont pas de simples « turbulences passagères », mais bien « le symptôme d’une transformation durable du pays ». De ce côté-ci de l’Atlantique, il serait tentant de réduire l’Amérique à un « théâtre politique parfois sidérant mais tout à fait spectaculaire ». Pourtant, ces débats internes sur l’identité, le rôle des institutions démocratiques, la liberté d’expression ou la justice « résonnent fortement avec nos propres tensions ».
Quatre enjeux structurels
Pour cadrer les échanges, Marie-Caroline Debray a identifié quatre grands enjeux structurels qui caractérisent l’Amérique de 2025.
La polarisation et la montée de la violence politique constituent le premier axe d’analyse. L’assassinat de Charlie Kirk le 10 septembre 2025, figure montante de l’aile jeune et radicale du mouvement conservateur et cofondateur de Turning Point USA, a bouleversé la société américaine. Qualifié de « martyr américain » par Donald Trump, cet événement a cristallisé la fusion entre le religieux, l’idéologie et le politique. En parallèle, de nombreuses attaques ciblées ont visé des élus ou responsables publics américains, notamment des démocrates menacés ou agressés à différentes échelles locales. Le FBI a publié en juillet 2025 un rapport alertant sur la montée des groupes extrémistes intérieurs, y compris dans les milieux pro-Trump. Ces phénomènes révèlent l’installation d’un climat de violence politique « complètement institutionnalisé et normalisé », avec une rhétorique complotiste amplifiée par certains élus. Sur les six premiers mois de 2025, plus de 150 incidents à caractère idéologique ou partisan ont été enregistrés.
Les offensives idéologiques dans certains secteurs, particulièrement l’éducation et les armées, forment le deuxième enjeu. Plusieurs États américains, notamment la Floride et le Texas, ont multiplié les lois de censure avec l’interdiction de contenus jugés « woke » et le retrait de manuels d’histoire évoquant l’esclavage ou les droits civiques. Les récentes déclarations de Pete Hegseth, nouveau secrétaire à la Défense rebaptisé « secrétaire à la Guerre », tracent une rupture doctrinale et symbolique. Il a pris un virage culturel radical pour l’institution militaire en supprimant les programmes diversité, équité et inclusion, en instaurant des standards physiques stricts, en imposant l’interdiction des barbes et en prenant le retour de la « norme masculine la plus élevée » comme exigence en matière de conditions physiques. Ces mesures révèlent une instrumentalisation de la politique de la mémoire et des identités, ainsi qu’un durcissement idéologique dans les politiques publiques.
Les fractures économiques et le développement de la précarité composent le troisième axe. Ces derniers mois ont vu de nombreuses tensions sociales liées au coût de la vie et à la précarisation de l’emploi, notamment chez les jeunes travailleurs. Les grèves se sont multipliées dans les secteurs publics et dans de grandes entreprises comme Amazon, Starbucks et l’automobile, tandis que l’administration Trump est restée « complètement hostile à toute revalorisation du salaire minimum fédéral ».
Les réformes électorales et les entraves à la participation électorale constituent le quatrième et dernier enjeu structurel. À l’approche des élections de mi-mandat de 2026 et de la présidentielle de 2028, plusieurs États républicains, notamment le Texas, la Géorgie et la Floride, ont durci leurs lois électorales avec une réduction du vote par correspondance, la fermeture de bureaux de vote dans certains quartiers urbains et des purges massives dans les listes électorales. Ces mesures laissent présager un retour à des stratégies de « rétrécissement du corps électoral » qui ne sont pas une nouveauté dans l’histoire américaine du 20ème siècle, mais qui posent un enjeu fondamental de légitimité démocratique.
Trois expertises complémentaires
Pour décrypter ces mouvements et les logiques profondes à l’œuvre dans l’Amérique de 2025, la table ronde réunissait trois experts aux perspectives complémentaires.
Amy Greene, franco-américaine, est spécialiste de la politique américaine rattachée à l’Institut Montaigne. Ses travaux portent sur les fractures identitaires et culturelles, notamment entre l’Amérique urbaine et côtière et l’Amérique rurale et conservatrice, mais aussi sur les conflits raciaux et les récits historiques concurrents qui divisent les États-Unis. Elle s’intéresse de près aux enjeux de mémoire, aux culture wars et aux formes de polarisation de l’identité dans le débat public américain. Auteure de L’Amérique après Obama (2012), elle a récemment publié L’Amérique face à ses fractures, ouvrage finaliste du prix géopolitique 2025 de l’Institut FMES. Elle était aussi intervenue à Toulon au printemps dernier, pour une conférence sur l’ère Trump II.
Marco Scioli, professeur d’histoire des États-Unis à l’université de Milan, compte parmi les meilleurs connaisseurs européens de l’histoire politique et diplomatique américaine. Son expertise porte particulièrement sur les relations internationales, la pensée constitutionnelle et les grandes continuités de la politique étrangère des États-Unis. Il travaille notamment sur la construction de la puissance américaine, les doctrines stratégiques qui l’ont façonnée et l’évolution de l’exceptionalisme américain.
Cole Stangler, journaliste américain basé à Marseille, collabore régulièrement avec le Guardian, France 24 et The Nation. Il s’intéresse tout particulièrement aux dynamiques du monde du travail et aux fractures sociales aux États-Unis. Professeur à l’American University of the Mediterranean à Aix-en-Provence, il est l’auteur de Classe à part : aux origines de la colère américaine, dans lequel il analyse la désindustrialisation, la précarisation du travail et les effets politiques de la marginalisation des classes populaires. Plus récemment, il a publié Le miroir américain : enquête sur la radicalisation des droites et l’avenir de la gauche, où il décrypte la radicalisation des droites, la fracture culturelle, le retour du religieux, la montée en puissance des médias partisans et l’érosion de l’électorat populaire de gauche.
Une exploration en profondeur
Cette table ronde s’est articulée autour de plusieurs questions structurantes : quel événement récent cristallise le mieux les enjeux de la société américaine actuelle ? Comment les culture wars façonnent-elles la vie politique ? Quels scénarios sont envisageables pour les élections de mi-mandat de 2026 et la présidentielle de 2028 ? Quelle est la nature profonde du mouvement MAGA et du trumpisme ? Le Parti démocrate peut-il se reconstruire une identité et un projet mobilisateur ?
Des échanges riches ont permis d’explorer ces questions, révélant des analyses convergentes sur certains constats – la violence politique institutionnalisée, le rôle central des évangéliques, la séparation géographique croissante – tout en offrant des perspectives différenciées selon les expertises des intervenants. Amy Greene a apporté une lecture fine des fractures identitaires et générationnelles, Cole Stangler a mis en lumière les dimensions autoritaires de l’administration Trump et le rôle des médias conservateurs, tandis que Marco Scioli a rappelé les continuités historiques et exprimé une forme d’optimisme sur la résilience américaine.
Cette synthèse éditorialisée de ces échanges, organisée autour de six grands axes : l’assassinat de Charlie Kirk comme révélateur des fractures américaines ; le déploiement militaire sur le sol américain ; les culture wars comme moteur de la polarisation ; les fractures socio-économiques invisibles ; les menaces pesant sur la démocratie ; et enfin, les perspectives pour l’avenir politique du pays. Si quelques soucis techniques sont venus troubler parfois cette table-ronde, elle n’en a pas moins été un excellent moment de réflexion.
Je proposerai en conclusion quelques pistes pédagogiques pour une exploitation avec des élèves, en HGGSP et EMC.
I – L’assassinat de Charlie Kirk : cristallisation des fractures américaines
Un événement révélateur de la violence politique institutionnalisée
Lorsque Marie-Caroline Debray a demandé aux intervenants quel événement récent cristallisait le mieux les enjeux de la société américaine actuelle, Amy Greene a immédiatement choisi le meurtre de Charlie Kirk. Pour elle, cet assassinat représente « une prolongation, une continuité finalement de cet élan de violence politique aux États-Unis qui n’est pas nouveau non plus depuis longtemps ». Si les États-Unis ont des antécédents de violence en politique, avec même des assassinats de présidents, il existe néanmoins un pic de violence contemporain. Amy Greene fait état dans son livre d’une violence exercée ou de menaces proférées à l’égard des élus, « pas uniquement des élus très visibles médiatiquement mais des élus à l’échelle plutôt locale », qui a commencé à se réinstaller dès 2017 avec un taux de menaces contre les représentants à la Chambre des représentants qui a bondi de 1000%.
La séquence de 2025 s’inscrit dans cette dynamique. Quelques mois seulement avant l’assassinat de Charlie Kirk, une élue démocrate du Minnesota a été assassinée dans son domicile avec son mari, avec également une tentative sur d’autres élus démocrates dans le même État. Puis, le 10 septembre, le meurtre de Charlie Kirk, activiste très conservateur. Amy Greene prend cet événement parce qu’il « englobe un certain nombre de phénomènes en cours aux États-Unis » et s’avère « très révélateur ».
Violence « d’en haut » et violence « d’en bas »
Pour l’experte de l’Institut Montaigne, cet élan de violence révèle « une forme d’acceptation du geste violent en politique avec des minorités très importantes d’Américains qui considèrent que la violence est légitime et justifiée pour régler des comptes politiques ». Cela se déroule dans un climat, un écosystème où l’on a « de plus en plus tendance à voir notre opposition politique comme un véritable ennemi, voire une menace existentielle ». Or, comme le souligne Amy Greene, « à partir du moment où vous construisez votre opposition en menace à votre propre existence, la violence ne peut jamais être très très loin comme possibilité, en tout cas dans le champ des possibles ».
Les réactions à l’assassinat révèlent ce qu’Amy Greene nomme, avec une formule qu’elle utilise avec précaution, la violence « d’en haut mais aussi d’en bas ». D’une part, on voit des leaders politiques qui « attisent, qui utilisent même, qui placent au cœur de leur proposition politique des propos violents à l’égard de tout types de personnes ». On est sorti d’un cadre de comportement irréprochable des dirigeants, qui « monétisent en quelque sorte les fractures existantes et cette justement cette perception de l’autre comme l’ennemi », alimentant cette culture.
D’autre part, dans cet élan de violence « d’en bas », quelqu’un a décidé de tirer sur Charlie Kirk, voulant « lui-même régler son différent avec Charlie Kirk qu’il ne connaissait visiblement pas ». Les réactions sur les réseaux sociaux ont été très différentes. On a vu « de la jubilation, de la célébration », des justifications arguant que « c’est quelqu’un qui a tenu des propos haineux et donc finalement on ne peut pas déplorer sa mort parce que finalement ce n’est qu’une conséquence de la haine qu’il a semée pendant sa vie, de ses positions, etc. »
Certes, globalement, dans la classe politique, il y a eu « des condamnations unanimes sans équivoque de cet acte de violence politique ». Mais en même temps, on constate « l’incapacité des institutions, des élus à éteindre cette violence », certains étant « parties prenantes justement de ces phénomènes », et « évidemment la population qui considère de plus en plus que ce sont des possibilités tout à fait légitimes ».
Une fracture générationnelle inquiétante
Le meurtre a également révélé une fracture générationnelle. Amy Greene s’est intéressée aux réactions sur les réseaux sociaux, ce qui permet « de voir un peu ces choses-là ». Elle constate que « plus les Américains étaient un peu plus âgés, plus ils considéraient que ce n’est pas du tout acceptable, soit c’est toujours inacceptable ou souvent inacceptable de célébrer la mort de son adversaire. Mais plus vous descendez dans les jeunes générations, plus vous voyez une acceptation de ce type de réaction ».
Cette fracture est révélatrice. Les Américains plus âgés « ont vécu les cours de civisme, ils ont vécu l’expérience politique dans une période peut-être polarisée, mais en même temps moins ». Ils ont donc « l’expérience de se confronter à la différence, de regarder droit dans les yeux son adversaire, de dire ‘Je ne suis pas d’accord avec vous, voici pourquoi, je vous écoute’, etc. ». À l’inverse, « on envoie une jeune génération sur les réseaux sociaux sans formation civique et en fait, ils expérimentent la citoyenneté dans ces espaces clos, fermés, éloignés de l’autre et donc finalement ça peut participer à l’explication de ça ». Pour Amy Greene, « on va vers une tendance de plus en plus macabre et cet acte en tout cas résume un certain nombre de fractures très apparentes aux États-Unis ».
La fusion du religieux et du politique : l’anecdote des obsèques
Si l’assassinat de Charlie Kirk cristallise les fractures américaines, c’est aussi parce qu’il révèle la fusion entre le religieux, l’idéologique et le politique. Cole Stangler, dans ses réponses aux questions du public en fin de table ronde, a développé l’importance du fait religieux dans le monde MAGA, illustrée par un moment particulièrement révélateur : les obsèques de Charlie Kirk.
Le journaliste rappelle d’abord le paradoxe apparent : « Donald Trump, il a très peu de… c’est pas un chrétien, un bon chrétien, on va dire ». Pour « le dire de manière diplomate », Trump s’est divorcé, « il a acheté le silence d’une actrice porno, etc. Donc bon, d’un point de vue chrétien, c’est pas le bon, l’idéal ». Pourtant, « ce qui est très important à comprendre dans le monde MAGA », et Cole Stangler l’a « vu avec ses propres yeux en reportage » en parlant « avec des républicains sur le terrain dans des bastions d’évangéliques », c’est qu’ils « considèrent Donald Trump comme une sorte de roi David, de personnage biblique ».
Le roi David était « certes pas un très bon [chrétien], qui péchait, qui avait ses excès, mais qui était quand même celui qui dirigeait son peuple ». Et Trump a « joué sur cet aspect, il a joué ce personnage ». L’anecdote des obsèques illustre parfaitement ce mécanisme. Cole Stangler la raconte comme un « moment très puissant » : « Il y a la veuve de Charlie Kirk qui prend la parole et dans un moment vraiment très puissant, elle dit ‘Je pardonne le tueur' ». C’est « un exemple vraiment de ce que c’est finalement bon d’être chrétien ». Mais juste après, « Donald Trump prend la parole et il dit : ‘Bon, je suis pas d’accord malheureusement avec vous, moi je déteste mes adversaires' ».
Cette déclaration peut sembler « assez choquante » et « paradoxale », mais « en même temps dans le monde MAGA, Trump il est dans son rôle, c’est le roi David ». C’est pourquoi Cole Stangler insiste tant sur la religion : « Pour comprendre ce monde MAGA, Make America Great Again, il faut comprendre l’importance de ces… du fait religieux qui est vraiment le ciment de cette coalition ». Marie-Caroline Debray résume : « Cristallisation du religieux et du politique ».
Récupération politique et instrumentalisation
L’assassinat de Charlie Kirk ne s’est pas arrêté aux condamnations unanimes de la classe politique. Comme l’a noté Amy Greene, les réactions sur les réseaux sociaux ont été très polarisées, avec des célébrations de sa mort par certains, qui ont justifié le meurtre par les positions qu’il avait tenues. Cette récupération a fonctionné dans les deux sens.
Du côté de l’administration Trump, la mort de Charlie Kirk a été instrumentalisée. L’influenceur pro-Trump a été qualifié de « martyr américain » par le président. Des dizaines de personnes ont été licenciées après avoir publié sur les réseaux sociaux des messages critiquant Charlie Kirk. Pete Hegseth, le secrétaire à la Guerre, a même ordonné à ses services d’identifier tout membre de l’armée qui se serait moqué ou réjoui de l’assassinat de cette figure de l’Amérique chrétienne et traditionaliste.
Cette séquence s’inscrit dans un contexte plus large de violence politique institutionnalisée, où l’assassinat devient non seulement un acte individuel mais aussi un instrument de polarisation et de mobilisation politique. La violence se banalise, se normalise, devient une « affaire d’État » instrumentalisée par le pouvoir pour identifier et cibler ses adversaires politiques.
Marco Scioli, de son côté, a choisi un autre exemple pour illustrer cette violence : la maison d’un juge de Caroline du Sud qui a été brûlée parce qu’il avait jugé contre l’administration Trump. Lors d’un long voyage qu’il a effectué l’année dernière du nord vers le sud de la Caroline, il a noté « cette grande fracture entre deux parties », d’un côté « ce qui représente la suprématie blanche, les républicains en rouge avec leur casquette rouge également », de l’autre « le parti démocrate qui porte des valeurs bien exprimées par l’administration de Joe Biden : l’inclusion, la solidarité et l’équité ».
L’historien a également souligné les continuités historiques de ces phénomènes, rappelant l’acte de sédition de 1798, signé lors de la deuxième présidence de George Washington, par crainte de la Révolution française et des nouveaux immigrés venus de Paris. Cet acte, qui visait à défendre la liberté d’expression et la liberté de la presse inscrites dans le Premier Amendement de la Constitution, avait donné lieu au premier grand débat sur la démocratie représentative. Quand on pense à « la destruction complète de cette maison du juge en Caroline du Sud, on sait qu’il y a eu beaucoup d’exemples avant cela », rappelant ainsi que la violence politique n’est pas une nouveauté dans l’histoire américaine, même si son intensité et ses formes contemporaines marquent une inquiétante accélération.
II – Déploiement militaire : l’Amérique sous surveillance fédérale
Une rupture historique sans précédent
Cole Stangler a choisi de mettre en lumière un autre événement cristallisateur de la situation américaine actuelle : le déploiement des troupes fédérales à l’intérieur des États-Unis, « ce qui est quand même un phénomène très important ». Le journaliste énumère les déploiements : d’abord à Los Angeles cet été, ensuite à Washington, puis « aujourd’hui à Chicago, peut-être aujourd’hui et peut-être demain. On va voir, mais Portland », ville de l’Oregon sur la côte ouest.
Pour Cole Stangler, le constat est sans équivoque : « Cette volonté d’utiliser l’armée à l’intérieur des États-Unis, de faire des démonstrations de force dans des grandes villes américaines, met en lumière la nature profondément autoritaire de l’administration Trump qui est au pouvoir. Il n’y a pas d’autres mots. On a un président autoritaire qui est au pouvoir de la première puissance mondiale. »
Pourquoi déployer l’armée à l’intérieur des États-Unis ? On peut regarder « les raisons officielles qui sont avancées par l’administration ». Donald Trump invoque « l’insécurité incontrôlée qui justifierait l’intervention de l’armée ». Or, souligne Cole Stangler, « quand on entend les habitants sur place, ce n’est pas ce qu’ils racontent eux-mêmes. Ce n’est pas ce que pensent les forces de l’ordre local sur le terrain, la police locale, ce n’est pas non plus ce que pensent les élus. Ça c’est un point important. »
Les élus de ces grandes villes s’opposent fermement à ces déploiements. « En ce moment, il y a des batailles juridiques en cours en ce qui concerne Chicago et Portland. Donc, on va voir l’issue de ces batailles juridiques. En tout cas, pour l’instant, les élus locaux supplient Donald Trump de ne pas envoyer l’armée sur place. »
Si l’on parle de rupture, « là on est clairement dans une forme de rupture très importante avec les pratiques d’autres présidents ». Cole Stangler entre dans le détail : « Historiquement, quand on envoie… Trump veut mobiliser la Garde nationale, donc ce sont les forces réservistes de l’armée qui d’habitude interviennent dans un contexte… qui interviennent dans des catastrophes naturelles. Et puis seconde condition, souvent avec le soutien des gouverneurs des États en question. »
Or, « il faut remonter jusqu’aux années 60 pour trouver un autre exemple où le président avait envoyé la Garde nationale contre l’avis des gouverneurs. Et c’était dans un contexte du mouvement des droits civiques. Donc rien à voir. » À l’époque, « on avait un président démocrate qui voulait soutenir les manifestants contre les gouverneurs ségrégationistes du sud des États-Unis ». Aujourd’hui, « on a quelqu’un qui est dans une forme d’affrontation, de confrontation directe avec les élus ».
Un président qui cible systématiquement ses adversaires
La question demeure : pourquoi ? Cole Stangler estime qu' »au lieu de spéculer sur les intentions » de Trump, « on peut facilement rentrer dans ce jeu », il faut « tout simplement regarder son bilan, le bilan de l’administration depuis son retour au pouvoir ». Le constat est clair : « On a un président qui ne cesse de cibler ses adversaires politiques et qui veut cibler tout ce qu’il considère comme des sources d’opposition potentielle. »
Et le journaliste insiste : « Là, c’est pas mon avis. Il suffit de regarder la liste de décrets présidentiels depuis le mois de janvier. » Il énumère : « On a des décrets contre les cabinets d’avocats qui ont osé… nombreux les décrets… qui ont osé travailler sur des dossiers contre Donald Trump, impliquant Donald Trump. Décret contre les médias : ils veulent couper les subventions aux médias publics qui sont d’ailleurs très faibles déjà aux États-Unis. Des décrets contre les universités. »
Il faut aussi « regarder la manière dont le parti au pouvoir aujourd’hui, le parti républicain, parle du parti d’opposition ». Les républicains « les considèrent comme des adversaires, donc des compromis ne sont pas possibles ». Stephen Miller, l’un des conseillers principaux de Donald Trump, « dit que le parti démocrate est aujourd’hui une organisation terroriste ».
À ce moment de la table ronde, un incident technique a interrompu Cole Stangler : « Il y a un petit… une voix qui surgit… » La modératrice intervient : « On a un petit souci technique, je crois qu’on entend d’une autre salle. C’est possible de le régler en régie ? Moi, je peux attendre. On apprend des choses en même temps. » Avec humour, elle ajoute : « Oui, apparemment c’est bien plus intéressant ce qui se passe dans une autre salle. En tout cas, ce serait le message subliminal de la régie. » Une pause technique s’ensuit avant que Cole Stangler ne puisse reprendre.
Les grandes villes : bastions démocrates à punir
Reprenant son propos, Cole Stangler cite les discours de Stephen Miller : « Quand vous regardez ses discours, il parle du… du bien et du mal. C’est ce qu’il a dit aux obsèques de Charlie Kirk, l’influenceur d’extrême droite qui a été assassiné dans l’Utah dont on parlait tout à l’heure. »
Dans cette logique binaire, que représentent les grandes villes aujourd’hui aux États-Unis dans l’imaginaire trumpiste ? « De ce point de vue-là, Trump qui veut cibler ses adversaires, qui considère qu’il faut punir ses adversaires, cibler les sources d’opposition potentielle… » Les grandes villes, « c’est quoi ? Ce sont des endroits où les électeurs ont voté démocrate, qui votent majoritairement contre Donald Trump, où les élus n’hésitent pas à critiquer Donald Trump non plus. Donc on a des élus qui haussent le ton. C’est absolument le cas dans l’Illinois, à Chicago en ce moment. »
Ces villes sont aussi « des endroits où les autorités locales parfois ne se coordonnent pas avec la police anti-immigration ». Donc, résume Cole Stangler, « tout ça pour Donald Trump, c’est… si vous voulez, dans l’imaginaire trumpiste, ce sont des adversaires politiques qu’il faut punir ».
La mise en scène télévisuelle de l’autorité
Le dernier point que Cole Stangler souhaite évoquer concerne « l’importance de la télévision, des images ». Il dresse un portrait de Trump : « Donald Trump, bon c’est pas un grand lecteur, par contre, c’est quelqu’un qui regarde énormément de télévision et surtout Fox News. D’ailleurs, vous avez peut-être remarqué le nombre de personnalités Fox News qui sont dans l’administration, dont le secrétaire à la Défense, secrétaire des Transports, etc. »
Trump « sait très bien, il pense aux images ». Le journaliste anticipe : « Donc là, on va voir ce qui va se passer, mais on a potentiellement la possibilité de mettre en scène, littéralement, de mettre en scène des confrontations entre l’armée fédérale qui incarne… qui incarne bon la volonté du peuple américain, en tout cas la volonté du peuple de MAGA, donc Make America Great Again, le peuple représenté par Donald Trump contre les démocrates qui sont incapables de contrôler l’insécurité, qui lancent des… qui manifestent, qui sont antifascistes, etc. »
Cette dimension spectaculaire est cruciale : « En fait, il y a aussi ce côté mise en scène qui est très important. » Pour toutes ces raisons, conclut Cole Stangler, « cette utilisation de l’armée clairement marque une rupture avec les pratiques d’autres présidents ».
Le paradoxe : une radicalisation qui vient de loin
Cole Stangler termine « très rapidement » par un paradoxe. « En même temps », cette situation « a été rendue possible par un parti républicain dont le centre de gravité s’est déplacé ces dernières années ». On a aussi affaire à « une radicalisation du parti républicain ». Il insiste : « Donc Donald Trump, il vient pas de nulle part non plus. C’est le… il incarne un peu l’aboutissement de cette radicalisation que je décris dans mon livre. » Ainsi, « rupture mais en même temps on a une radicalisation qui date de quelques décennies du parti républicain ».
Marie-Caroline Debray synthétise les propos de Cole Stangler : « Je retiendrai effectivement la fracture qui est entre la population, les élus locaux d’un côté et le pouvoir fédéral de l’autre, qui représente avec cette utilisation effectivement des forces armées un instrument… l’instrument de politique extérieure… pour des enjeux de politique intérieure à viser et à destination du politique et afin de renforcer le caractère autoritaire de l’administration Trump. »
Cette section de la table ronde a ainsi mis en lumière une rupture majeure dans le fonctionnement institutionnel américain : l’usage des forces armées contre la volonté des autorités locales, non pas pour protéger des droits civiques comme dans les années 60, mais pour cibler des bastions politiques de l’opposition. Une démonstration de force spectaculaire au service d’un projet autoritaire, rendue possible par des décennies de radicalisation d’un parti républicain dont Trump incarne l’aboutissement.
III – Culture wars : moteur de la polarisation américaine
Définir les guerres culturelles : du concept aux réalités
Marie-Caroline Debray a interrogé les intervenants sur la question des culture wars : comment façonnent-elles la vie politique américaine ? Représentent-elles plutôt un symptôme ou un moteur de la polarisation ? Cole Stangler commence par poser les bases conceptuelles : « Très bonne question. Je vais répondre, c’est sûr. Mais d’abord, il faut aussi dire qu’est-ce qu’on entend par guerre culturelle ? On peut penser à Gramsci en Italie, on peut penser même à l’Allemagne au début du 20e siècle. Mais dans le contexte américain, on pense souvent à l’ouvrage de James David Hunter », dont le journaliste avait « bloqué sur le nom de famille », « Hunter en 91 qui a écrit ce livre sur les guerres culturelles ».
Ce que James Davison Hunter observait à ce moment-là, c’est qu' »il y avait de plus en plus de conflits autour des valeurs aux États-Unis ». Quand il écrit au début des années 90, il pense « surtout au combat autour de la question de la régulation des armes à feu, l’avortement, le rôle de la religion dans l’espace public », des questions qui pour lui « sont des questions de valeur ». Cole Stangler nuance : « En réalité, je trouve que c’est un peu plus compliqué que ça. J’aime pas beaucoup cette définition parce qu’en réalité la question de l’avortement c’est aussi une question sociale qui concerne le corps des femmes. Donc il faut pas non plus la réduire à une question de valeur. »
Néanmoins, « quand on pense aux guerres culturelles, on pense à ces combats sociétaux pour aller très vite. Donc des combats qui ne sont pas liés à l’économie ou à la distribution des richesses ou au pouvoir économique, sur des questions plus sociétales ». Et il y a « de plus en plus de guerres culturelles aux États-Unis depuis les années 90 ».
Les évangéliques : moteur spirituel des guerres culturelles
Cole Stangler identifie un acteur central : « C’est très important de noter que la droite américaine a toujours eu un avantage en ce qui concerne les guerres culturelles, le parti républicain, c’est qu’aux États-Unis, on a des millions et des millions d’Américains qui se décrivent comme des chrétiens évangéliques, non pas évangélistes, mais évangéliques ». Ce sont « des gens qui ont une relation selon eux personnelle avec Dieu, qui sont nés de nouveau, born again, et ce sont des millions de personnes ».
L’élément crucial est le suivant : « Pour eux, les États-Unis sont en train de vivre » – et le journaliste insiste : « ce n’est pas du tout une façon de parler ou de faire des blagues, ils considèrent que les États-Unis sont en train de vivre une crise spirituelle profonde. Et donc ces batailles-là pour eux ce sont des questions spirituelles vraiment au sens littéral du terme. »
Les conséquences sont majeures : « Quand eux ils sont investis dans ces guerres culturelles, des compromis sont impossibles et ce sont ces évangéliques qui sont le véritable moteur de cette guerre culturelle. » Aujourd’hui, d’autres guerres culturelles se sont ajoutées : « La question des droits des personnes trans, la question de l’enseignement sont des questions sur lesquelles les républicains sont extrêmement mobilisés. »
Une chose importante a changé : « Aujourd’hui ils sont au pouvoir. Donc ce parti radicalisé soutenu par une base de chrétiens évangéliques qui toujours existait mais qui était souvent en marge de la vie politique, aujourd’hui cette base évangélique est au centre du jeu politique. Ils ont petit à petit progressivement étendu leur influence au sein du parti républicain et aujourd’hui ils ont un président qui est au pouvoir et donc ils ont beaucoup beaucoup plus d’influence qu’auparavant. »
Fox News : l’amplificateur télévisuel
Cole Stangler tient à revenir sur un médium parfois négligé au profit des réseaux sociaux : la télévision. « On parle beaucoup et pour de très bonnes raisons des réseaux sociaux. Il faut parler des réseaux sociaux. Mais je veux revenir encore sur la télévision qui est très importante parce qu’on a une chaîne aux États-Unis qui a joué un rôle très important dans la transmission de ces guerres culturelles. »
Cette chaîne fait de « l’agenda setting » – un terme des études de communication. « Ils vont signaler aux téléspectateurs quels sont les sujets les plus importants. Et Fox News, je parle évidemment de Fox News, chaîne fondée par Rupert Murdoch, milliardaire australien et britannique de droite. »
Fox News « va mettre en avant ces guerres culturelles pour les téléspectateurs. Et Fox News est une chaîne qui fonctionne très très bien ». Le journaliste insiste : il ne faut pas seulement « parler du contenu, il faut aussi regarder le style de Fox News, la façon dont ils mettent en avant cette opposition entre les Américains ordinaires. Donc les présentateurs se positionnent du côté des Américains ordinaires et ils critiquent le travail d’autres médias plus prestigieux qui sont assimilés aux élites culturelles. »
Fox News « a joué un rôle très important dans la transmission de ces guerres culturelles. Elle continue à jouer un rôle très important. Aujourd’hui, Fox News est regardée par les Américains qui sont plus âgés, les Américains plus conservateurs, mais ce sont eux qui votent le plus aussi, les personnes âgées plus que les jeunes. Donc Fox News a joué un rôle très important. »
Polarisation et satisfaction de la base
Pour répondre à la question initiale, Cole Stangler conclut : « Oui, les guerres culturelles contribuent évidemment à cette polarisation parce que Donald Trump et les républicains, aujourd’hui leur but c’est de satisfaire les demandes de leur base politique. Ils considèrent que l’autre camp n’est même pas légitime. Ce sont des opposants, voire des terroristes ou des gens qui soutiennent le terrorisme. Et donc de ce point de vue-là, ils n’ont pas envie de faire des concessions, ils n’ont pas envie de faire des compromis. »
Le journaliste termine sur un rappel important : « Il faut pas oublier le fait que Donald Trump malgré cette tentative de modeler le pays à son image reste un président impopulaire. Il y a 40% dans les sondages. On va me dire qu’en France c’est un président populaire. Mais en tout cas, d’un point de vue américain, c’est un président qui est impopulaire et donc il a une base importante qu’il faut absolument pas négliger. Mais en même temps, il y a 60% des Américains qui n’approuvent pas et donc quand on veut que satisfaire sa base, bah évidemment ça encourage cette forme de polarisation. »
Marie-Caroline Debray réagit avec humour : « Merci Cole et merci d’avoir rappelé qu’effectivement le contexte politique actuel français arrive même à concurrencer le contexte politique américain. Je suis pas sûre que ce soit une source de fierté mais c’est très vrai. »
La dimension internationale des culture wars
Marco Scioli apporte une perspective internationale sur les guerres culturelles. Il évoque les tarifs douaniers et la Constitution américaine qui « a été inventée pour éviter une démarche impériale ». Selon une étude du Conseil européen des relations étrangères, « Trump et le mouvement MAGA ont deux objectifs : discréditer les institutions européennes et renforcer leurs nouveaux alliés d’extrême droite dans les pays européens. Cette stratégie est visible et ressemble à un spectacle de TV réalité. »
Les supporteurs de Trump « mènent une guerre idéologique sur le sujet de l’immigration, mais aussi au niveau des droits des minorités, la liberté d’expression et au niveau du climat également ». Dans les coulisses, « les États-Unis veulent humilier l’Europe en disant que c’est une région faible, incapable d’agir sans les États-Unis ». Trump soutient « les candidats d’extrême droite en 2025 », notamment en Allemagne, en Hongrie, en Pologne, et « travaille avec l’extrême droite et les aide à démonter les systèmes juridiques ».
Marco Scioli cite l’exemple de Georgia Meloni qui « a renforcé sa rhétorique suite à la mort de Charlie Kirk qui parlait des thèmes sombres et de conspiration et il disait qu’elle était elle-même la cible de violence politique ». Le but de Trump est de « remodeler l’Europe comme étant une Union européenne de nations sans contraintes communes, sans contrôle et sans aucun pouvoir supranational. Ce sont des plans idéologiques » qui « servent ses intérêts. L’idée est d’attaquer des valeurs européennes pour augmenter les bénéfices de Tesla, de Meta et les fournisseurs de gaz américain. »
La séparation géographique de l’Amérique
Amy Greene apporte une analyse structurelle : « C’est pas du tout un phénomène nouveau. » Elle remonte aux années 70 avec « un processus qui s’appelle le tripartisme ». À cette époque, « les Américains ont commencé à avoir un accès de plus en plus démocratisé à l’éducation, à l’enseignement supérieur ». Résultat : « Les Américains commencent à se disperser en fonction de l’opportunité économique liée entre autres au niveau du diplôme. »
Cela crée « des grands pôles urbains qui attirent justement ces nouveaux talents économiques qui ont la capacité à se déplacer dans le pays, à s’éloigner de leurs localités et finalement de construire des grands pôles qu’on voit sur les deux côtes notamment. Petit à petit, ça vide les ruralités. Donc en fait vous avez des petites communautés, des ruralités notamment qui se vident de leurs talents qui vont s’enrichir ailleurs, qui vont se développer et s’épanouir ailleurs mais qui ne reviennent pas. »
Cette séparation crée « une dissonance parce que vous avez d’une part ces pôles assez libéraux, progressistes, etc. Et puis à partir du moment où vous avez ces pôles un peu de gauche en fait qui se construisent, vous avez de plus en plus de personnes qui décident de rejoindre ces pôles parce que finalement ‘qu’est-ce que je vais retrouver ? Je vais retrouver des gens qui pensent comme moi, qui incarnent des valeurs politiques comme moi, etc.' »
Amy Greene conclut : « Finalement on a ces deux Amériques-là qui s’éloignent. Ça c’est un élément qui me semble très important parce que c’est là où les Américains commencent à ne plus se comprendre et donc c’est un phénomène qui s’aggrave et qui se fait justement instrumentaliser par les différentes compositions politiques. »
Sécularisation et identité politique religieuse
Amy Greene aborde ensuite « les phénomènes de religion » et « un phénomène un peu plus récent et très important : la sécularisation de la société ». Les premières guerres culturelles concernaient « l’avortement. Donc c’est une question religieuse qui va diviser et puis Roe v. Wade n’était jamais vraiment très consensuel à ces moments-là dans la société. Mais bon, c’était autour d’une question religieuse. Un peu plus tard, c’était au sujet des armes et c’était plus dans les années 90. »
La trajectoire est claire : « Ça part des questions religieuses et qui deviennent des questions plus larges et plus politiques. » Aujourd’hui, « on a aux États-Unis un vrai fait de sécularisation avec de moins en moins d’Américains qui s’identifient avec une église ». Et il y a « une fracture partisane parce qu’on voit ce phénomène s’accentuer davantage à gauche plutôt qu’à droite ».
Parallèlement, « à droite, vous avez des évangéliques, mais pas que, mais notamment des évangéliques qui ont une lecture plutôt religieuse des valeurs de la société sur des questions d’avortement, mais peut-être aussi des armes, sur l’indépendance de l’individu par rapport à l’autorité. Mais finalement, cette question d’évangélisme aux États-Unis est certes liée à la religion, mais est de plus en plus un marqueur d’une identité politique. »
Des enquêtes et études montrent que « finalement les évangéliques s’identifient davantage à la droite du parti républicain. Ce qui pourrait expliquer pourquoi Trump qui n’a de toute évidence pas beaucoup de points en commun avec ce courant d’une identité religieuse » peut néanmoins compter sur leur soutien. « En même temps, cette sécularisation-là peut effrayer cette partie-là de l’Amérique pour différentes raisons. »
L’institutionnalisation des guerres culturelles
Amy Greene introduit un dernier élément crucial : « L’institutionnalisation des guerres culturelles. Parce que finalement cette division-là ou ces divisions-là au cœur de l’opinion publique américaine sur des sujets de société, sur certains sujets n’est pas si fracturée que ça. »
Elle prend l’exemple du droit à l’IVG : « Une majorité d’Américains et d’Américaines soutiennent le choix, la capacité de décider pour une femme, de décider pour elle-même de recourir à cette pratique médicale. Mais néanmoins, on va retrouver dans les États gouvernés par le parti républicain des propositions de loi qui restreignent voire qui enlèvent justement ce droit-là. »
Il y a donc « une sorte d’Amérique à deux vitesses. Une Amérique qui gouverne justement pour cette composition religieuse ». Ces gouvernements « bénéficient d’avoir le pouvoir de gouverner ces États-là et donc ils vont faire voter avec cette majorité-là dans les postes d’élus locaux des propositions qui vont à l’encontre de l’opinion publique américaine ».
Le bouleversement démographique
Amy Greene mentionne un dernier élément : « Le bouleversement démographique en train de se passer aux États-Unis qui peut également effrayer une partie de l’Amérique. » Elle précise : « Je dirais pas qu’il y a une partie de l’Amérique qui a peur de ce changement-là, mais il ne faut pas sous-estimer en tout cas, et notamment avec l’histoire qui est celle des États-Unis autour des questions de racisme, des mouvements des droits civiques, des mouvements émancipateurs, le fait qu’aujourd’hui on est dans une configuration de la population où l’Américain ne ressemble plus physiquement et de plus en plus au père fondateur, si je peux dire comme ça. »
Elle cite l’exemple du Sud : « On a les régions des États-Unis, je pense au sud qui s’identifient majoritairement comme étant non blanc. » Dans les jeunes générations, « on est dans des compositions qui sont très différentes justement de celles des générations précédentes ». Amy Greene nuance : « Je dis pas que c’est réflexif et c’est le moteur qui alimente ces guerres culturelles mais il ne faut pas sous-estimer le chamboulement d’une société finalement qui ne se ressemble plus à ce qu’elle a été historiquement. »
Marie-Caroline Debray synthétise : « Je retiendrai effectivement au cœur de ce phénomène de guerre culturelle ou de culture wars plusieurs éléments dont vous avez tous mentionné. L’importance des médias, l’importance des médias comme amplificateur de la situation réelle aux États-Unis. L’importance du facteur démographique de cette société américaine qui ne ressemble plus à celle des pères fondateurs démographiquement parlant. Le rapprochement du religieux et du politique qui je pense aussi est un vrai déterminant de la société américaine qui a été particulièrement mis en lumière par l’assassinat et le traitement de l’assassinat de Charlie Kirk. »
IV – Fractures socio-économiques : la précarité invisible
Grèves, précarisation et refus fédéral
Marie-Caroline Debray avait identifié en introduction les fractures économiques comme un élément structurel majeur. Ces derniers mois ont vu « de nombreuses tensions sociales liées au coût de la vie et à la précarisation de l’emploi sur le territoire américain notamment chez les jeunes travailleurs ». Les grèves se sont multipliées « dans les secteurs publics » et dans « les grandes entreprises telles qu’Amazon, Starbucks et dans l’automobile tandis que le gouvernement Trump 2 est resté complètement hostile à toute revalorisation du salaire minimum fédéral ».
Ce refus contraste fortement avec l’histoire du Parti démocrate. Comme le rappelle Cole Stangler dans les questions du public, Roosevelt « c’est le président qui a instauré le salaire minimum fédéral » et les Américains « savaient que quand les démocrates étaient au pouvoir avec le New Deal, les choses allaient mieux d’un point de vue économique ». Les avancées sociales permettaient une « amélioration des conditions de vie des Américains, ce qui est très loin du Parti démocrate actuel ». De même, « on peut aussi parler de la présidence Johnson dans les années 60 où il met en place des vraies politiques qui ont amélioré les conditions de vie des Américains ».
La recomposition de l’électorat démocrate
Cette dimension économique s’inscrit dans une recomposition électorale majeure. Cole Stangler note que « les démocrates qui historiquement avaient une base plus populaire, c’était des gens qui votaient moins au moment des midterms. Paradoxalement, le fait que le Parti démocrate est devenu aujourd’hui… la coalition démocrate est devenue plus diplômée, plus aisée, ce sont des gens qui ont tendance à voter plus au moment des midterms. »
À l’inverse, « l’électorat de Trump est aujourd’hui un électorat un peu plus populaire, en tout cas populaire en dehors des grandes villes ». Cette inversion historique transforme profondément le paysage politique américain et éloigne le Parti démocrate de ses racines populaires.
Le rêve américain en question
Amy Greene aborde cette fracture sous l’angle du « ciment » de la société américaine. La devise des États-Unis, « E pluribus unum » – « de plusieurs un seul » – reposait sur « l’appartenance à un projet commun ». Le « rêve américain », malgré sa diversité d’interprétations, signifiait essentiellement : « Vous pouvez partir de la misère et arriver à vous en sortir grâce au travail. Vous pouvez également fournir une vie meilleure à vos enfants grâce à votre travail. » C’était « un impact presque économique : vous investissez dans le collectif et le collectif va vous remercier ».
Aujourd’hui, constate Amy Greene, « ce rêve-là devient peu crédible pour un nombre croissant d’Américains qui voient de jeunes générations qui du point de vue de l’espérance de vie vivent moins longtemps que leurs parents, dans de moins bonnes conditions que leurs parents ». La promesse de réussite intergénérationnelle s’effondre.
L’absence d’une vérité commune
Dans ses remarques finales, Amy Greene identifie un facteur structurant essentiel : « L’absence d’une vérité commune. Je pense que c’est un facteur qui structure beaucoup la vie politique, la vie civique aux États-Unis. C’est important de se rendre compte de ça. »
Elle développe ensuite un « point d’optimisme » paradoxal : « Aujourd’hui, chaque individu vit un nombre croissant de souffrances, vit ça de façon intime : la question de la santé, la question des armes, la question des inégalités socio-économiques sans se rendre compte nécessairement que son voisin vit la même chose et que dans sa communauté, il y a beaucoup de voisins qui vivent la même chose et que dans son état, ainsi de suite. »
L’optimisme réside dans une éventuelle prise de conscience : « Finalement, un facteur presque d’optimisme en tout cas de fédérer des Américains autour de quelque chose, c’est de se rendre compte que cette précarité, cette difficulté, cette inquiétude et cette peur ne sont pas partagées uniquement par eux, mais au travers des clivages politiques, au travers de la couleur de peau, au travers des États fédérés, etc. » Amy Greene conclut avec lucidité : « C’est un peu triste mais en même temps c’est un facteur vrai dans l’expérience de l’Américain ordinaire aujourd’hui. »
Cette atomisation des souffrances, vécues individuellement alors qu’elles sont collectivement partagées, constitue peut-être la fracture la plus profonde de la société américaine contemporaine. L’absence d’une vérité commune empêche la constitution d’une solidarité trans-partisane face aux défis économiques et sociaux, perpétuant ainsi la polarisation au moment même où une union serait la plus nécessaire.
V – Démocratie en danger : réformes électorales et perspectives 2026-2028
Le rétrécissement programmé du corps électoral
À l’approche des élections de mi-mandat de 2026 et de la présidentielle de 2028, plusieurs États républicains ont durci leurs lois électorales. Comme le soulignait Marie-Caroline Debray en introduction, le Texas, la Géorgie et la Floride ont mis en place « une réduction du vote par correspondance, la fermeture de bureaux de vote dans certains quartiers urbains et des purges massives dans les listes électorales ». Ces mesures laissent présager « un retour à des stratégies de rétrécissement du corps électoral qui ne sont pas une nouveauté dans l’histoire américaine, notamment l’histoire du 20ème siècle » mais qui posent « un enjeu fondamental de légitimité démocratique ».
Cette restriction de l’accès au vote s’inscrit dans une stratégie plus large visant à favoriser l’électorat républicain tout en marginalisant les populations urbaines et minoritaires traditionnellement favorables aux démocrates. Le paradoxe historique est frappant : les États-Unis, qui se présentent comme le phare de la démocratie mondiale, mettent en œuvre des mécanismes qui en limitent délibérément l’exercice.
Les enjeux des midterms de 2026
Pour Amy Greene, « la question ça va être qui reprend le contrôle, enfin qui garde le contrôle du Congrès ». À ce stade, « c’est très peu probable que le parti démocrate reprend le contrôle du Sénat » en raison du système échelonné où seul un tiers du Sénat se renouvelle à chaque cycle. En revanche, « il y a plus de chance à ce qu’il reprenne le Congrès » et une trentaine de postes de gouverneurs d’États fédérés sont également en jeu, avec « des conséquences très importantes ».
Mais la vraie question, selon elle, concerne la configuration institutionnelle : « Si le Parti démocrate reprend le Congrès, la vraie question qui va se poser, c’est un congrès dans quel état ? » L’ambition de Donald Trump « c’est vraiment d’élargir l’autorité présidentielle qui dépasse ou qui dépasserait les limites normatives, en fait la pratique habituelle des prédécesseurs ». Le risque est donc de « se retrouver avec un congrès affaibli avec la justice qui aurait validé justement cet effritement du pouvoir congressionnel ».
Cole Stangler nuance toutefois la dimension locale des midterms : certes, « ce sont des élections locales », mais « on est dans un contexte politique où tout est nationalisé ». Tout est vu « avec le prisme de Trump et de ses combats entre le parti républicain, le parti démocrate au niveau national ». La nationalisation du débat politique transforme même les élections locales en référendums sur la présidence Trump.
La crise d’identité démocrate
Au-delà des enjeux électoraux, le Parti démocrate traverse une profonde crise existentielle. Cole Stangler observe que « les électeurs démocrates sont très critiques de leur propre parti ». Le Parti démocrate « a un niveau de popularité très bas, y compris chez les électeurs démocrates, parce qu’ils considèrent qu’il y a une opposition un peu endormie qui n’est pas présente, qui n’est pas à la hauteur de ce qui est en train de se passer ».
Cette crise se manifeste par « des courants politiques, des courants idéologiques qui sont différents, mais aussi une fracture autour de l’opposition à Trump » : dans quelle mesure faut-il nommer l’autoritarisme trumpiste ? Faut-il au contraire se concentrer sur « les questions de l’inflation, du coût de la vie, des questions sociales » ? Marie-Caroline Debray notait que « même au niveau de la direction du Parti démocrate, il semble ne pas y avoir une vraie direction commune partagée », avec des grandes figures qui « se tapent les uns sur les autres ».
Pour 2028, la grande interrogation demeure : « Est-ce qu’il y a un démocrate en face ? » Cette question résume à elle seule l’incertitude qui pèse sur l’avenir politique américain.
VI – Avenir politique : entre héritiers du trumpisme et reconstruction démocrate
JD Vance, l’héritier désigné
Marie-Caroline Debray notait en introduction que les « visions des partis politiques s’inscrivent pas uniquement à court terme dans l’administration Trump 2 mais qui voient déjà la continuité derrière ». Cette continuité a un visage : JD Vance, vice-président dont « la popularité » et « la présence » semblent « particulièrement importantes dans l’histoire américaine en tant que vice-président ».
Pour Amy Greene, « il se positionne comme le successeur du trumpisme. C’est quelqu’un qui a l’ancrage idéologique, la connaissance institutionnelle pour enraciner davantage une vision entre guillemets trumpiste au-delà de Donald Trump. » Contrairement à Trump, qui reste une figure protestataire et charismatique, Vance possède la formation intellectuelle et la maîtrise des rouages institutionnels nécessaires pour transformer le trumpisme en doctrine politique durable.
Toutefois, Amy Greene souligne une faiblesse majeure : « Il n’est pas une figure très très populaire à l’échelle nationale. Il subit les mêmes phénomènes de fracture, d’impopularité que son président. » JD Vance incarne certes l’héritier idéologique du mouvement MAGA, mais sans le charisme ni l’aura populiste de Donald Trump. La question demeure de savoir si le trumpisme peut survivre sans Trump.
La reconstruction démocrate : au-delà de la défense de la démocratie libérale
Face à cette perspective de pérennisation du trumpisme, quel chemin pour le Parti démocrate ? Cole Stangler propose une voie radicale : revenir aux fondamentaux rooseveltiens. « Quand est-ce que les démocrates gagnaient réellement des élections ? On peut remonter à la période de Roosevelt. Pour moi, c’est un exemple parfait de cette grande coalition démocrate qui a réussi à prendre le pouvoir. »
Le New Deal offrait quelque chose de concret : « On savait que quand les démocrates étaient au pouvoir, les choses allaient mieux d’un point de vue économique. » Roosevelt a instauré le salaire minimum fédéral, Johnson dans les années 60 a « mis en place des vraies politiques qui ont amélioré les conditions de vie des Américains ». Le Parti démocrate était alors « associé avec une amélioration des conditions de vie des Américains, ce qui est très loin du Parti démocrate actuel ».
Pour Cole Stangler, la solution est simple mais radicale : « Il faut que le Parti démocrate arrive au pouvoir et mette en place un programme qui montre qu’il est capable d’améliorer les choses. » Il critique frontalement la stratégie actuelle : « C’est pas en parlant que de l’importance de la démocratie libérale qu’il faut sauver et cetera que les démocrates vont gagner parce qu’en fin de compte les Américains se demandent mais quelle démocratie ? Pourquoi ? » La défense abstraite des institutions ne suffit pas face à la précarité concrète.
Les candidats émergents : une nouvelle génération populiste de gauche
Cole Stangler identifie plusieurs candidats démocrates qui incarnent ce renouveau programmatique. « Il y a un jeune socialiste à New York qui a gagné la primaire démocrate qui va peut-être devenir le prochain maire de New York, Zoran Mamdani. » Cette victoire dans la plus grande ville américaine suggère un appétit électoral pour une gauche assumée.
Mais le phénomène ne se limite pas aux bastions urbains. « Si on veut parler de zones plus rurales, il y a des candidats intéressants dans le Maine. Je pense à Graham Platner, un démocrate qui est ancien combattant qui parle de l’oligarchie, donc une campagne très populiste mais populiste à la Bernie Sanders, donc le peuple contre les élites économiques. » Platner démontre qu’un discours populiste de gauche peut fonctionner en territoire rural, traditionnellement acquis aux républicains.
Plus surprenant encore, Cole Stangler mentionne « Dan Osborne, candidat ancien syndicaliste dans le Nebraska, qui lui est indépendant, qui n’est même pas démocrate mais qui se présente contre les républicains ». L’émergence de candidatures indépendantes d’obédience syndicaliste suggère que l’espace politique américain est plus fluide qu’il n’y paraît.
Le religieux comme ciment de la coalition MAGA
Interrogé sur le facteur structurant majeur de la société américaine, Cole Stangler identifie sans hésitation le fait religieux : « Moi, j’insisterai vraiment sur le fait religieux. On l’a vu aux obsèques de Charlie Kirk. C’est extrêmement important. »
Il développe ensuite une analyse frappante sur la perception de Trump par les évangéliques : « Ce qui est très important à comprendre dans le monde MAGA et je l’ai vu avec mes propres yeux en reportage, je parle avec des républicains sur le terrain dans des bastions, des évangéliques et eux ils considèrent Donald Trump comme une sorte de roi David, de personnage biblique. »
Cette comparaison biblique est cruciale : David était « quelqu’un qui était certes pas très bon, qui péchait, qui avait ses excès, mais qui était quand même celui qui dirigeait son peuple ». Aux obsèques de Charlie Kirk, « la veuve prend la parole et dans un moment vraiment très puissant, elle dit : je pardonne le tueur. Donc un exemple vraiment de ce que c’est finalement d’être chrétien. Et Donald Trump prend la parole juste après et il dit : bon, je ne suis pas d’accord malheureusement avec vous, moi je déteste mes adversaires. »
Cette séquence, « assez choquante » et « paradoxale », illustre pourtant parfaitement la fonction de Trump dans l’imaginaire MAGA : « Dans le monde MAGA, Trump est dans son rôle, c’est le roi David. » Il n’a pas à être un bon chrétien lui-même ; il doit être le bras armé, le protecteur guerrier d’une communauté assiégée.
Résilience et espoir : la perspective historique
Face à ces analyses souvent sombres, Marco Scioli apporte une note d’optimisme fondée sur l’histoire longue. « En tant qu’historien, je dois dire que les États-Unis connaissent un moment très difficile dans leur histoire actuelle. » Il rappelle la loi sur la sédition, « les années 1920 où beaucoup de gens ont souffert », la période du maccarthysme « dans les années 50 avec une grande peur du communisme ». Même la garde nationale a été appelée dans les universités, notamment « dans l’université de Ohio en 1974 ».
Sa conclusion est mesurée mais confiante : « Je dirais qu’actuellement le problème majeur c’est la violence mais la résilience existe également. J’ai confiance dans le rêve américain comme décrit par les pères fondateurs de la constitution. Donc j’ai confiance dans l’avenir, résilience et foi dans le modèle américain pour surmonter ses épreuves. »
Cette perspective historique suggère que l’Amérique a déjà traversé des crises comparables – et en est ressortie. Reste à savoir si les institutions américaines, érodées par des décennies de polarisation et confrontées à des assauts sans précédent, possèdent encore cette capacité de régénération.
Conclusion : une Amérique au miroir de nos propres fractures
Au terme de cette table ronde, un constat s’impose : l’Amérique de 2025 ne traverse pas de simples turbulences politiques, mais bien une transformation structurelle profonde qui redéfinit les fondements mêmes de la société américaine. L’assassinat de Charlie Kirk, loin d’être un simple fait divers tragique, cristallise cette mutation : la fusion du religieux, de l’idéologique et du politique ; la normalisation de la violence comme outil d’expression ; la sacralisation d’un leader politique en figure messianique.
Les six axes explorés lors de cette rencontre dessinent les contours d’une nation fragmentée selon des lignes multiples et convergentes. La violence politique s’est institutionnalisée, passant de l’exception à la règle, avec plus de 150 incidents recensés en six mois. Le déploiement militaire sur le sol américain, utilisé pour réprimer des manifestations civiles, marque une rupture symbolique dans l’usage de la force armée contre sa propre population. Les culture wars ont quitté le terrain du débat public pour s’ancrer dans les institutions – écoles, universités, armées – transformant l’éducation et la mémoire en champs de bataille idéologique.
Sur le plan économique, la fracture s’approfondit : grèves dans les secteurs-clés, refus de revaloriser le salaire minimum fédéral, effondrement du rêve américain pour les jeunes générations qui, pour la première fois dans l’histoire moderne, vivent moins bien que leurs parents. Cette précarité, vécue individuellement dans l’isolement, empêche paradoxalement la constitution d’une conscience collective trans-partisane qui pourrait fédérer autour de souffrances partagées.
Les menaces pesant sur la démocratie ne sont pas nouvelles dans l’histoire américaine, mais elles prennent aujourd’hui une forme systématique : rétrécissement du corps électoral par des réformes ciblées, affaiblissement du Congrès face à une expansion de l’autorité présidentielle, disparition d’une vérité commune qui permettrait le débat démocratique. Face à ces défis, le Parti démocrate apparaît en crise d’identité profonde, incapable de proposer une alternative mobilisatrice au-delà de la défense abstraite des institutions.
Pourtant, des lueurs d’espoir subsistent. L’émergence de candidats démocrates assumant un discours populiste de gauche – de New York au Nebraska en passant par le Maine – suggère qu’un renouveau programmatique est possible. La perspective historique rappelle que l’Amérique a déjà connu des périodes sombres – la loi sur la sédition, le maccarthysme, les violences des années 1960-1970 – dont elle est ressortie. La résilience des institutions américaines, maintes fois éprouvée, pourrait encore jouer son rôle.
Mais la grande inconnue demeure : le trumpisme peut-il survivre sans Trump ? JD Vance incarne l’héritier idéologique, doté de l’ancrage intellectuel pour pérenniser la doctrine, mais dépourvu du charisme et de l’aura populaire de son prédécesseur. La coalition MAGA, cimentée par le fait religieux évangélique et la figure quasi-biblique de Trump comme « roi David », trouvera-t-elle dans Vance un successeur crédible, ou s’effondrera-t-elle une fois son leader charismatique disparu de la scène ?
Comme le soulignait Marie-Caroline Debray en introduction, ces débats internes américains « résonnent fortement avec nos propres tensions » européennes et françaises. Polarisation identitaire, montée de la violence politique, instrumentalisation de la mémoire, fractures économiques invisibilisées, érosion de la confiance dans les institutions démocratiques : l’Amérique de 2025 n’est pas seulement un spectacle lointain et sidérant, mais bien un miroir dans lequel observer nos propres vulnérabilités.
La question posée par cette table ronde dépasse donc largement le cadre américain : comment réconcilier des sociétés qui ne partagent plus ni vérité commune, ni projet collectif, ni même une conception partagée de la réalité ? À cette interrogation vertigineuse, ni les intervenants ni l’histoire ne proposent de réponse définitive. Reste la lucidité du constat et l’exigence de continuer à penser, ensemble, les conditions de possibilité d’un avenir démocratique.
Cette table-ronde, passionnante, soulève de nombreuses questions et permet de réfléchir à des applications avec des élèves. C’est ce qui va suivre à travers quelques pistes de réflexion.
Captation de la Table-ronde – RSMED 2025
***
Démocratie américaine en crise (2025)
Dossier professeur – HGGSP Terminale & EMC Lycée
I – CADRAGE PÉDAGOGIQUE
Programmes concernés
HGGSP Terminale
- Thème 5 : Analyser les relations entre États et religions
- Axe 1 : Pouvoir et religion
- Application : Le rôle des évangéliques dans la politique américaine
- Thème 6 : Identifier, protéger et valoriser le patrimoine : enjeux géopolitiques
- Axe 2 : Mémoire et histoire
- Application : Culture wars et réécriture mémorielle (censure éducative)
EMC Lycée (1ère et Terminale)
- Thème : La démocratie
- Fondements et fragilités de la démocratie
- Participation politique et citoyenne
- Violence politique et État de droit
- Thème : Les enjeux moraux et civiques de la société de l’information
- Médias et polarisation
- Vérité et post-vérité
Objectifs d’apprentissage
Connaissances
- Comprendre les mécanismes de fragilisation démocratique aux États-Unis (2024-2025)
- Identifier les facteurs de polarisation politique (médias, religion, culture wars)
- Analyser les réformes électorales restrictives et leurs enjeux
- Contextualiser la violence politique contemporaine dans l’histoire américaine
Capacités
- Analyser de manière critique des documents de nature variée (articles, données statistiques, discours)
- Confronter des points de vue d’experts
- Construire une argumentation structurée
- Contextualiser un phénomène contemporain dans le temps long
Attitudes
- Développer l’esprit critique face aux phénomènes de polarisation
- Comprendre les enjeux démocratiques universels au-delà du cas américain
- S’interroger sur les fragilités démocratiques dans d’autres contextes (France, Europe)
Durée estimée (modulable)
- Format court : 2 heures (2-3 activités au choix)
- Format moyen : 3-4 heures (ensemble documentaire + 3-4 activités)
- Format approfondi : 5-6 heures (intégralité du module + prolongements)
Prérequis élèves
- Notions de base sur le système politique américain (Constitution, séparation des pouvoirs, système électoral)
- Connaissance de la présidence Trump (2017-2021, 2025-)
- Repères chronologiques : élection 2024, retour de Trump (janvier 2025)
II – CONTEXTUALISATION SCIENTIFIQUE
Repères chronologiques clés (2024-2025)
2024
- 5 novembre 2024 : Élection présidentielle – Victoire de Donald Trump sur Kamala Harris
- Décembre 2024 : Grèves chez Amazon et Starbucks (mouvement syndical)
2025
- 20 janvier 2025 : Investiture de Donald Trump (second mandat)
- 24 janvier 2025 : Confirmation de Pete Hegseth comme secrétaire à la Défense (vote décisif du VP J.D. Vance)
- Avril 2025 : Incendie criminel visant la résidence du gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro
- Mai 2025 : Meurtre de deux employés de l’ambassade d’Israël à Washington D.C.
- Juin 2025 : Attentats contre des députés du Minnesota (Melissa Hortman tuée)
- Juillet 2025 : Rapport FBI sur la montée des groupes extrémistes intérieurs
- Août 2025 : Redécoupage électoral partisan au Texas (gerrymandering)
- 5 septembre 2025 : Renommage du département de la Défense en « département de la Guerre »
- 10 septembre 2025 : Assassinat de Charlie Kirk à l’Université de Utah Valley (Orem)
- 12 septembre 2025 : Arrestation de Tyler Robinson (22 ans), suspect de l’assassinat
- 21 septembre 2025 : Cérémonie d’hommage nationale à Charlie Kirk (stade de Glendale, 63 000 places)
- 30 septembre 2025 : Discours de Pete Hegseth devant 800 généraux et amiraux (base de Quantico)
- 8 octobre 2025 : Table ronde RSMed à Toulon « Décrypter les États-Unis »
- 4 novembre 2025 : Élections locales et référendums constitutionnels au Texas
Données statistiques clés
- 150+ incidents à caractère politique recensés sur les 6 premiers mois de 2025 (source : chercheur Mike Jensen, Université du Maryland)
- Doublement de la violence politique par rapport à 2024 (même période)
Définitions conceptuelles
Polarisation politique : division croissante de la société en camps idéologiques opposés, avec réduction de l’espace de compromis et intensification de l’hostilité entre groupes. Aux États-Unis, cette polarisation se manifeste géographiquement (zones urbaines vs. rurales), culturellement (laïcs vs. religieux conservateurs) et médiatiquement (écosystèmes informationnels séparés).
Culture wars (guerres culturelles) : conflits sociétaux portant sur des valeurs fondamentales : mémoire historique (esclavage, droits civiques), identités (race, genre, orientation sexuelle), éducation (contenus scolaires), religion (place dans l’espace public). Ces guerres culturelles structurent le débat politique américain depuis les années 1990.
Rétrécissement du corps électoral (voter suppression) : ensemble de mesures légales visant à restreindre l’accès au vote de certaines catégories de la population (notamment minorités, jeunes, précaires) : durcissement des conditions d’identification, réduction du vote par correspondance, fermeture de bureaux de vote dans certains quartiers, purges de listes électorales.
Gerrymandering : redécoupage partisan des circonscriptions électorales pour favoriser un parti politique, en concentrant les électeurs adverses dans un minimum de circonscriptions ou en les diluant dans plusieurs. Pratique légale mais controversée aux États-Unis.
Violence politique institutionnalisée : normalisation de la violence (verbale et physique) comme mode d’action politique légitime, avec un continuum allant de la rhétorique agressive à l’intimidation, aux menaces et aux actes violents contre élus, fonctionnaires et citoyens.
MAGA (Make America Great Again) : mouvement politique et idéologique structuré autour de Donald Trump, combinant nationalisme économique, conservatisme culturel, christianisme évangélique et rejet des élites. Le MAGA transcende le Parti républicain traditionnel.
Bibliographie/sitographie pour l’enseignant
Sources académiques et think tanks
- Brennan Center for Justice (analyse des réformes électorales) : https://www.brennancenter.org/
- Pew Research Center (données sur polarisation) : https://www.pewresearch.org/
- Institut Montaigne (analyses politique américaine) : https://www.institutmontaigne.org/
Médias de référence
- Le Grand Continent (analyses géopolitiques en français) : https://legrandcontinent.eu/
- The Atlantic (analyses longues, perspective démocrate)
- The National Review (perspective conservatrice)
Ouvrages récents
- Amy Greene, L’Amérique face à ses fractures (2025) – finaliste prix géopolitique FMES
- Cole Stangler, Le miroir américain : enquête sur la radicalisation des droites et l’avenir de la gauche (2025)
- Cole Stangler, Classe à part : aux origines de la colère américaine (analyse désindustrialisation)
Articles de référence pour ce module
- Wikipédia FR, « Assassinat de Charlie Kirk » : https://fr.wikipedia.org/wiki/Assassinat_de_Charlie_Kirk
- Le Grand Continent, « Le discours intégral de Pete Hegseth aux généraux américains » (30 sept. 2025) : https://legrandcontinent.eu/fr/2025/09/30/les-etats-unis-doivent-se-preparer-a-la-guerre-le-discours-integral-de-pete-hegseth-aux-generaux-americains/
- France 24, « Des dizaines d’Américains congédiés pour avoir critiqué Charlie Kirk » (14 sept. 2025) : https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20250914-des-am%C3%A9ricains-sanctionn%C3%A9s-pour-avoir-critiqu%C3%A9-charlie-kirk-apr%C3%A8s-sa-mort
- Radio-Canada, « La carte électorale comme arme politique aux États-Unis » (août 2025) : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2184176/decoupage-electoral-texas-gerrymandering-donald-trump
III – DOSSIER DOCUMENTAIRE
📄 Document 1 : L’assassinat de Charlie Kirk, événement cristallisateur
Source : Wikipédia (article encyclopédique), « Assassinat de Charlie Kirk »
Nature : Article encyclopédique synthétique
Date : Mise à jour régulière (dernière consultation novembre 2025)
Extrait sélectionné :
« Tandis qu’il s’adresse à la foule au sujet de la violence par armes à feu, le militant républicain conservateur d’extrême droite Charlie Kirk est pris pour cible par un tireur dissimulé. Grièvement blessé au cou, il perd immédiatement connaissance et s’effondre dans son fauteuil. […] L’assassinat de Charlie Kirk s’inscrit dans une série de violences politiques aux États-Unis notamment l’attaque du Capitole le 6 janvier 2021, l’agression au marteau contre Paul Pelosi en octobre 2022, la tentative d’assassinat de juillet 2024 contre Donald Trump puis celle de septembre 2024, l’assassinat du PDG d’UnitedHealthcare Brian Thompson en décembre 2024, l’incendie criminel visant la résidence du gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro en avril 2025, le meurtre de deux employés de l’ambassade d’Israël à Washington D.C. en mai 2025, ainsi que les attentats contre des députés du Minnesota en juin 2025 qui ont coûté la vie à Melissa Hortman, députée à la Chambre des représentants du Minnesota, et à son mari, et blessé le député John Hoffman ainsi que son épouse. »
Consignes d’analyse pour les élèves :
- Identifier les circonstances de l’assassinat (lieu, contexte, réaction de Trump)
- Replacer cet événement dans une série de violences politiques (2021-2025)
- Analyser la rhétorique de Trump après l’assassinat (« gauche radicale »)
Éclairages scientifiques pour l’enseignant :
- Charlie Kirk (1993-2025) était cofondateur de Turning Point USA (2012), principal mouvement de jeunesse conservatrice aux États-Unis
- L’assassin, Tyler Robinson (22 ans), avait « ouvertement exprimé sa haine pour les opinions de Charlie Kirk » selon les autorités
- La réaction de Trump est caractéristique : mise en accusation immédiate de la « gauche radicale », mise en berne des drapeaux, promesse de médaille présidentielle posthume
- Mike Jensen (Université du Maryland) évalue à 150 le nombre d’attentats à caractère politique sur les 6 premiers mois de 2025, soit le double de 2024
Pistes d’exploitation :
- Débat : La violence politique est-elle devenue « normale » aux États-Unis ?
- Comparaison : Violences politiques en France (attentat contre Macron 2018, gifle 2021…)
- Analyse rhétorique : Comment Trump instrumentalise-t-il cet assassinat ?
Document 2 : Réformes électorales restrictives – Le cas du Texas
Source : Radio-Canada, « La carte électorale comme arme politique aux États-Unis »
Nature : Reportage journalistique
Date : 8 août 2025
Extrait sélectionné :
« « Nous avons droit à cinq sièges supplémentaires », a lancé le locataire de la Maison-Blanche, mardi, sur les ondes du réseau NBC. Il faisait référence au Texas, où les troupes républicaines et le gouverneur Greg Abbott veulent rebattre les cartes électorales. […] En plus du Texas, d’autres responsables républicains envisagent de redessiner des circonscriptions pour favoriser leur camp, à la demande de Donald Trump. C’est le cas au Missouri, en Floride, dans l’Indiana, au New Hampshire et en Ohio. »
Consignes d’analyse pour les élèves :
- Expliquer le mécanisme du gerrymandering
- Identifier les États concernés et le parti à l’initiative
- Évaluer l’impact potentiel sur les élections de mi-mandat 2026
Éclairages scientifiques pour l’enseignant :
- Le redécoupage devrait normalement avoir lieu tous les 10 ans (recensement), le prochain étant prévu pour 2030
- Trump fait pression pour un redécoupage anticipé afin de sécuriser les midterms de 2026
- Le terme « gerrymandering » provient de 1812 (gouverneur Elbridge Gerry + salamander)
- Selon l’article, « il suffit dans plusieurs États qu’il y ait juste 1 ou 2 sièges qui bougent du fait de la redivision des circonscriptions électorales, et ça donnerait facilement une petite majorité aux Républicains »
- Paradoxe : les États démocrates (Californie, New York) ont des garde-fous constitutionnels qui compliquent le contre-gerrymandering
Pistes d’exploitation :
- Carte : Localiser les États pratiquant le gerrymandering
- Comparaison : Mode de scrutin et découpage en France
- Débat : Le gerrymandering est-il compatible avec la démocratie ?
Document 3 : Violence politique institutionnalisée – Données FBI
Source : Euronews, « Le suspect dans le meurtre de Charlie Kirk est en détention »
Nature : Dépêche d’agence (AFP via Euronews)
Date : 17 septembre 2025
Extrait sélectionné :
« Mike Jensen, chercheur sur les violences politiques à l’Université du Maryland, évalue le nombre d’attentats à caractère politique à 150 au cours des six premiers mois de 2025, soit deux fois plus que pour la même période en 2024 : Jensen affirme ainsi que l’assassinat de Kirk s’inscrit dans une augmentation des tensions nationales induite par l’insécurité économique, les craintes liées à l’immigration et la rhétorique politique toujours plus agressive. »
Consignes d’analyse pour les élèves :
- Quantifier l’ampleur de la violence politique (données chiffrées)
- Identifier les facteurs explicatifs selon le chercheur Jensen
- Analyser l’évolution temporelle (comparaison 2024/2025)
Éclairages scientifiques pour l’enseignant :
- Mike Jensen est chercheur spécialisé sur les violences politiques à l’Université du Maryland (institution de référence)
- Le doublement des incidents en un an (75 en 2024 → 150 en 2025) suggère une accélération préoccupante
- Les facteurs explicatifs identifiés : (1) insécurité économique, (2) immigration, (3) rhétorique politique agressive
- Le rapport FBI de juillet 2025 alertait déjà sur « la montée des groupes extrémistes intérieurs, y compris dans les milieux pro-Trump »
Pistes d’exploitation :
- Graphique : Évolution de la violence politique aux USA (2020-2025)
- Débat : La rhétorique politique peut-elle causer des actes violents ?
- Comparaison : Violence politique en Europe (assassinats de Jo Cox, Walter Lübcke, Samuel Paty…)
📄 Document 4 : Discours de Pete Hegseth – Militarisation et culture wars
Source : Le Grand Continent, « Le discours intégral de Pete Hegseth aux généraux américains »
Lien : https://legrandcontinent.eu/fr/2025/09/30/les-etats-unis-doivent-se-preparer-a-la-guerre-le-discours-integral-de-pete-hegseth-aux-generaux-americains/
Nature : Transcription intégrale commentée
Date : 30 septembre 2025 (discours) / 1er octobre 2025 (publication)
Extrait sélectionné :
« Bonjour et bienvenue au Département de la Guerre, car l’ère du Department of Defense est terminée. Voyez-vous, la devise de mon premier peloton était : « Ceux qui aspirent à la paix doivent se préparer à la guerre ». […] Nous rétablissons l’éthique du guerrier. »
Consignes d’analyse pour les élèves :
- Analyser la symbolique du renommage « Défense » → « Guerre »
- Identifier les références culturelles et historiques mobilisées
- Expliquer ce qu’Hegseth entend par « éthique du guerrier »
Éclairages scientifiques pour l’enseignant :
- Le poste de « secrétaire à la Guerre » avait disparu en 1947 (création du Dept. of Defense)
- Hegseth a été confirmé de justesse (vote décisif de J.D. Vance), ce qui fait de lui le 2e membre de cabinet confirmé grâce au VP (après Betsy DeVos en 2017)
- Le discours devant 800 généraux et amiraux réunis à Quantico est inédit en temps de paix
- « Éthique du guerrier » = attaque contre les politiques DEI (Diversity, Equity, Inclusion) jugées « woke »
- Hegseth a supprimé les programmes diversité dans l’armée et instauré des standards physiques stricts
Pistes d’exploitation :
- Analyse rhétorique : Procédés de persuasion utilisés par Hegseth
- Débat : Une armée peut-elle/doit-elle être « apolitique » ?
- Comparaison : Politiques de diversité dans les armées européennes
Document 5 : Fractures économiques – Grèves chez Amazon et Starbucks
Source : Novethic, « Chez Amazon et Starbucks, l’heure est à la grève »
Nature : Article de presse économique
Date : 23 décembre 2024
Extrait sélectionné :
« C’est ‘la plus grande grève de l’histoire contre Amazon’. Voilà les mots de la puissante organisation des Teamsters (IBT) qui dit représenter environ 10 000 personnes travaillant pour Amazon. […] En ligne de mire : le nouveau patron [de Starbucks], Brian Niccol, dont le salaire de base de 1,6 million de dollars hors bonus et stock options avait déjà fait polémique en août lors de son arrivée. ‘Brian Niccol, PDG de Starbucks, gagne environ 50 000 dollars de l’heure et se rend au travail en jet privé.' »
Consignes d’analyse pour les élèves :
- Identifier les revendications des grévistes
- Analyser les inégalités salariales (PDG vs. employés)
- Contextualiser ces grèves dans la situation économique américaine
Éclairages scientifiques pour l’enseignant :
- Grèves lancées en décembre 2024 (période de Noël = moment stratégique)
- Amazon : 7 sites concernés (NY, Atlanta, Californie, Illinois), environ 10 000 travailleurs
- Starbucks : 525 magasins syndiqués (Workers United), 11 000 baristas, grève dans 50 succursales
- Les deux entreprises accusées de pratiques antisyndicales
- Contexte : « administration Trump hostile à toute revalorisation du salaire minimum fédéral »
- Inégalités : PDG Starbucks = 50 000$/heure vs. salaire moyen barista ≈ 18$/heure
Pistes d’exploitation :
- Calcul : Comparer les salaires annuels (PDG vs. employés)
- Débat : Les grèves sont-elles un moyen d’action efficace ?
- Comparaison : Mouvement syndical USA vs. France
Document 6 : Répression post-assassinat Kirk – Climat de peur
Source : France 24, « Des dizaines d’Américains congédiés pour avoir critiqué Charlie Kirk »
Nature : Reportage journalistique
Date : 14 septembre 2025
Extrait sélectionné :
« Ils passent au peigne fin les comptes aux commentaires acerbes : ‘Téléchargez leur photo de profil, comparez-la avec leur profil LinkedIn, trouvez leur lieu de travail, appelez leur employeur et laissez des avis Google’, enjoint ainsi l’influenceur conservateur Joey Mannarino. […] Son ministre de la Défense, Pete Hegseth, a ordonné à ses services d’identifier tout membre de l’armée qui se serait moqué ou réjoui de l’assassinat du héraut de l’Amérique chrétienne et traditionaliste. »
Consignes d’analyse pour les élèves :
- Analyser les méthodes de répression utilisées (réseaux sociaux, employeurs)
- Identifier les acteurs impliqués (influenceurs, gouvernement, entreprises)
- Évaluer l’impact sur la liberté d’expression
Éclairages scientifiques pour l’enseignant :
- « Des dizaines de personnes » licenciées pour avoir critiqué Kirk sur les réseaux sociaux
- Campagne orchestrée par des influenceurs conservateurs (Laura Loomer, Joey Mannarino)
- Implication gouvernementale : Pete Hegseth ordonne une enquête dans l’armée
- Un enseignant de l’Oklahoma fait l’objet d’une enquête du ministère de l’Éducation de l’État
- Un fonctionnaire de la FEMA (agence catastrophes naturelles) dénoncé publiquement
- Climat de peur : autocensure, surveillance mutuelle, délations
Pistes d’exploitation :
- Débat : Où s’arrête la liberté d’expression ?
- Comparaison : Cancel culture de droite vs. de gauche
- Analyse : Mécanismes de surveillance sociale (réseaux sociaux)
IV – ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
ACTIVITÉ 1 : Cartographier les fractures américaines
Objectif : Visualiser les multiples dimensions de la polarisation (HGGSP/EMC)
Durée : 1h
Modalités : Travail en groupes (3-4 élèves)
Compétences : Réaliser des productions graphiques, synthétiser des informations
Consigne : à partir des documents fournis et de recherches complémentaires, réalisez une carte mentale ou une carte géographique des États-Unis mettant en évidence les différentes lignes de fracture de la société américaine en 2025.
Fractures à représenter :
- Géographique : États urbains/côtiers vs. ruraux/continentaux
- Politique : États républicains (red states) vs. démocrates (blue states)
- Religieuse : Zones à forte présence évangélique vs. zones sécularisées
- Économique : Zones touchées par la désindustrialisation vs. centres tech/finance
- Violence politique : Localisation des incidents recensés (2025)
- Réformes électorales : États pratiquant le gerrymandering ou les restrictions de vote
Supports possibles :
- Carte mentale (format papier ou numérique : Mindomo, XMind, Coggle)
- Carte géographique annotée (Google My Maps, Khartis, fond de carte papier)
Production attendue :
- Carte lisible avec légende structurée
- Notice explicative (200 mots) : « Quelle est la fracture la plus structurante selon vous ? »
Prolongement : comparer avec une carte de la France métropolitaine (fractures territoriales, vote, gilets jaunes…)
ACTIVITÉ 2 : Timeline comparative des crises démocratiques américaines
Objectif : Contextualiser 2025 dans l’histoire longue des États-Unis (HGGSP)
Durée : 1h30
Modalités : Travail en binômes
Compétences : Contextualiser, analyser, comparer
Consigne : Construisez une frise chronologique comparative mettant en parallèle la crise actuelle (2024-2025) et trois crises démocratiques passées aux États-Unis.
Périodes de comparaison proposées :
- Loi sur la sédition (Sedition Act, 1918) : Répression des opposants à la Première Guerre mondiale
- Maccarthysme (1950-1954) : « Grande peur » du communisme, purges, listes noires
- Années 1960-1970 : Assassinats politiques (JFK, MLK, RFK), violences urbaines, Garde nationale sur les campus (Kent State 1970)
Éléments à comparer :
- Contexte politique et social
- Formes de violence (verbale, physique, institutionnelle)
- Acteurs impliqués (gouvernement, mouvements sociaux, médias)
- Réactions institutionnelles (répression, réformes)
- Issue de la crise
Questions de synthèse :
- Quels points communs identifiez-vous entre ces crises ?
- Quelles différences majeures distinguent 2025 des périodes passées ?
- Selon vous, l’Amérique de 2025 est-elle plus ou moins résiliente que lors des crises précédentes ?
Sources potentielles :
- Manuels d’histoire américaine
- Wikipédia (articles en anglais pour plus de détails)
- Documentaires : « The Vietnam War » (Ken Burns), « Eyes on the Prize » (droits civiques)
ACTIVITÉ 3 : Débat mouvant – « La démocratie américaine est-elle irréversiblement fragilisée ? »
Objectif : Développer l’argumentation orale et la capacité à changer de perspective (EMC)
Durée : 1h
Modalités : Classe entière
Compétences : Argumenter, écouter, changer de point de vue
Protocole du débat mouvant :
- Disposition : Diviser la salle en deux zones (« OUI » / « NON ») avec une zone neutre au centre
- Première position : Chaque élève se place selon sa conviction initiale
- Phase d’argumentation : Tour de parole, les élèves argumentent depuis leur position
- Mobilité : À tout moment, un élève peut changer de zone s’il est convaincu par un argument
- Synthèse finale : Bilan collectif
Arguments « OUI » (fournis aux élèves) :
- 150 incidents politiques violents en 6 mois (doublement vs. 2024)
- Normalisation de la violence dans le discours politique
- Réformes électorales visant à restreindre le vote (Texas, Floride, Géorgie)
- Disparition d’une « vérité commune » partagée (médias polarisés)
- Affaiblissement du Congrès face au pouvoir exécutif
- Instrumentalisation de l’armée (renommage en « département de la Guerre »)
- Censure éducative et réécriture mémorielle dans plusieurs États
Arguments « NON » (fournis aux élèves) :
- Résilience historique prouvée (USA a surmonté guerre civile, maccarthysme, années 1960-70)
- Institutions démocratiques encore solides (élections régulières, alternance possible)
- Société civile active (mouvements sociaux, grèves chez Amazon/Starbucks)
- Justice indépendante (arrestation du suspect Kirk, enquêtes en cours)
- Émergence de nouveaux leaders démocrates (Spanberger, Sherrill, Mamdani)
- Victoires électorales démocrates locales (Californie, New York, New Jersey 2025)
Rôle de l’enseignant :
- Modérer les prises de parole
- Reformuler les arguments
- Relancer le débat si nécessaire
- Ne PAS donner sa position personnelle
Synthèse : demander aux élèves qui ont changé d’avis d’expliquer pourquoi
ACTIVITÉ 4 : Étude de cas comparée – Réformes électorales USA/France
Objectif : Identifier les enjeux démocratiques communs au-delà du cas américain (EMC)
Durée : 1h30
Modalités : Groupes de 4 élèves
Compétences : Comparer, analyser, critiquer
Consigne : Comparez les dispositifs électoraux américains et français en matière de participation électorale, puis analysez les débats actuels dans chaque pays.
Phase 1 : Tableau comparatif (30 min)
| Critère | États-Unis | France |
|---|---|---|
| Inscription électorale | Démarche volontaire (sauf quelques États) | Inscription automatique |
| Vote par correspondance | Restreint dans certains États (TX, FL, GA) | Vote par procuration encadré |
| Documents d’identité | Exigences variables selon États | Pièce d’identité obligatoire |
| Accessibilité bureaux de vote | Fermetures dans quartiers urbains | Maillage territorial homogène |
| Jour de vote | Mardi (jour travaillé) | Dimanche |
| Débats actuels | Gerrymandering, purges listes | Vote obligatoire ? Inscription auto ? |
Phase 2 : Analyse des débats français (30 min) Rechercher et synthétiser les débats français sur :
- Le vote obligatoire (Belgique, Luxembourg)
- L’inscription automatique (réforme 2019)
- Le vote électronique (abandonné)
- L’abaissement de l’âge du vote à 16 ans
Phase 3 : Synthèse comparative (30 min) Questions de réflexion :
- Quels dispositifs favorisent la participation électorale ?
- Les restrictions américaines ont-elles des équivalents en France ?
- La France devrait-elle s’inspirer de certaines pratiques américaines (vote anticipé par exemple) ?
Production : Présentation orale (5 min) avec support visuel
ACTIVITÉ 5 : Analyse critique de la rhétorique politique
Objectif : Identifier les procédés rhétoriques et leur impact sur la polarisation (HGGSP/EMC)
Durée : 1h
Modalités : Travail individuel puis mise en commun
Compétences : Analyser un discours, identifier des procédés rhétoriques, développer l’esprit critique
Corpus de discours :
- Donald Trump (10 septembre 2025, après assassinat Kirk) : Accusation de la « gauche radicale »
- Pete Hegseth (30 septembre 2025, Quantico) : « Bienvenue au département de la Guerre »
- Erika Kirk (veuve, obsèques) : « Je pardonne le tueur »
- Lynne Fox (présidente Workers United) : Critique de Starbucks
Grille d’analyse (à compléter pour chaque discours) :
| Procédé rhétorique | Exemple dans le discours | Effet recherché |
|---|---|---|
| Désignation d’un ennemi | ||
| Hyperbole / exagération | ||
| Appel à l’émotion | ||
| Référence religieuse | ||
| Référence historique | ||
| Vocabulaire militaire | ||
| Victimisation |
Questions de synthèse :
- Quels procédés sont communs à plusieurs discours ?
- Comment ces discours contribuent-ils à la polarisation ?
- Identifiez un discours cherchant au contraire à apaiser les tensions
Prolongement : Analyser un discours politique français récent avec la même grille (Macron, Mélenchon, Le Pen, Bardella…)
ACTIVITÉ 6 : Scénarios prospectifs 2026-2028
Objectif : Développer la pensée prospective et l’argumentation (EMC)
Durée : 2h
Modalités : Groupes de 4 élèves
Compétences : Anticiper, scénariser, argumenter, présenter
Consigne : À partir de la situation actuelle (novembre 2025), imaginez trois scénarios plausibles pour l’évolution politique américaine jusqu’en 2028 (élection présidentielle).
Scénario A : « Aggravation » (pessimiste)
- Hypothèses : Violence politique accrue, nouvelles restrictions électorales, affaiblissement des institutions
- Événements déclencheurs possibles : Nouveaux assassinats, contestation résultats midterms 2026
- Issue en 2028 : ?
Scénario B : « Stabilisation » (médian)
- Hypothèses : Maintien du statu quo, polarisation persistante mais sans escalade majeure
- Événements déclencheurs possibles : Compromis bipartisans limités, jurisprudence Cour suprême
- Issue en 2028 : ?
Scénario C : « Rebond démocratique » (optimiste)
- Hypothèses : Victoire démocrate aux midterms 2026, mobilisation citoyenne, réformes institutionnelles
- Événements déclencheurs possibles : Scandales administration Trump, lassitude électorat MAGA
- Issue en 2028 : ?
Méthodologie :
- Choisir un scénario (un groupe par scénario, plusieurs groupes peuvent travailler sur le même)
- Identifier 5-6 événements clés entre 2025 et 2028
- Construire une chronologie plausible
- Imaginer l’issue de l’élection présidentielle 2028
- Justifier chaque étape avec des éléments du dossier documentaire
Production attendue :
- Frise chronologique illustrée (2025-2028)
- Présentation orale (10 min) : narration du scénario
- Débat : Quel scénario est le plus probable ?
Prolongement : Organiser un vote de la classe pour déterminer le scénario jugé le plus plausible
V – PISTES DE PROLONGEMENT
Vers des modules satellites
Ce questionnement central sur la démocratie peut se prolonger vers des modules satellites :
Module A : « Médias, information et vérité »
- Rôle de Fox News dans l’écosystème conservateur
- Polarisation des écosystèmes informationnels
- Post-vérité et « alternative facts »
- Lien : Document 3 (disparition d’une « vérité commune »)
Module B : « Culture wars et mémoire »
- Censure éducative en Floride et au Texas
- Réécriture des manuels d’histoire
- Débats sur l’esclavage et les droits civiques
- Lien : Document 4 (discours Hegseth, suppression programmes DEI)
Module C : « Religion et politique »
- Rôle des évangéliques dans le mouvement MAGA
- Messianisme politique (Trump comme « roi David »)
- Sécularisation vs. retour du religieux
- Lien : Document 1 (Kirk comme « héraut de l’Amérique chrétienne »)
Module D : « Violence politique et État de droit »
- Normalisation de la violence
- Déploiement militaire sur sol américain
- Institutions et contre-pouvoirs
- Lien : Documents 1, 3, 6 (assassinat, données FBI, répression)
Ressources complémentaires
Films et documentaires
- Vice (2018) : Sur Dick Cheney et la guerre en Irak (contexte historique)
- The Social Dilemma (2020) : Polarisation et réseaux sociaux
- The Order (2024) : sur l’extrême droite US
- États-Unis : une élection sous IA (La fabrique du mensonge – 2024) : retour sur l’élection présidentielle et le poids pris par l’IA
Podcasts
- The Daily (New York Times) : Analyses quotidiennes actualité américaine
- Pod Save America : Perspective progressiste
- The Ben Shapiro Show : Perspective conservatrice (pour comprendre l’autre camp)
Séries et fiction
- The West Wing : Fonctionnement institutionnel (idéalisé)
- House of Cards : Cynisme politique
- The Handmaid’s Tale : Dystopie théocratique (débat sur le réalisme)
- The Loudest voice : sur la montée de FOX NEWS
Articles de fond
- The Atlantic, « How America Ends » (décembre 2019) : Scénarios de rupture démocratique
- Foreign Affairs : Analyses géopolitiques
Ouverture sur l’actualité
Suivre l’actualité américaine :
- Midterms de 2026 (novembre) : Observer les résultats, analyser les tendances
- Primaires présidentielles 2027-2028 : Qui succédera à Trump dans le camp MAGA ?
- Élection présidentielle 2028 : Trump ne peut pas se représenter (22e amendement)
Questions à suivre :
- JD Vance peut-il incarner l’héritage trumpiste ?
- Les démocrates trouvent-ils un leader mobilisateur ?
- La violence politique continue-t-elle à augmenter ?
- Quelles réformes institutionnelles sont adoptées (ou bloquées) ?
VI – ANNEXES
Glossaire pour les élèves
Alt-right : Mouvance d’extrême droite américaine utilisant Internet, mélangeant nationalisme blanc, anti-immigration et culture troll.
DEI (Diversity, Equity, Inclusion) : Politiques visant à promouvoir la diversité et l’égalité, critiquées par les conservateurs comme « idéologie woke ».
Midterms : Élections de mi-mandat aux États-Unis (tous les 2 ans), renouvelant la Chambre des représentants et 1/3 du Sénat.
MAGA (Make America Great Again) : Slogan et mouvement politique de Donald Trump, devenu identité politique à part entière.
Red state / Blue state : États majoritairement républicains (rouge) ou démocrates (bleu).
Swing state : État « pivot » dont le vote peut basculer d’un parti à l’autre (Pennsylvanie, Arizona, Géorgie…).
Turning Point USA : Organisation de jeunesse conservatrice fondée par Charlie Kirk en 2012.
Woke : À l’origine, éveil aux injustices raciales ; devenu terme péjoratif chez les conservateurs pour désigner le progressisme culturel.
Grilles d’évaluation formative
Pour l’activité cartographie (Activité 1)
| Critère | Insuffisant | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|
| Lisibilité de la carte | Difficile à lire | Globalement lisible | Très claire |
| Nombre de fractures représentées | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
| Pertinence de la légende | Incomplète | Complète | Structurée et explicite |
| Notice explicative | Superficielle | Argumentée | Approfondie et nuancée |
Pour l’activité débat (Activité 3)
| Critère | À améliorer | Satisfaisant | Excellent |
|---|---|---|---|
| Participation orale | Silence ou interventions hors sujet | Quelques interventions pertinentes | Plusieurs interventions argumentées |
| Qualité de l’écoute | Coupe la parole, n’écoute pas | Écoute passive | Écoute active, rebondit sur arguments |
| Évolution de la pensée | Aucune, position figée | Interrogations, hésitations | Changement de position assumé |
| Respect des autres | Agressif, méprisant | Courtois | Bienveillant, valorise arguments adverses |
Pour l’activité scénarios (Activité 6)
| Critère | Insuffisant | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|
| Plausibilité du scénario | Irréaliste, contradictoire | Globalement cohérent | Très plausible, bien justifié |
| Ancrage dans les documents | Peu ou pas de références | Quelques références | Nombreuses références précises |
| Qualité de la présentation orale | Hésitante, confuse | Claire | Captivante, structurée |
| Argumentation | Assertions non justifiées | Arguments corrects | Arguments solides et nuancés |