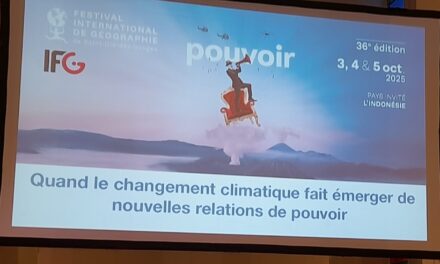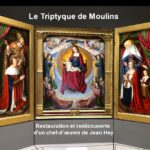Un débat sur les inégalités, les logiques économiques et les défis contemporains du système de santé Animé par Lou Héliot et trois internants :
-
- Virginie Chasles professeure de géographie ;
- Clélia Gasquet-Blanchard directrice d’un réseau régional de santé ;
- Christian Rabaud professeur de maladies infectieuses.
La santé, bien plus qu’une question médicale
La santé ne peut se réduire à l’absence de maladie. Virginie Chasles rappelle la définition adoptée par l’OMS en 1948 :nun état de bien-être physique, mental et social – reste pertinente malgré ses limites.
Elle offre une grille de lecture essentielle pour comprendre les déterminants sociaux, environnementaux et politiques qui influencent la santé des populations. Christian Rabaud complète cette analyse en soulignant l’émergence de nouvelles priorités, comme la santé mentale et sexuelle, particulièrement mises en lumière par la crise du Covid-19. La pandémie a en effet révélé les lacunes d’un système souvent centré sur le curatif, alors que les besoins en prévention et en approche globale des patients n’ont jamais été aussi pressants.
Cette vision élargie permet de saisir pourquoi les inégalités face à la santé persistent, voire se creusent. Les écarts d’espérance de vie entre catégories sociales peuvent atteindre jusqu’à treize ans, les femmes cadres vivant non seulement plus longtemps, mais aussi en meilleure santé que les hommes ouvriers. Ces disparités ne sont pas le fruit du hasard : elles résultent de mécanismes structurels qui avantage certains groupes au détriment d’autres, tout au long de la vie.
Des inégalités sociales et territoriales criantes
Les territoires ne sont pas égaux face à la santé. Clélia Gasquet-Blanchard pointe du doigt des situations alarmantes, comme celle de la Seine-Saint-Denis, où la mortalité infantile atteint des niveaux comparables à ceux de pays européens moins développés. Plus troublant encore, le suicide est devenu la première cause de mortalité maternelle dans l’année suivant un accouchement, touchant particulièrement les femmes issues des classes moyennes. Pour les populations les plus précaires, ce sont les décès évitables, liés à un accès insuffisant ou tardif aux soins, qui dominent.
Les déserts médicaux ne sont d’ailleurs pas l’apanage des zones rurales. Certains quartiers urbains défavorisés cumulent précarité économique et manque criant d’infrastructures de santé adaptées. Par ailleurs, les biais de genre dans la prise en charge médicale restent préoccupants. Les protocoles sont souvent conçus pour et par les hommes. Ils peinent à détecter correctement les symptômes féminins. À l’inverse, les hommes, moins enclins à consulter, présentent des taux de suicide plus élevés, souvent par des méthodes plus violentes.
La question des écrans, évoquée par Christian Rabaud, illustre un autre défi contemporain. Le recours systématique aux smartphones pour « calmer » les enfants agités pose problème. Il remplace une médication parfois excessive, mais crée de nouvelles dépendances aux conséquences encore mal mesurées sur le développement et la santé mentale des jeunes.
Quand la logique économique prend le pas sur le soin
Depuis les années 1980, le système de santé a subi une transformation profonde sous l’effet du néolibéralisme. Clélia Gasquet-Blanchard décrit comment le new public management a progressivement imposé une logique de rentabilité à l’hôpital public. La tarification à l’activité (T2A), présentée comme un outil de modernisation, a en réalité accéléré le rythme des soins au détriment de leur qualité. Les soignants voient leur temps de contact avec les patients se réduire, alors même que la relation humaine est un facteur clé de guérison. Cette pression constante contribue à la crise des vocations et à la précarisation des équipes, avec le développement de plateformes d’intérim qui fragmentent les collectifs de travail.
Le résultat est un système à bout de souffle, où les impératifs financiers priment souvent sur les besoins des patients. Les soignants, démunis face à cette dérive, voient leur métier perdre peu à peu son sens. Pourtant, comme l’ont souligné les intervenants, c’est bien cette dimension humaine du soin qui fait la différence en termes d’efficacité et de satisfaction des patients.
La santé, enjeu de pouvoir sur la scène internationale
La santé est aussi devenue un instrument de soft power. Virginie Chasles a montré comment des pays comme la Chine ou l’Inde utilisent la médecine traditionnelle, les dons de vaccins ou la promotion du yoga pour étendre leur influence géopolitique. Pendant la crise du Covid-19, ces stratégies se sont accélérées, avec des envois ciblés de masques et de médicaments qui ont servi des intérêts diplomatiques autant qu’humanitaires.
Cette dimension géopolitique a aussi révélé la dépendance dangereuse de l’Occident vis-à-vis de la production pharmaceutique asiatique. La pénurie de masques au début de la pandémie a servi de révélateur : nos systèmes de santé sont vulnérables parce que trop dépendants de chaînes d’approvisionnement lointaines et peu diversifiées.
Le Covid-19 : un test grandeur nature pour nos systèmes de santé
La crise sanitaire a démontré une capacité remarquable d’adaptation. En quelques semaines, les hôpitaux ont pu multiplier leurs capacités d’accueil en réanimation, prouvant que la flexibilité et la mobilisation collective pouvaient sauver des vies. Pour la première fois, la logique de rentabilité a été mise entre parenthèses au profit d’un impératif simple : soigner, « quoi qu’il en coûte ».
Pourtant, une fois la crise passée, le retour à la normale a aussi signifié le retour des anciennes contraintes budgétaires. Pire, les inégalités sociales mises en lumière par la pandémie – accès aux soins, conditions de confinement, exposition au virus – n’ont pas donné lieu à des politiques publiques ambitieuses pour les réduire. Certains territoires, comme Mayotte, ont même été le théâtre de pratiques discutables, avec des propositions de ligatures de trompes post-accouchement qui interrogent sur le respect des droits fondamentaux.
Prévention et innovation : des pistes pour l’avenir ?
Un médecin généraliste présent dans le public attire l’attention sur un paradoxe préoccupant. Les jeunes médecins maîtrisent de mieux en mieux les examens high-tech, mais délaissent l’examen clinique de base. Cette désaffection pour la clinique est aggravée par le développement de la téléconsultation. Cela affaiblit la qualité des diagnostics et alourdit inutilement les dépenses de santé. Christian Rabaud reconnait l’importance des initiatives comme les « Rendez-vous Prévention ». Ils proposent des bilans gratuits à différents âges de la vie. Mais ces dispositifs se heurtent à un problème de taille. Les systèmes d’accompagnement qui devraient prendre le relais sont souvent saturés, voire inexistants.
La question de la prévention est d’autant plus cruciale face aux défis environnementaux. Pollution, dérèglement climatique, maladies émergentes liées à la déforestation… Les menaces sont multiples, mais les réponses peinent à s’organiser. Le concept de One Health, qui vise à penser ensemble santé humaine, animale et environnementale, suscite l’intérêt. Virginie Chasles met cependant en garde contre le risque de dilution des responsabilités. Sous couvert d’une approche globale, on pourrait en venir à négliger les inégalités sociales qui restent le cœur du problème.
Un participant a d’ailleurs interrogé les intervenants sur ce point :
One Health ne risque-t-il pas de détourner l’attention des vraies priorités ?
La réponse est nuancée. Cette approche permet de mieux comprendre les interactions entre santé et environnement. Cependant, elle ne doit pas servir d’alibi pour éluder les questions de justice sociale. Christian Rabaud illustre ce propos avec des exemples concrets. Il montre le lien entre déforestation et épidémie d’Ebola, ou entre pratiques d’élevage et maladie de la vache folle. Mais il rappelle aussi que la résistance aux antibiotiques est souvent attribuée à tort à l’élevage. Alors qu’il trouve son origine principale dans la médecine humaine.
Sécurité sociale et écrans : les questions qui fâchent
Le débat avec le public porte sur l’avenir de notre système de protection sociale. Un participant pointe les attaques répétées contre la sécurité sociale depuis vingt ans, s’interrogeant sur sa capacité à résister. Clélia Gasquet-Blanchard rappelle que ce système est moins coûteux à gérer que les mutuelles privées. Il reste un modèle efficace et solidaire. Elle plaide pour une « grande sécu » qui regrouperait toutes les branches (santé, retraite, famille, handicap). Ainsi, on pourrait mieux répondre aux besoins tout au long de la vie.
La question des écrans chez les jeunes a également animé les échanges. Comment protéger les enfants des dangers de la surexposition, alors que les smartphones sont devenus omniprésents ?
Pour Christian Rabaud, les interdits ne suffiront pas : il faut éduquer, expliquer les risques, et surtout donner l’exemple.
Clélia Gasquet-Blanchard élargit la réflexion en liant cette problématique à une évolution plus large de notre société. Dans un contexte de baisse de la natalité, l’enfant est devenu un « projet » parental. Il est investi de toutes les attentes ce qui accentue la pression sur chaque individu.
Vers une refondation du système de santé ?
Les intervenants se sont accordés sur un constat : notre système de santé est à la croisée des chemins. Pour Christian Rabaud, l’urgence est de redonner du sens au métier de soignant. Il faut restaurer la primauté du soin sur la logique comptable. Virginie Chasles a insisté sur la nécessité de renforcer la prévention, trop souvent le parent pauvre des politiques publiques. Quant à Clélia Gasquet-Blanchard, elle a appelé à repenser notre modèle de manière collective, au-delà des clivages politiques traditionnels.
La santé a un coût, mais comme le résume Christian Rabaud en conclusion :
elle n’a pas toujours les moyens de ses ambitions. Entre l’augmentation des dépenses liées aux innovations thérapeutiques et les arbitrages budgétaires (défense, transition écologique…), les choix à venir seront difficiles. Ils devront pourtant être faits, car c’est bien de l’avenir de notre société dont il s’agit.