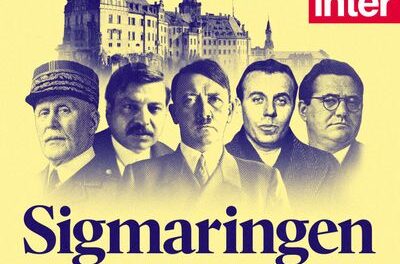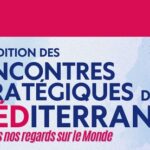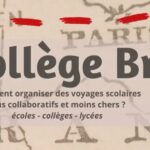Alors que De Gaulle reste dans beaucoup d’évaluation et de sondages récents le Français le plus connu du XXe siècle écoulé, il est intéressant de se demander ce qu’une figure française, adulée ou controversée à l’intérieur de nos frontières, représente au-delà : est-il connu pour son action durant la Guerre ? Pour son rôle de refondateur de la France ? Pour ses initiatives sur la scène mondiale, par-delà la Guerre froide, en direction des pays tiers ? Ou pour sa plume et ses mémoires ?
Pour aussi intéressante qu’elle fut, cette table ronde proposée par la Fondation Charles de Gaulle ne put répondre à toutes ces questions annoncée dans son programme. Elle réunissait, autour de Frédéric Foggaci, Directeur des études et de la recherche de la Fondation, Hervé Gaymard, Président de la Fondation, Maurizio Serra, diplomate, académicien, historien, et Arnaud Teyssier, Président du Conseil scientifique de la Fondation, et auteur d’une récente biographie du général de Gaulle.
La Fondation Charles de Gaulle
Frédéric Fogacci commence par présenter la Fondation, installée rue de Solférino, dans un immeuble qui fut le ministère de la guerre occupé par de Gaulle, puis le siège du RPF.
« Créée en 1971 sous la forme d’un institut puis d’une fondation reconnue d’utilité publique par le décret du 22 septembre 1992, la Fondation Charles de Gaulle entretient en France et dans le monde la mémoire du général de Gaulle et transmet son héritage intellectuel et culturel conformément au vœu qu’il avait exprimé après son départ du pouvoir.
Désireux que cet héritage fût porté par une entité détachée des débats partisans et à l’expertise incontestée, le libérateur de la France et fondateur de nos institutions avait confié à André Malraux la mission d’en être le premier président. Personne mieux que l’auteur de L’Espoir ne pouvait assurer que la mémoire du gaullisme devînt une référence féconde, « source d’ardeurs nouvelles » pour les générations futures.
Seule institution nationale reconnue par l’État pour entretenir la mémoire du général de Gaulle (par le décret du 3 novembre 2005), la Fondation organise sa mission autour de quatre axes :
- La recherche universitaire et la réflexion politique
- Les activités pédagogiques
- La transmission vers le grand public
- Le soutien au rayonnement international »
Comment De Gaulle est-il perçu à l’étranger ?
Il revient à Maurizio Serra de traiter du désamour des Italiens pour De Gaulle. Il distingue deux périodes : les années 1944-1945 et les années 1958-1959. A la Libération, Gaston Palewski est son ambassadeur et De Gaulle fait à Naples un « discours magnifique ». L’ouverture vers l’Italie est franche, la main est tendue. L’Italie ne répond pas, car « on ne veut plus d’un homme fort », même s’il est un démocrate. Pour l’Italie, la référence en France c’est Georges Bidault, résistant et démocrate-chrétien. Les institutions de l’Italie sont proches de celles de la IVème République en France. En 1958-59, c’est la seconde phase de la République italienne, le FLN a son centre officieux à Rome. Le voyage de De Gaulle en juillet 1959 est un immense succès populaire, mais on continue de penser Rome que le pouvoir des partis est supérieur à celui des grands hommes.
La construction européenne convient à l’Italie car elle est « une association de faibles ». L’Italie refuse le rapprochement Paris-Bonn car elle refuse un duopole qui domine en Europe. L’Italie soutient donc l’entrée du Royaume-Uni dans l’Europe. Ce qui maintient l’image négative de De Gaulle. Le Vatican est anti gaullien car il veut maintenir une position forte en Italie.
Arnaud Teyssier évoque les relations du général avec les dirigeants des Etats-Unis. Elles sont excellentes avec Eisenhower, contrastées mais pas mauvaises avec Kennedy, exécrables avec Johnson, excellentes mais brèves avec Nixon.
Approfondissant l’approche, Arnaud Teyssier affirme que De Gaulle n’a pas été bien compris et que la cause est à chercher dans la presse qui le présente comme un dictateur et « n’a pas compris sa position sur le Vietnam et sur le dollar ». Il estime encore que le discours sur le Québec libre n’a pas non plus été compris, ni en France, ni ailleurs. En réalité, affirme Arnaud Teyssier De Gaulle raisonne toujours en terme de civilisation. Se reporter à son essai biographique sur De Gaulle.
L’appel aux peuples
Hervé Gaymard souligne que De Gaulle a toujours voulu s’adresser aux peuples. Il a d’ailleurs réuni ses discours à l’étranger sous le titre « Discours aux peuples du monde »La France est, avec les Etats-Unis, le seul pays à avoir une prétention à l’universalisme. « On comprend qu’il ait pu agacer ». Il montre l’hostilité, l’ironie et le mépris d’une grande partie de la presse allemande, alors que les voyages de De Gaulle montrent sa popularité. Il montre encore que l’opinion publique a soutenu la France libre : c’est en Amérique latine et aux Etats-Unis qu’il y a le plus de comités France libre. En Grand Bretagne, il est soutenu par l’opinion publique et la famille royale.
La vision gaullienne des « invariants stratégiques » nationaux
De Gaulle a une parfaite connaissance de l’histoire et de la géographie, et sa propre conception des civilisations. Il a toujours pensé que l’Allemagne serait unifiée et que la Russie dissoudrait le communisme. Il parlait de Russie et non d’URSS. Arnaud Teyssier pense que, influencé par les moralistes chrétiens du XVIIème siècle, De Gaulle sait que l’homme est faible par essence, que la démocratie est une construction humaine, et que la politique internationale à pour but de la conforter.
Il n’est pas naïf. Il n’a pas une confiance illimitée en l’alliance américaine par exemple. Il pense, comme Raymond Aron, que les Etats-Unis oscillent « entre une hégémonie victorieuse et un retrait méprisant ». Il fait donc de la possession par la France de l’arme nucléaire l’élément central de sa politique internationale. Mais il est un allié solide des Etats-Unis, comme le prouve son attitude lors de la crise de Cuba. A l’ambassadeur américain qui lui apporte des photos des rampes de missiles installées à Cuba, il répond qu’il ne veut pas les voir et le croit sur parole. A l’ambassadeur soviétique qui lui suggère que la France est à portée des missiles soviétiques, il répond « Et bien, Monsieur l’Ambassadeur, nous mourrons ensemble ! ». Mais il sait qu’on ne peut s’en remettre totalement à eux pour la défense européenne, surtout quand la stratégie de la riposte graduée devient la doctrine nucléaire américaine. L’Europe peut alors devenir un champ de bataille.
Les participants font observer que le « couple franco-allemand » n’a jamais vraiment existé sous De Gaulle : en effet, aussitôt signé, le traité de l’Elysée de 1963, fut forclos, le Bundestag ayant voté un texte de la Commission européenne inspiré par Jean Monnet et les Américains, qui lui enlevait sa portée. Après Adenauer, les chanceliers ne sont plus sur la ligne gaullienne. Il faudra attendre Giscard d’Estaing et Mitterrand.
La table ronde se poursuit par des échanges stimulants sur l’héritage, la postérité, la perte d’une vision civilisationnelle et culturelle de l’Europe, l’Europe de la Défense, l’influence de Charles Maurras… et l’Italie de Giorgia Meloni. Leur intérêt n’a d’égal que leur diversité… et la difficulté d’en rendre compte !
On pourra se reporter à la table ron de Blois 2020 : Les temporalités du gouvernement selon Charles de Gaulle