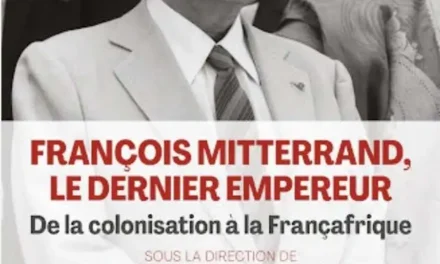Animateur, producteur de radio, Philippe Collin a une formation d’historien. Après avoir participé et animé plusieurs émissions sur France inter, il est devenu producteur de podcasts de grande qualité et au solide contenu historique. Qu’il s’agisse des séries de podcasts consacrée à Philippe Pétain, à Louis-Ferdinand Céline, à Jean-Marie Le Pen, au général Leclerc, ou aux résistantes (tous consultables sur l’application Radio France), il s’assure toujours la collaboration des meilleurs historiens et historiennes. Cette conférence était organisée autour de sa dernière série de podcasts, déjà téléchargée plus d’un million de fois.
En septembre 1944, les collabos français fuient la France pour se réfugier au château de Sigmaringen, en Allemagne. Durant huit mois, cette enclave devient un refuge étrange et sinistre pour l’extrême droite française, entre crainte du châtiment et espoir d’un ultime retournement. Pour revenir sur cet épisode méconnu mais révélateur de l’histoire du nationalisme français, deux des trois historiens principaux qui interviennent dans cette série de huit podcasts étaient présents : Henry Rousso, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste du régime de Vichy, auteur de Un château en Allemagne: la France de Pétain en exil, Sigmaringen, 1944-1945, Ramsay, 1980 (dernière réédition : Fayard/Pluriel, 2012), Pétain et la fin de la collaboration : Sigmaringen, 1944-1945, PUF, 1984, Le Syndrome de Vichy : de 1944 à nos jours, Points, 2016, et Bénédicte Vergez-Chaignon, historienne et biographe de Philippe Pétain, autrice de Pétain, Perrin, 2014, Les secrets de Vichy, Perrin, 2015, Histoire de l’épuration, Larousse, 2010. En l’absence de Renaud Meltz, biographe de Pierre Laval, auteur de Pierre Laval : un mystère français, Perrin, 2018.
Quand l’historien se rend sur les lieux de l’événement qu’il étudie
Le vendredi 29 novembre 2024, gare de l’Est à Paris, Philippe Collin et son équipe embarquent pour Stuttgart avant de rejoindre Sigmaringen. Au château de Sigmaringen, les fantômes du régime de Vichy se retrouvent en exil. Philippe Pétain, Pierre Laval, et les ultras de la Milice de Joseph Darnand cohabitent dans une haine mutuelle et anticipent leur défense à venir. Ainsi s’ouvre le premier podcast de la série.
Henri Rousso a consacré un livre à cet épisode il y a 45 ans, sans faire le déplacement, en travaillant sur les archives. Philippe Collin lui demande, ainsi qu’à Bénédicte Vergez-Chaignon ce que change le fait d’être sur les lieux : ils parcourent les couloirs du château, les rues de la ville, se rendent sur la tombe de Jacques Doriot. Leurs réponses convergent pour en souligner l’importance : constater par exemple l’immensité des couloirs du château, le froid qui y règne, mesurer quel dut être l’inconfort, avoir un rapport charnel et immédiat avec ce qui a été connu par les archives. Henri Rousso mentionne la place de son voyage au Rwanda dans sa compréhension du génocide et estime qu’il devrait y avoir une sensibilisation à la sensualité dans la formation de l’historien, de façon à « s’habituer à une vision des traces par l’ouïe et le regard ». L’historien ne devrait pas craindre d’abandonner un moment la mise à distance
Un chapitre méconnu des Français, ignoré des Allemands
C’est un chapitre méconnu et pourtant fondamental de la Seconde Guerre mondiale : l’étrange refuge de Sigmaringen. Dans l’imposant château de la famille Hohenzollern délogée, un véritable substrat du régime de Vichy se reconstitue, marquant le crépuscule de la collaboration française. L’heure est à la cohabitation, à la justification et à la préparation de la défense à venir.
C’est ici, dans cette forteresse médiévale de plus de 800 pièces réparties sur sept étages, que les vestiges d’un pouvoir déchu trouvent asile. Dès septembre 1944, le maréchal Philippe Pétain, qui n’est plus que le chef de file des fuyards collaborationnistes, s’installe au septième étage dans un appartement de prestige. Quelques jours plus tard, Pierre Laval et son entourage le rejoignent plus bas, au sixième étage, tandis que Fernand de Brinon et les ministres actifs, dont Marcel Déat et Joseph Darnand, s’établissent au cinquième. Une étrange cohabitation débute alors, où règnent l’angoisse et le désœuvrement, donnant le ton d’une opérette pathétique et tragique. Ce château attire non seulement la Milice, mais aussi toute une population de pétainistes et de collaborationnistes en fuite.
Aujourd’hui, sur les lieux, rien ne rappelle cet épisode aux visiteurs pourtant nombreux. L’événement ne fait pas partie du parcours de visite.
Pétain et Laval ont chacun leur étage, s’ignorent et se haïssent
À Sigmaringen, les deux figures majeures de Vichy se tiennent ostensiblement à distance des éléments les plus radicaux de la collaboration. Habitant des étages distincts, ils s’ignorent et se haïssent mutuellement. Leur quotidien est largement monopolisé par une obsession commune : la préparation de leur défense en vue des procès à venir. Pétain, se déclarant prisonnier des Allemands, adopte une attitude très circonspecte et refuse de se montrer ou de recevoir les membres de la commission gouvernementale pro-nazie de Fernand de Brinon. Il cherche à bâtir sa défense sur l’idée qu’il voulait simplement cimenter l’Union française.
De son côté, Laval passe le plus clair de ses journées à faire dactylographier ses quasi-mémoires où il justifie sans relâche sa politique de collaboration, tout en pensant avoir défendu la France.
Le cinquième étage du château abrite les ministres et les plus fidèles du régime hitlérien. Parmi eux, Joseph Darnand, le chef de la Milice et de sa branche paramilitaire, la franc-garde, prétend recréer un gouvernement en exil et incarne l’instrument principal de la collaboration active jusqu’au-boutiste avec les nazis. Ses membres fugitifs se sont aussi regroupés au château.
1500 collaborateurs français investissent un bourg allemand de 7000 habitants
Celles et ceux qui ont soutenu le régime de Vichy s’organisent aussi pour fuir. C’est ainsi que des centaines de Français prennent, eux aussi, le chemin vers Sigmaringen, regroupant à l’automne près de 1500 personnes. Le petit bourg régional allemand devient alors la plaque tournante de cet exil français. Dans ce bourg de 7000 habitants, l’arrivée des réfugiés crée une situation d’entassement insupportable. La plupart sont mal logés et mal nourris dans les auberges et les hôtels de la ville. D’autant qu’une réputation épouvantable les précède, installant suspicion et crainte auprès de la population locale. Des intellectuels collaborationnistes tels que Lucien Rebatet animent des conférences invitant au débat sur une « Europe nouvelle » sous domination allemande, l’unique obsession les unissant tous étant le retour au pays et la haine farouche de la République.
Louis-Ferdinand Céline, une figure centrale
Au sein de cette communauté d’exilés, Louis-Ferdinand Céline est une figure centrale. Arrivé début novembre 1944 avec sa femme Lucette, il bénéficie d’un statut privilégié et loge à l’hôtel Löwen. Contrairement à Pétain ou Laval, Céline est venu de son plein gré, nommé officiellement médecin de la colonie. En attendant de franchir la frontière Suisse, il se complait à se faire, comme toujours depuis son roman Voyage au bout de la nuit, le prophète du pire et de la décadence, rompant les illusions de chacun des collaborateurs qu’il fréquente. L’occasion de découvrir que l’expérience de Céline à Sigmaringen est au cœur de sa fiction politique D’un château l’autre, publié en 1957 par laquelle il construisit un contre-discours de Sigmaringen du point de vue des vaincus, transposant la réalité pour dépeindre cette apocalypse qui l’a toujours obsédé et ainsi inverser les valeurs de l’histoire.
L’espoir fou de revenir en France sur les chars allemands
Noël 1944, l’espoir change de camp au point d’inquiéter les Alliés. Face à la contre-offensive de l’armée nazie dans les Ardennes, les collaborateurs exilés de Sigmaringen sont euphoriques et rêvent d’un retour en France. La propagande entretient l’horizon insensé d’un retour d’exil ; les collaborateurs se prennent à rêver d’un retour à Paris sur les chars allemands. Même Philippe Pétain, reclus, aspire vivement à rentrer en France, alors qu’une Haute cour de justice est créée pour le juger. Seul Pierre Laval, lui, ne croit plus en la victoire de l’Allemagne. Alors qu’en janvier 1945, la contre-offensive échoue, ils s’efforcent d’entretenir la fiction d’un possible retournement grâce à leurs propres outils de propagande. Parmi eux, le journal La France, créé par Jean Luchaire dès son arrivée à Sigmaringen en octobre 1944, et la radio Ici la France, sur les ondes de laquelle le journaliste se mobilise pour lutter contre la Résistance dès janvier 1945.
La fin énigmatique de Jacques Doriot
A l’automne 1944, Jacques Doriot, chef du Parti populaire français, fait partie des exilés collaborateurs réfugiés en Allemagne avec ses troupes paramilitaires qui le considèrent comme « le Führer français » et Hitler compte sur lui. Il continue de jouer ses propres cartes, et se tient à distance du reste des collaborateurs français et du gouvernement factice de Sigmaringen, qu’il méprise. Il meurt le 22 février 1945, en se rendant au château des exilés, dans sa voiture mitraillée par deux avions. En rassemblant ensemble de hauts dignitaires nazis et les derniers vestiges de la collaboration, cet événement marque l’enterrement des derniers espoirs des ultras de la collaboration réfugiés à la frontière.
Sauve qui peut !
Le printemps 1945 marque un tournant pour les collaborationnistes réfugiés à Sigmaringen, alors que les Alliés franchissent le Rhin le 31 mars et progressent rapidement vers Berlin. Le 12 avril, les troupes alliées ne sont plus qu’à 190 km, ce qui plonge la colonie des exilés dans la panique générale. Que doivent-ils faire ? Se réfugier en Suisse, se mêler aux prisonniers de guerre du Service du Travail Obligatoire, se constituer prisonniers ?
Certains, comme Marcel Déat et Jean Luchaire, trouvent refuge en Italie, tandis que Fernand de Brinon et Lucien Rebatet naviguent en Autriche. L’un des premiers à prendre ses précautions, c’est Louis-Ferdinand Céline, qui quitte Sigmaringen dès le 22 mars 1945 pour le Danemark, grâce à l’aide de Karl Bömelburg, ancien chef de la Gestapo à Paris, qui a joué un rôle très important dans le processus de déportation des Juifs dans les camps de la mort. Face à la chute du Reich, les deux figures les plus symboliques du régime de Vichy font des choix radicalement différents. Le vieux maréchal Pétain prend la décision de rentrer en France pour se présenter devant la justice de son pays. De son côté, Pierre Laval cherchera à tout prix à éviter d’être capturé par les armées françaises, entamant une longue errance, cherchant d’abord à gagner la Suisse avant de trouver finalement refuge en Espagne.
Epuration populaire et épuration judiciaire
À la fin de l’Occupation, la France panse ses plaies et veut régler ses comptes avec celles et ceux qui se sont compromis dans la politique de la collaboration de Vichy. L’épuration débute dès l’automne 1944 et se manifeste sous diverses formes d’exclusion : ostracisme, marquages, pillages, saccages, lynchages et exécutions sommaires.
Longtemps désignée comme « épuration sauvage », Philippe Collin s’attache à démontrer en quoi cette sémantique a, pendant longtemps, alimenté une « légende noire » propagée par l’extrême droite, présentant les épurés comme des victimes d’une « foule vengeresse ». Aussi, au cœur de cette violence populaire se cristallise l’image de la femme tondue. Une pratique adoptée sur l’ensemble du territoire français, qui connaît son pic à la Libération. Si la moitié de ces femmes l’ont été pour des faits graves, de délation ou leur adhésion à un parti collaborationniste, les stéréotypes de genre ont néanmoins pu jouer un rôle important dans leur condamnation à mort par la justice à la Libération. La tonte étant avant tout un châtiment sexué de la collaboration des femmes, visant à les déposséder de leur corps jugé « souillé ». La justice, principalement rendue par des hommes, jugeait ces femmes non seulement sur leurs actes, mais aussi sur leur transgression des normes sociales.
Le procès de Nuremberg
L’ultime épisode nous propose de parcourir les coulisses du procès de Nuremberg, qui s’est ouvert le 20 novembre 1945 en Allemagne, pour rappeler combien cet évènement historique a mené à la création du Tribunal militaire international, décisif pour juger les responsables de la Seconde Guerre mondiale et posant les bases du droit international.
Ce procès est inédit tant il a contribué à instaurer quatre chefs d’inculpation déterminants qui servent toujours de socle aujourd’hui pour garantir notre sécurité et le droit international : Les crimes contre la paix (ou d’agression), considérés comme les plus graves et à l’origine de tous les autres ; Les crimes de guerre, violations des conventions internationales protégeant les soldats et les populations civiles ; Les crimes contre l’humanité, prenant en compte les actions criminelles contre des civils et incluant pour la première fois les persécutions raciales, politiques ou religieuses commises par un pays contre ses propres ressortissants ; La conspiration ou complot criminel, un chef d’accusation plus transversal visant une coordination dans le but de commettre les trois crimes précédents, reconnaissant ainsi la planification des atrocités nazies. Les 24 dirigeants nazis accusés, parmi lesquels Göring et Ribbentrop ont tous plaidé non coupable. Face à ces bourreaux, le procureur en chef américain, Robert Jackson, a veillé à ce que le procès respecte les principes libéraux et démocratiques pour que le procès reste équitable. Ce procès marque une importante rupture dans l’histoire de la justice internationale, posant pour la première fois le principe de la responsabilité pénale des dirigeants politiques les plus importants. Ce procès a façonné les fondements du droit pénal international et les réflexions sur la justice et la guerre jusqu’à nos jours.
Quelle France est présente à Sigmaringen ?
A Blois aujourd’hui, la question devait être posée. C’est une extrême minorité qui a été en position de force sous l’Occupation répondent Henri Rousso et Bénédicte Vergez-Chaignon. Ennemis farouches de la démocratie, les collaborateurs de Sigmaringen sont un ferment de guerre civile, bien que leur quotidien s’appelle La France et que la radio de Doriot s’appelle Radio Patrie. Mais leur haine de la démocratie, du communisme, des Juifs, leur fait préférer le Reich à la France. Les obsèques de Doriot sont une cérémonie organisée comme pour un héros du national-socialisme.
Sigmaringen est un laboratoire d’observation de la frange la plus extrême du nationalisme, un nationalisme exclusif qui élimine l’ennemi de l’intérieur. Ils préfèrent aller mourir en Allemagne plutôt que de rester en France. Pétain n’est pas un nationaliste de ce type ; il demande d’ailleurs à rentrer en France.