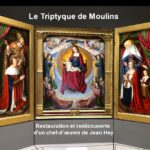Comprendre le Levant pour décrypter le monde : une urgence stratégique. Face aux bouleversements géopolitiques qui redessinent le Moyen-Orient depuis le 7 octobre 2023, marqués par l’effondrement de l’axe de la résistance, la transformation doctrinale d’Israël, la chute du régime Assad et l’affaiblissement de l’Iran, la région du Levant cristallise toutes les dynamiques du nouvel ordre international en gestation. Cette recomposition stratégique sans précédent, cette nouvelle donne stratégique au Levant, où s’entremêlent jeux de puissance, conflits identitaires, ruptures technologiques militaires et rivalités régionales, ne concerne pas seulement le Moyen-Orient : elle préfigure les rapports de force qui structureront le XXIe siècle.
Dans ce contexte, développer une culture stratégique éclairée, comprendre les logiques d’acteurs et saisir la complexité des équilibres régionaux deviennent essentiels pour appréhender avec lucidité les mutations du monde. Cette table ronde des Rencontres Stratégiques de la Méditerranée 2025, réunissant cinq experts internationaux reconnus, propose un décryptage rigoureux et pédagogique d’une région où se joue, en temps réel, l’avenir de l’ordre géopolitique mondial.
Présentation officielle : Le démantèlement de « l’Axe de la résistance » provoqué par l’action déterminée de l’armée israélienne contre le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban, l’arrivée d’un pouvoir intérimaire islamiste en Syrie après la chute de Bachar el-Assad, puis la « guerre de 12 jours entre Israël et l’Iran » ont profondément modifié l’équation stratégique au Levant. Quels sont aujourd’hui les acteurs dominants dans cette région et quelle est leur stratégie ? L’affrontement direct entre Israël et l’Iran, conclu par un cessez-le-feu imposé par la Maison Blanche, va-t-il se muer en une guerre d’usure ? L’Irak parviendra-t-il à rester stable dans ce maelström régional ? L’Égypte et la Jordanie ne vont-elles pas faire les frais de la guerre opposant Israël au Hamas ? L’affaiblissement du Hezbollah peut-il relancer une dynamique positive au Liban ? Quel avenir pour les Kurdes et les Palestiniens ?
Modérateur : Le Colonel Guirec Fauchon est officier renseignement de l’armée de l’air et de l’espace, actuellement chef du département Afrique du Nord – Moyen-Orient (ANMO) de la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie (DGRIS).
Intervenants :
Pierre Razoux est docteur habilité à diriger les recherches et directeur académique de l’Institut FMES. Spécialiste reconnu des conflits au Moyen-Orient, il est notamment l’auteur d’ouvrages de référence sur la guerre Iran-Irak.
Joost Hiltermann est conseiller spécial pour le programme Middle East North Africa à l’International Crisis Group. Il a été directeur du programme MENA de 2015 à 2025 et directeur exécutif de la division des armes à Human Rights Watch.
Léa Landman est géopolitologue spécialiste du Moyen-Orient. Ancienne directrice du programme Diplomatie 2030 à l’Abba Eban Institute for Diplomacy and Foreign Relations de l’université Reichman en Israël, elle siège aujourd’hui au conseil de plusieurs initiatives régionales de coopération et de recherche.
Nicolas Badaoui est professeur de sciences politiques à l’Institut des Sciences Politiques de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, professeur invité auprès d’universités françaises et chercheur associé au Centre de Recherche des Écoles de Coëtquidan (CREC – Saint-Cyr).
Giovanni Romani est directeur Afrique et Moyen-Orient à la division affaires politiques et sécurité de l’État-major de l’OTAN à Bruxelles.
Deux ans après les attaques terroristes du 7 octobre 2023, le Levant connaît une recomposition stratégique sans précédent. Entre frappes israéliennes ciblées, effondrement de l’axe de la résistance et chute surprise du régime syrien, les équilibres régionaux basculent.
Le repositionnement américain et ses implications stratégiques
Le Colonel Fauchon ouvre les débats en soulignant l’importance d’adopter une approche régionale plutôt que de se focaliser immédiatement sur Gaza et la Palestine.
Le paradoxe du retrait américain
Joost Hiltermann analyse le mouvement apparemment contradictoire des États-Unis. Washington se retire progressivement du Moyen-Orient depuis près de vingt ans, cherchant à réorienter ses priorités stratégiques. Pourtant, cette volonté de désengagement se heurte à une réalité : aucun acteur ne se positionne pour combler le vide américain. Les États-Unis demeurent la puissance extérieure prépondérante dans la région, malgré leur désir de réduire leur empreinte.
Si plusieurs puissances moyennes régionales nourrissent leurs propres ambitions, aucune ne dispose des capacités pour structurer l’ordre régional. Israël, la Turquie, l’Arabie saoudite ou l’Iran poursuivent chacun des agendas spécifiques, mais sans vision d’ensemble capable de se substituer au rôle américain.
Hiltermann identifie deux objectifs stratégiques américains immuables. Le premier concerne la protection des canaux d’approvisionnement pétrolier et le maintien d’un prix du pétrole relativement bas. Bien que les États-Unis soient devenus largement indépendants énergétiquement grâce au gaz et pétrole de schiste, ils conservent un intérêt vital à la stabilité des marchés mondiaux de l’énergie.
Le second objectif fondamental demeure la protection d’Israël. Cet engagement reste une constante, indépendamment des alternances politiques à la Maison Blanche. Toutefois, Hiltermann souligne que ces deux impératifs entrent parfois en tension. Les actions militaires israéliennes peuvent menacer la stabilité régionale et les approvisionnements énergétiques, obligeant Washington à un exercice d’équilibriste permanent.
Le « Deal du siècle 2.0 » de Trump
Pierre Razoux évoque la vision stratégique de l’administration Trump, revenue au pouvoir en janvier 2025. Le plan Trump actualisé vise à consolider et étendre les accords d’Abraham, conclus en 2020 entre Israël et plusieurs États arabes du Golfe. Washington cherche à construire un front commun face à l’Iran, perçu comme la principale menace déstabilisatrice.
Ces objectifs se heurtent aux réalités du terrain. L’annonce d’un cessez-le-feu à Gaza, la déclaration de New York entérinée par 142 pays, la reconnaissance d’un État palestinien par plusieurs nations dont la France le 22 septembre 2025, ainsi que la frappe israélienne sur Doha le 9 septembre, ont fait bouger les lignes diplomatiques.
La fiabilité américaine en question
Giovanni Romani, depuis sa perspective otanienne, nuance les inquiétudes sur la constance de Washington. Malgré les fluctuations politiques internes, les États-Unis maintiennent une présence militaire conséquente dans la région : bases en Irak, Cinquième Flotte à Bahreïn, coopérations sécuritaires avec les pays du Golfe.
Léa Landman apporte un contrepoint israélien. Si Jérusalem bénéficie d’un soutien américain sans faille, Israël a néanmoins développé une doctrine d’autonomie stratégique. Les dernières opérations militaires témoignent d’une capacité d’action indépendante, même si elle s’inscrit généralement dans une coordination étroite avec Washington.
Le cas de la « guerre des 12 jours » avec l’Iran, conclue par un cessez-le-feu imposé par la Maison Blanche en juin 2025, illustre cette tension : Israël et l’Iran se sont affrontés directement, obligeant Washington à intervenir diplomatiquement pour éviter l’escalade.
Architecture de sécurité régionale
Joost Hiltermann se montre prudent sur la viabilité d’une architecture de sécurité régionale basée sur les rapports normalisés entre pays arabes et Israël. Les accords d’Abraham reposaient sur une convergence face à la menace iranienne et des bénéfices économiques mutuels. Or, avec l’affaiblissement de l’axe de la résistance, la perception de la menace évolue. Si l’Iran apparaît affaibli, l’urgence d’une coalition anti-iranienne diminue. De plus, les opinions publiques arabes restent massivement hostiles à la normalisation avec Israël après Gaza.
Pierre Razoux souligne le rôle déterminant de l’Arabie saoudite. Sans normalisation saoudienne, l’architecture de sécurité américaine reste incomplète. Or, le prince héritier Mohammed bin Salman a posé des conditions claires : progrès vers un État palestinien et garanties de sécurité solides. Dans le contexte actuel, la normalisation saoudienne semble compromise, du moins à court terme.
Pour aller plus loin
Sur la politique américaine au Moyen-Orient, consulter les analyses de l’Institut Français des Relations Internationales (IFRI) et du Washington Institute for Near East Policy. Pour comprendre les enjeux énergétiques régionaux, voir les rapports de l’Agence Internationale de l’Énergie.
Israël, du paradigme défensif à la guerre préventive
Les intervenants convergent sur un constat : depuis le 7 octobre 2023, Tel-Aviv a opéré une transformation doctrinale majeure, passant d’une posture essentiellement défensive à une stratégie offensive systématique visant le démantèlement de l’axe de la résistance.
Le 7 octobre 2023 : rupture stratégique
Léa Landman insiste sur le 7 octobre 2023 comme date charnière. Les attaques du Hamas ne représentent pas seulement une tragédie sécuritaire pour Israël ; elles incarnent une rupture définissant durablement la manière dont le conflit sera géré.
Le 8 octobre 2023, le Hezbollah ouvre un second front. Landman rectifie une perception répandue : ce n’est pas Israël qui a attaqué le Hezbollah en premier. Toutefois, même limité, cet engagement produit des effets considérables : entre 60 000 et 80 000 Israéliens sont évacués du nord, incapables de retourner chez eux pendant des mois. Pour Landman, il s’agit d’un événement sans précédent dans l’histoire israélienne moderne.
Joost Hiltermann révèle que le Hamas a agi sans l’accord préalable de l’Iran. Cette initiative unilatérale a profondément contrarié Téhéran, entraîné dans une confrontation non choisie. Le Hezbollah s’engage par solidarité obligée, mais sans conviction profonde, pris entre satisfaire sa base électorale chiite et préserver ses intérêts stratégiques.
La stratégie des frappes ciblées
En septembre 2024, Israël franchit un nouveau cap. Léa Landman décrit l’utilisation de bipeurs piégés pour neutraliser simultanément des centaines de cadres du Hezbollah, suivie par l’élimination ciblée de Hassan Nasrallah. Ces frappes chirurgicales visent à décapiter littéralement le Hezbollah.
Pierre Razoux souligne que cette campagne dépasse le Hezbollah. Israël frappe également Ismail Haniyeh à Téhéran en juillet 2024. Ces éliminations traduisent une nouvelle doctrine : la guerre préventive totale contre l’axe de la résistance. Tel-Aviv ne réagit plus aux menaces ; il les anticipe et les neutralise.
Cette stratégie atteint son paroxysme lors de la « guerre des 12 jours » en juin 2025. Léa Landman conteste cette appellation, préférant replacer ces douze jours dans un continuum débutant le 13 avril 2024. Razoux décrit l’ampleur impressionnante : des avions israéliens effectuent des patrouilles au-dessus de Téhéran même. Les frappes ciblent infrastructures nucléaires, systèmes de défense aérienne, sites militaires stratégiques. L’Iran, surpris, se trouve temporairement paralysé.
L’effacement des lignes rouges
Léa Landman évoque la frappe sur Doha le 9 septembre 2025. Bien qu’ayant échoué, son message stratégique est limpide : les lignes rouges israéliennes n’existent plus. En frappant la capitale d’un État souverain et allié des États-Unis, Israël signifie qu’aucun sanctuaire diplomatique ne protégera les dirigeants de l’axe de la résistance.
Joost Hiltermann note avec ironie que les pays du Golfe craignent aujourd’hui plus Israël que l’Iran – un renversement complet. Cette crainte complique les projets de normalisation. Les monarchies du Golfe hésitent à s’engager pleinement, de peur de s’aliéner leurs opinions publiques ou de devenir des cibles futures.
Le débat sur les objectifs
Joost Hiltermann pose la question cruciale : Israël cherche-t-il simplement à « tondre la pelouse » – affaiblir périodiquement ses adversaires – ou vise-t-il un changement de régime en Iran ?
Hiltermann rappelle l’expérience américaine en Irak : Washington a déployé 200 000 soldats en 2003 avec un résultat catastrophique à long terme. Israël peut détruire le leadership iranien, mais quelles seraient les conséquences ? Un Iran déstabilisé, livré au chaos, contrôlé par des groupes plus radicaux. Hiltermann ne voit pas comment un tel scénario servirait les intérêts israéliens.
Pierre Razoux estime qu’Israël se trouve dans une fenêtre d’opportunité historique. Netanyahu considère que l’Iran n’a jamais été aussi faible. Razoux anticipe une reprise des hostilités dès qu’un prétexte se présentera. Mais le régime iranien, affaibli, a choisi de courber le dos plutôt que de fournir ce casus belli.
Hiltermann souligne qu’Israël déstabilise également le nouveau gouvernement syrien et maintient une pression sur le Liban. Cette stratégie multidirectionnelle interroge : quelle est la finalité ? En affaiblissant tous les acteurs simultanément, Israël ne risque-t-il pas de créer un vide propice au chaos ?
Léa Landman note un paradoxe troublant : une nouvelle confrontation israélo-iranienne ne déstabiliserait probablement pas autant la région qu’anticipé. Lors de la guerre de juin 2025, personne n’est venu au secours de l’Iran. Cette solitude témoigne de l’effondrement de l’axe de la résistance et de l’isolement croissant de Téhéran.
Pour aller plus loin
Sur la stratégie militaire israélienne et les doctrines de défense, consulter les travaux de l’Institute for National Security Studies (INSS) de Tel-Aviv. Pour une perspective sur le droit international et la légitime défense, voir les analyses du Comité International de la Croix-Rouge.
L’effondrement de l’axe de la résistance
Les intervenants décortiquent comment, en deux années, l’architecture stratégique construite par l’Iran depuis les années 1980 s’est effondrée sous les coups conjugués des frappes israéliennes, de la chute du régime syrien et de l’isolement diplomatique de Téhéran.
L’échec de la stratégie défensive iranienne
Joost Hiltermann analyse la doctrine stratégique iranienne d’avant octobre 2023. Le système reposait sur une posture défensive. L’Iran ne cherchait pas à agresser Israël ou les États-Unis frontalement, mais avait structuré un réseau de proxies régionaux qui pouvaient être activés si Téhéran ressentait une menace existentielle.
Cette architecture permettait à l’Iran d’exercer une influence considérable tout en maintenant un déni plausible. Le système fonctionnait selon une logique de dissuasion par procuration : toute attaque contre l’Iran déclencherait des représailles sur de multiples fronts.
Le 7 octobre 2023 marque la rupture. Hiltermann révèle que le Hamas a agi sans l’accord préalable de l’Iran. Cette initiative unilatérale a contrarié le leadership iranien, entraîné dans une confrontation non choisie. Les branches militaires du Hamas ont reproché à l’Iran de ne pas les soutenir suffisamment, révélant les fissures au sein de l’axe.
Le Hezbollah s’engage le 8 octobre par solidarité obligée, mais sans conviction. Pris entre satisfaire sa base électorale et préserver ses intérêts stratégiques, cette demi-mesure s’avérera fatale lors de l’offensive israélienne de septembre 2024.
L’Iran en mode survie
Pierre Razoux livre une analyse détaillée de la situation iranienne après juin 2025. Le régime se trouve dans un état de faiblesse sans précédent depuis 1979. Divisé, affaibli, il adopte une posture de survie, choisissant de « courber le dos » plutôt que de fournir à Israël le prétexte d’une nouvelle offensive.
Razoux décrit les adaptations structurelles. Le régime a réorganisé son processus décisionnel. Lors des frappes de juin, l’Iran a été pris au dépourvu, les autorités habilitées à décider ayant été éliminées ou neutralisées.
Pour éviter cette paralysie, Téhéran a créé un nouveau conseil de défense confié au président Masoud Pezeshkian. Le Conseil de sécurité nationale a été placé sous Ali Larijani, soucieux d’éviter une deuxième confrontation avec Israël. L’Iran a mis en place un système étendu de délégation d’autorité pour maintenir une chaîne de commandement fonctionnelle même en cas de décapitation.
Parallèlement, l’Iran a lancé un programme de réarmement, sollicitant la Russie et la Chine. Moscou aurait livré quelques MIG-29, avec un accord pour des Soukhoï-35 entre 2026 et 2029. La Chine fournirait des systèmes de défense sol-air HQ-9.
Razoux rapporte une information stratégique : en juin 2025, l’Iran n’a utilisé que 30% de ses missiles balistiques à longue portée. Il en reste environ 1 300, un message de dissuasion résiduelle adressé à Israël.
La chute du corridor syrien
Nicolas Badaoui éclaire les conséquences de l’effondrement du régime Assad. La Syrie constituait le maillon central de l’axe, le corridor obligé entre l’Iran et le Hezbollah. Sa chute représente une rupture logistique majeure.
Le transfert d’armes transitait systématiquement par la Syrie. Avec la prise de pouvoir par HTC, ce corridor est désormais fermé. Le Hezbollah se retrouve coupé de son principal fournisseur, incapable de reconstituer ses stocks décimés par les frappes de septembre 2024.
L’incapacité à mobiliser les proxies
Le Colonel Fauchon interroge sur la passivité des milices chiites irakiennes, traditionnellement fidèles à Téhéran. Dans un contexte de reconfiguration américaine en Irak, on aurait pu s’attendre à leur activation. Or, rien ne s’est produit.
Pierre Razoux explique cette passivité par l’erreur stratégique iranienne de juin 2025. En affrontant directement Israël, Téhéran voulait démontrer à ses proxies qu’il ne les sacrifiait pas. Mais le résultat a montré la vulnérabilité iranienne. Les proxies ont constaté que « le roi est nu ».
L’Iran éprouve désormais des difficultés considérables à activer ses réseaux. Au Yémen, les Houthis maintiennent leur capacité, mais avec un soutien croissant de la Russie et de la Chine. En Syrie, les milices chiites ont disparu ou se sont repliées. Au Liban, le Hezbollah lutte pour sa survie. Et en Irak, les milices concentrent leurs efforts sur la sécurisation des frontières face à Daesh.
Giovanni Romani confirme : l’Iran se trouve dans une position défensive inédite, incapable de projeter sa puissance au-delà de ses frontières. La stratégie des proxies, pilier de l’influence iranienne pendant quatre décennies, s’est effondrée.
Le paradoxe de la normalisation
Un paradoxe troublant émerge : alors que l’Iran est militairement affaibli, il parvient à améliorer ses relations diplomatiques avec plusieurs voisins, notamment les monarchies du Golfe. Razoux évoque le rapprochement irano-saoudien, impensable il y a quelques années. Les États du Golfe craignent aujourd’hui moins l’Iran affaibli qu’Israël, dont la puissance inquiète.
Razoux souligne également un phénomène social crucial : avant juin 2025, une partie de la population iranienne détestait son régime. Aujourd’hui, elle déteste toujours le régime, mais déteste également Israël. Ce nationalisme défensif renforce paradoxalement la cohésion sociale, compliquant tout scénario de changement de régime.
La question palestinienne dans la recomposition régionale
Le Colonel Fauchon ramène les débats vers ce qui constitue le nœud gordien : la question palestinienne. Comme il le souligne, la table ronde est partie d’une approche régionale pour, inévitablement, converger vers Gaza, la Palestine et Israël.
Gaza : catastrophe et impasse
Le Colonel Fauchon dresse un constat franc : deux ans après le 7 octobre 2023, malgré le cessez-le-feu, la situation à Gaza demeure catastrophique. La bande a été détruite à plus de 70%. Les infrastructures civiles ont été pulvérisées. Le bilan humain reste accablant.
Cette réalité pose une question cruciale : dans quel état sera Gaza au moment de la reconstruction ? Et qui gouvernera ? Le Hamas, bien qu’affaibli militairement, conserve une influence considérable. L’Autorité palestinienne ne dispose ni de la légitimité ni des capacités pour s’imposer sans soutien international massif.
Le Colonel Fauchon évoque les tensions internes israéliennes, rarement abordées. La société traverse une crise profonde, avec des manifestations régulières. Néanmoins, une résilience remarquable persiste : deux ans après, le pays fonctionne, l’économie tient.
Netanyahu : tacticien sans vision
Joost Hiltermann livre une analyse tranchante. Selon lui, Benjamin Netanyahu incarne le tacticien brillant mais dénué de vision stratégique. Il excelle à rester au pouvoir, à éviter les poursuites pour corruption, à manœuvrer entre les composantes de sa coalition. Mais au-delà, quelle vision pour Israël et la région ? Hiltermann affirme qu’il n’y en a pas.
Cette absence de stratégie a des conséquences directes. Les accords d’Abraham ont perdu toute valeur aux yeux de Netanyahu. Le Premier ministre privilégie les victoires militaires immédiates sur les compromis diplomatiques à long terme.
Hiltermann souligne que Netanyahu a intérêt à ce que la guerre continue. Tant que le pays est en guerre, il ne peut être tenu responsable des erreurs du 7 octobre. Tant que la guerre dure, les poursuites judiciaires sont suspendues.
Le plan Trump : pragmatisme controversé
Léa Landman adopte une position nuancée concernant le « plan Trump » en vingt points. Elle reconnaît les critiques : il est biaisé en faveur d’Israël, entérine une capitulation du Hamas, relègue la création d’un État palestinien au second rang.
Cependant, argumente Landman, l’essentiel se trouve ailleurs. Dans l’immédiateté, la priorité absolue est le cessez-le-feu. Tout le reste peut attendre. L’urgence consiste à arrêter les morts, à libérer les otages, à permettre l’aide humanitaire. Sur ce point, le plan Trump a le mérite d’avoir imposé un cessez-le-feu.
Landman insiste : le plan Trump replace la question palestinienne dans un contexte régional. Pendant des décennies, le conflit a été traité comme un problème bilatéral, isolé. Or, tout est interconnecté au Moyen-Orient. Une solution viable ne peut émerger sans l’engagement des États arabes du Golfe, de l’Égypte, de la Jordanie.
Par ailleurs, les accords d’Abraham ont tenu contre toute attente. Malgré Gaza, les Émirats et Bahreïn n’ont pas rompu avec Tel-Aviv. Cette résilience démontre qu’une nouvelle géopolitique, basée sur les intérêts plutôt que l’idéologie, émerge.
Landman conclut par une remarque surprenante : pour la première fois depuis vingt-cinq ans, elle a l’impression qu’un nombre suffisant d’États et d’enjeux convergent pour pousser à la création d’un État palestinien. Non par idéalisme, mais par pragmatisme.
L’Autorité palestinienne sommée de se réformer
Un aspect novateur du plan Trump concerne les exigences vis-à-vis de l’Autorité palestinienne. Pour la première fois, explique Landman, on demande explicitement à l’Autorité de prendre ses responsabilités sur la gestion des fonds et sa population.
Le plan Trump renverse cette logique. Il conditionne la création d’un État palestinien à des réformes profondes : transparence financière, lutte contre la corruption, élections démocratiques, désarmement des groupes armés. Ces exigences sont considérables. Mais cette approche pose les bases d’une véritable étatisation palestinienne.
Joost Hiltermann se montre plus sceptique. L’Autorité palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas, octogénaire au pouvoir depuis vingt ans sans élections, incarne précisément ce qui dysfonctionne : gérontocratie, corruption, absence de légitimité. Comment une telle structure pourrait-elle se transformer radicalement ?
Planification ou improvisation ?
Le Colonel Fauchon pose une question centrale : l’enchaînement depuis le 7 octobre résulte-t-il d’une planification fine ou d’un effet domino improvisé ? Israël avait-il anticipé que l’attaque du Hamas déclencherait une cascade menant à l’effondrement du Hezbollah, puis d’Assad, puis de l’Iran ?
Léa Landman propose une réponse nuancée. L’effet domino est indéniable : le Hamas attaque, le Hezbollah riposte, Israël détruit le Hezbollah, qui doit se replier de Syrie, ce qui permet à la Turquie de faire tomber Assad, ce qui effondre la stratégie iranienne, ce qui permet à Israël d’attaquer l’Iran. Chaque élément tombe en entraînant le suivant.
Cependant, chaque opération prise individuellement a été planifiée méticuleusement. L’opération des bipeurs était préparée depuis vingt ans. Les plans contre l’Iran existaient depuis longtemps. Israël n’a pas improvisé ; il a saisi des opportunités dans une séquence favorable.
Le traumatisme du 7 octobre
Léa Landman conclut en appelant à ne pas sous-estimer le traumatisme israélien du 7 octobre. Ce traumatisme a fondamentalement transformé la perception israélienne de la sécurité. Avant, Israël vivait avec l’illusion que le statu quo était gérable. Le 7 octobre a brisé cette illusion.
Cette rupture doit être comprise, même par ceux qui critiquent la réponse israélienne. En Israël, gauche et droite convergent : les lignes rouges ne tiennent plus. Désormais, toute menace sera traitée préventivement, sans égard pour les considérations diplomatiques.
Landman termine sur une note qu’elle qualifie d’optimiste : il ne faut pas avoir peur de la rupture. Les ruptures ouvrent des possibilités. La situation actuelle, aussi brutale soit-elle, crée peut-être l’opportunité de relancer un processus de paix interrompu depuis longtemps.
Pour aller plus loin
Sur le conflit israélo-palestinien et les perspectives de paix, consulter les rapports de l’International Crisis Group. Pour les aspects juridiques et humanitaires, voir les publications de l’Office des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA). Sur les processus de paix historiques, consulter les archives du Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.
Les acteurs régionaux face aux bouleversements
La Turquie : un nouveau « broker » régional
La recomposition stratégique ouvre des opportunités pour la Turquie. Giovanni Romani souligne le positionnement singulier d’Ankara dans le nouveau jeu régional. Le pays a su capitaliser sur l’affaiblissement simultané de plusieurs acteurs, particulièrement en Syrie où les groupes soutenus par la Turquie, notamment HTC, ont pris Damas après la chute d’Assad.
Léa Landman rappelle que la Turquie entretient désormais des relations avec l’ensemble des acteurs majeurs, y compris Téhéran dans le cadre de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). Cette position de pivot lui confère une influence sans précédent sur les dossiers syrien, libyen et énergétique en Méditerranée orientale.
Nicolas Badaoui nuance en rappelant les limites structurelles de la puissance turque. Si Ankara dispose d’atouts – capacité militaire, poids démographique – l’économie reste fragile, avec inflation persistante et dette importante. Les relations tendues avec plusieurs pays européens et les États-Unis limitent la marge de manœuvre d’Erdoğan.
Égypte et Jordanie : stabilité sous pression
Joost Hiltermann attire l’attention sur la fragilité croissante de l’Égypte et de la Jordanie, piliers de la stabilité régionale.
L’Égypte du président al-Sissi fait face à des défis multiples. Économiquement exsangue malgré l’aide du Fonds monétaire international, le pays doit gérer les répercussions de Gaza, avec 1,5 million de réfugiés à sa frontière. La crainte d’un transfert forcé de population gazaouie vers le Sinaï obsède Le Caire, qui y voit une menace existentielle. Pierre Razoux rappelle que l’Égypte a historiquement refusé toute installation permanente de Palestiniens, considérant qu’une telle option entérinerait la liquidation de la question palestinienne.
La Jordanie se trouve dans une situation plus délicate encore. Avec plus de 60% de Palestiniens dans sa population, le royaume craint qu’une nouvelle vague de déplacements ne déstabilise définitivement son équilibre démographique. Léa Landman souligne que le roi Abdallah II a multiplié les mises en garde contre le projet de « Jordanie alternative ». Les pressions migratoires, combinées à une économie fragilisée, placent Amman en position particulièrement vulnérable.
Les deux pays partagent une préoccupation : le risque que la guerre ne déborde sur leur territoire, mettant en péril des régimes ayant fait de la stabilité intérieure leur priorité.
Les pays du Golfe : normalisation en suspens
Giovanni Romani expose la tension entre la vision des dirigeants, qui misent sur l’intégration régionale et les accords d’Abraham, et les aspirations de leurs populations, solidaires de la cause palestinienne.
Les Émirats et Bahreïn maintiennent leurs relations avec Israël mais sur un mode mineur depuis octobre 2023. Les projets économiques d’envergure sont gelés. Léa Landman observe que ces États naviguent entre leur intérêt stratégique de long terme et la nécessité de ménager leurs opinions publiques, particulièrement leur jeunesse.
Le cas saoudien est emblématique. Riyad conditionnait sa normalisation avec Israël à des progrès sur le dossier palestinien. Les événements ont rendu cette perspective lointaine. Pierre Razoux souligne que MBS doit arbitrer entre sa Vision 2030, qui nécessite des partenariats avec Israël, et le maintien de sa légitimité auprès d’une population attachée à la Palestine.
Nicolas Badaoui rappelle un élément négligé : la jeunesse des sociétés du Golfe. Dans des pays où 60-70% de la population a moins de 30 ans, le décalage entre calculs géopolitiques des élites et aspirations d’une génération connectée, sensible aux images de Gaza, constitue un facteur d’instabilité potentiel.
L’Irak : équilibriste entre les feux
Joost Hiltermann attire l’attention sur la position délicate de Bagdad dans le « maelström régional ». L’Irak se trouve pris entre plusieurs feux. D’une part, le pays accueille des bases américaines et dépend du soutien occidental. D’autre part, l’influence iranienne y est massive, notamment via les milices du Hachd al-Chaabi.
La guerre entre Israël et l’Iran en juin 2025 a placé l’Irak dans une situation inconfortable. Le territoire irakien a servi de couloir de transit pour des missiles iraniens, provoquant des représailles israéliennes sur le sol irakien. Pierre Razoux souligne que Bagdad se trouve entraîné malgré lui dans un conflit qu’il ne souhaite pas.
Le gouvernement tente de maintenir un équilibre précaire, préservant à la fois sa relation avec Washington et ses liens avec Téhéran. Hiltermann conclut que la capacité de l’Irak à maintenir sa stabilité dépendra de l’issue du bras de fer entre l’Iran et Israël, et de la volonté américaine d’investir dans la sécurité irakienne.
Le Liban après l’affaiblissement du Hezbollah
Une fenêtre d’opportunité ?
L’affaiblissement du Hezbollah suite aux frappes de septembre 2025, qui ont éliminé Hassan Nasrallah et une grande partie de l’état-major, ouvre-t-il une perspective de renouveau pour le Liban ? Cette question divise les intervenants entre espoir prudent et scepticisme.
Pierre Razoux rappelle le contexte de cette décapitation. Les opérations israéliennes ont touché simultanément la direction politique et militaire du « Parti de Dieu ». La frappe sur Dahieh le 9 septembre 2025 a marqué un tournant. Pour la première fois depuis 1982, le Hezbollah se trouve en position défensive, privé de ses principaux leaders et d’une partie de son arsenal.
Nicolas Badaoui nuance. Si l’organisation est affaiblie, elle n’est pas détruite. Le Hezbollah conserve une base sociale importante, une infrastructure caritative développée, et une capacité de résilience éprouvée. La question n’est pas de savoir s’il va disparaître – improbable – mais s’il peut évoluer vers un acteur politique plus conventionnel.
Léa Landman souligne que cet affaiblissement coïncide avec celui de l’Iran, principal soutien régional, lui-même isolé après la chute d’Assad. Cette double fragilisation crée effectivement une fenêtre d’opportunité pour que le Liban retrouve une souveraineté sur son territoire. La géopolitologue évoque l’application possible de la résolution 1701 de l’ONU, qui prévoyait le désarmement des milices.
Les conditions de la reconstruction
Giovanni Romani identifie trois prérequis : reconstruction économique, réforme institutionnelle, et soutien international coordonné.
Le Liban traverse depuis 2019 la pire crise économique de son histoire moderne. La faillite bancaire, la dévaluation catastrophique de la livre libanaise (plus de 95% de perte de valeur), l’hyperinflation et l’effondrement des services publics ont plongé plus de 80% de la population sous le seuil de pauvreté. S’y ajoutent les destructions des bombardements de 2025. Sans plan de reconstruction massif et réformes anti-corruption, aucune stabilisation n’est envisageable.
Pierre Razoux insiste sur la nécessité d’une levée progressive des sanctions visant indirectement le Hezbollah mais affectant l’économie libanaise. La communauté internationale a conditionné son aide à des réformes que le système politique libanais, paralysé par le confessionnalisme, peine à mettre en œuvre.
Nicolas Badaoui rappelle que le Liban fonctionne selon un pacte confessionnel datant de 1943, révisé en 1989 par les accords de Taëf. Ce système, répartissant les postes selon l’appartenance religieuse, est à bout de souffle. Il a permis au Hezbollah de s’imposer en représentant la communauté chiite. Une transition vers un système moins confessionnel serait nécessaire, mais nécessiterait un consensus improbable.
Le rôle de la communauté internationale
Giovanni Romani expose le dilemme occidental. D’un côté, il existe une volonté de soutenir le Liban, perçu comme rempart contre l’instabilité. De l’autre, la méfiance persiste quant à la capacité des élites libanaises à mener les réformes nécessaires.
L’Union européenne, la France en particulier, et les États-Unis ont multiplié les initiatives depuis 2019. Mais le soutien reste conditionné et fragmenté. Léa Landman observe que la reconnaissance par plusieurs pays, dont la France le 22 septembre 2025, d’un État de Palestine pourrait créer une dynamique favorable au Liban. Une résolution de la question palestinienne retirerait un argument justifiant l’arsenal du Hezbollah.
Joost Hiltermann évoque le rôle de la FINUL (Force intérimaire des Nations unies au Liban), déployée depuis 1978. Son efficacité a été limitée par les restrictions imposées par le Hezbollah et les autorités libanaises. L’affaiblissement actuel du « Parti de Dieu » pourrait permettre à la FINUL de jouer pleinement son rôle.
Les obstacles persistants
Pierre Razoux identifie trois écueils majeurs.
Premièrement, le désarmement du Hezbollah demeure explosif. L’organisation dispose encore de dizaines de milliers de combattants et d’un arsenal substantiel. Toute tentative de désarmement forcé risquerait la guerre civile. Le précédent de mai 2008, quand le Hezbollah avait investi Beyrouth, reste dans les mémoires. Le désarmement ne peut être qu’un processus progressif et négocié.
Deuxièmement, la société libanaise reste divisée. La communauté chiite (30-35% de la population) n’est pas prête à voir son représentant désarmé et marginalisé. Nicolas Badaoui rappelle que le Hezbollah a construit un réseau d’œuvres sociales lui assurant une légitimité populaire au-delà de ses capacités militaires.
Troisièmement, l’environnement régional reste défavorable. Tant que le conflit israélo-palestinien perdurera, tant que la Syrie restera instable, tant que l’Iran cherchera à maintenir son influence, le Liban peinera à s’extraire de ces dynamiques. Léa Landman conclut que le Liban a toujours été le « thermomètre » des tensions régionales.
L’affaiblissement du Hezbollah crée une opportunité historique pour le Liban, mais cette fenêtre est étroite et pourrait se refermer rapidement si les conditions nécessaires ne sont pas réunies. Giovanni Romani formule une mise en garde : l’histoire récente du Moyen-Orient est jalonnée de « fenêtres d’opportunité » manquées, de « printemps arabes » devenus hivers. Pour que le Liban échappe à ce schéma, il faudra volonté politique, lucidité et patience.
La Syrie post-Assad : incertitudes et espoirs
L’effondrement éclair d’un régime
La chute du régime Assad en juillet 2025 a pris de court les observateurs. Après quatorze années de guerre ayant fait plus de 500 000 morts et déplacé la moitié de la population, le régime baasiste s’est effondré en quelques semaines face à l’offensive de HTC et d’autres groupes rebelles, avec soutien turc.
Pierre Razoux revient sur les facteurs explicatifs. Le retrait progressif du soutien russe, empêtré dans sa guerre en Ukraine, a été déterminant. L’affaiblissement parallèle de l’Iran et du Hezbollah a parachevé l’isolement du régime. Privé de ses tuteurs extérieurs, l’armée syrienne, minée par la corruption et l’épuisement, n’a opposé qu’une résistance symbolique. Le régime Assad ne tenait que grâce à ses soutiens extérieurs ; une fois retirés, sa chute n’était qu’une question de temps.
Joost Hiltermann souligne le rôle crucial de la Turquie. Ankara, qui contrôlait déjà une bande territoriale au nord, a facilité et coordonné l’offensive finale permettant la prise de Damas. Cette intervention répond à plusieurs objectifs : éliminer la menace kurde à sa frontière, rapatrier les réfugiés syriens, et s’imposer comme acteur incontournable de la reconstruction.
HTC : d’ex-organisation djihadiste à pouvoir intérimaire
L’arrivée au pouvoir de Hayat Tahrir al-Cham pose une question centrale : peut-on faire confiance à une organisation issue d’Al-Qaïda ? Léa Landman expose les éléments du débat.
HTC, dirigé par al-Joulani, s’est progressivement détaché de la mouvance djihadiste depuis 2017. L’organisation a rompu ses liens officiels avec Al-Qaïda et s’est présentée comme un mouvement nationaliste syrien. À Idleb, HTC a mis en place une forme de gouvernance, gérant services publics, justice et sécurité. Cette expérience, imparfaite, a démontré une capacité administrative.
Nicolas Badaoui apporte une perspective nuancée. La transformation idéologique affichée reste suspecte. L’organisation appliquait une interprétation rigoriste de la charia, limitait les libertés, réprimait la contestation. Les minorités (25% de la population) craignent légitimement un régime dominé par l’islamisme sunnite radical. Le professeur cite les précédents libyen et afghan.
Pourtant, HTC a multiplié les signaux de modération depuis sa prise de pouvoir. Giovanni Romani évoque les déclarations d’al-Joulani promettant un gouvernement inclusif et le respect des minorités. Des représentants de diverses communautés ont été intégrés au gouvernement de transition. Plusieurs pays, dont la France et les États-Unis, ont envoyé des émissaires à Damas. Cette séquence témoigne d’un pragmatisme international, conscient qu’il n’existe pas d’alternative crédible à HTC.
Le processus de reconstruction
La reconstruction représente un chantier colossal. Quatorze années de guerre ont détruit environ 50% des infrastructures, provoqué l’effondrement de l’économie, et créé la pire crise humanitaire du XXIe siècle. Pierre Razoux évoque des coûts de reconstruction entre 250 et 400 milliards de dollars. Aucun pays ne peut assumer seul ce fardeau.
La communauté internationale a posé des conditions claires. Joost Hiltermann détaille : garanties pour les minorités, processus politique inclusif menant à des élections, lutte contre le terrorisme, et justice transitionnelle. S’y ajoutent des préalables sécuritaires : stabilisation du territoire, désarmement des milices, et réforme de la sécurité.
La question de la levée des sanctions contre la Syrie constitue un enjeu crucial. La Syrie est soumise depuis 2011 à un régime parmi les plus sévères au monde. Ces sanctions, visant initialement Assad, paralysent aujourd’hui toute reconstruction. Léa Landman souligne le consensus émergent sur la nécessité d’une levée progressive, conditionnée aux avancées politiques.
Plusieurs conférences internationales ont été organisées depuis août 2025. L’Union européenne a annoncé un premier paquet d’aide humanitaire. Les pays du Golfe ont manifesté leur intérêt pour investir dans la reconstruction. Giovanni Romani rappelle que l’OTAN réfléchit à son rôle, notamment via le soutien à la Turquie.
La mosaïque syrienne
Nicolas Badaoui décrit une Syrie fragmentée : nord-ouest contrôlé par HTC avec soutien turc, nord-est aux mains des forces kurdes soutenues par les États-Unis, poches résiduelles de présence russe, et zones où règnent diverses milices.
La question kurde illustre cette complexité. Les Forces démocratiques syriennes (FDS), dominées par les YPG kurdes, contrôlent environ 30% du territoire, incluant les zones pétrolières. Alliées des États-Unis contre Daesh, elles ont établi une administration quasi-indépendante. Le nouveau pouvoir damascène devra négocier une forme d’autonomie acceptable, tout en gérant les pressions turques qui considèrent les YPG comme extension du PKK.
Les minorités religieuses constituent un autre enjeu. Léa Landman rappelle que les chrétiens syriens ont vu leur nombre chuter drastiquement, passant de 1,5 million avant 2011 à moins de 300 000 aujourd’hui. Les alaouites, communauté d’Assad, craignent des représailles. Le nouveau pouvoir doit démontrer sa capacité à protéger ces minorités.
Giovanni Romani évoque la question des anciens cadres baasistes. Des dizaines de milliers de fonctionnaires ont servi le régime. Tous ne peuvent être écartés sans paralyser l’État. Un processus de justice transitionnelle devra distinguer les responsables de crimes graves du reste de l’administration.
Quel avenir régional pour la Syrie ?
Pierre Razoux pose la question centrale : la Syrie sera-t-elle alignée avec Israël, neutre, ou continuera-t-elle dans l’axe de résistance ?
Le directeur académique estime peu probable une alliance avec Israël. Le Golan occupé depuis 1967 reste un contentieux majeur. La société syrienne, marquée par des décennies de propagande anti-israélienne, ne serait pas prête à une normalisation. En revanche, une neutralisation de la Syrie, qui ne serait plus une base arrière pour les groupes hostiles à Israël, semble envisageable.
Léa Landman développe l’hypothèse d’une Syrie devenant un État tampon, à condition d’un investissement massif dans sa reconstruction. Ce scénario nécessiterait un consensus régional impliquant la Turquie, les pays du Golfe, l’Égypte et indirectement Israël, tous ayant intérêt à une Syrie stable.
Les intervenants convergent : la Syrie post-Assad ne ressemblera pas à celle d’avant 2011. Le pays a été trop bouleversé par quatorze années de guerre. Joost Hiltermann conclut que la reconstruction prendra au moins une génération, et que son succès dépendra autant de la volonté des Syriens que de l’engagement international. L’histoire récente de l’Irak et de la Libye doit servir d’avertissement : sans plan cohérent et engagement de long terme, la Syrie pourrait sombrer dans un chaos durable.
Pour aller plus loin
Sur la situation en Syrie, consulter les rapports réguliers de l’International Crisis Group et les analyses de l’Institut français du Proche-Orient (IFPO). Pour les aspects humanitaires, voir les publications du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).
Questions du public – Prolongements et ouvertures
La dernière séquence permet d’explorer des thématiques transversales non pleinement développées durant les échanges principaux.
L’Europe face au recul de son influence
Une question centrale émerge : le Levant illustre-t-il le déclin de l’influence européenne au profit d’autres acteurs ?
Giovanni Romani reconnaît que le Levant représente un théâtre où se mesure le recul relatif de l’influence européenne, sans que cette région soit plus emblématique que d’autres. Il rappelle les liens historiques entre l’Europe et le Levant, notamment la relation France-Liban héritée du mandat de la Société des Nations. Ces liens n’ont pas empêché l’émergence de nouveaux acteurs – Turquie, pays du Golfe, puissances asiatiques – pesant désormais autant que les Européens.
Léa Landman nuance : l’Europe conserve des atouts significatifs. Elle reste le premier bailleur humanitaire pour les crises moyen-orientales, le principal partenaire commercial, et dispose d’une capacité diplomatique collective. Le problème réside moins dans un manque de moyens que dans l’absence de stratégie européenne unifiée. Les divisions internes, particulièrement visibles sur le dossier israélo-palestinien, limitent sa capacité à peser.
Le modérateur rappelle l’importance de ne pas abandonner les grands principes du droit international. Le respect affiché des principes universels pourrait constituer un différenciateur stratégique pour les puissances européennes, à condition de ne pas verser dans l’angélisme.
La Syrie post-Assad : orientations futures ?
Un membre du public interroge : la Syrie sera-t-elle alignée avec Israël ou avec l’Iran ? Pierre Razoux répond avec prudence que le sujet n’est pas suffisamment mûr.
Le directeur académique suggère de raisonner « en creux », en identifiant ce que la communauté internationale ne souhaite pas. Il existe un consensus – rassemblant Occidentaux, Turquie, pays du Golfe et même la Russie – pour éviter que la Syrie ne devienne un sanctuaire djihadiste, un État failli source d’instabilité, ou une plateforme de projections déstabilisantes. À partir de ce socle d’intérêts convergents, un processus de reconstruction peut être engagé.
Nicolas Badaoui ajoute que plusieurs facteurs plaideront pour une neutralisation relative. D’abord, l’épuisement de la société syrienne après quatorze années de guerre : la priorité est la reconstruction, pas les aventures régionales. Ensuite, la dépendance vis-à-vis de l’aide internationale contraindra à des concessions politiques et à un comportement régional modéré. Enfin, la présence de multiples acteurs externes créera un système d’équilibres limitant la marge de manœuvre de Damas.
Le modérateur évoque la levée progressive des sanctions comme levier d’influence crucial. La communauté internationale, en conditionnant le desserrement de l’étau économique à des avancées politiques tangibles, dispose d’un instrument puissant pour orienter les choix syriens.
Les paradoxes du Golfe
Bien que le modérateur ait écarté initialement cette question, des éléments de réponse émergent. Giovanni Romani revient sur le paradoxe fondamental de ces États : un décalage profond entre la vision politique des dirigeants, miseurs sur la normalisation avec Israël et le développement économique, et les aspirations de leurs populations, solidaires de la Palestine.
Pierre Razoux rappelle qu’environ 60-70% de la population du Golfe a moins de 30 ans. Cette jeunesse, connectée aux réseaux sociaux, exposée aux images de Gaza, nourrit une solidarité panarabe renouvelée avec les Palestiniens. Les dirigeants doivent naviguer entre leurs intérêts stratégiques – partenariats avec Israël – et la nécessité de maintenir une légitimité interne.
La société israélienne face à son gouvernement
Léa Landman complète les analyses précédentes en soulignant que la société israélienne n’est pas monolithique. Si le gouvernement Netanyahu bénéficie actuellement d’un soutien majoritaire pour sa politique sécuritaire, des voix dissidentes s’expriment, particulièrement au sein de la gauche israélienne et dans certains milieux intellectuels. Les familles d’otages ont également émergé comme une force politique contestant la stratégie gouvernementale.
Toutefois, Joost Hiltermann tempère : le spectre politique israélien s’est globalement déplacé vers la droite sur deux décennies. Les partis favorables à une solution négociée avec les Palestiniens, qui dominaient la scène dans les années 1990, sont aujourd’hui ultra-minoritaires. La droite nationaliste et religieuse occupe désormais le centre de gravité politique. Cette évolution reflète des transformations démographiques et un désenchantement profond vis-à-vis du processus de paix.
Le « Mystigri » palestinien
Pierre Razoux clôt les échanges par une métaphore saisissante. Reprenant sa « casquette d’historien », le professeur compare le dossier palestinien à un « Mystigri » : « tout le monde joue avec, tout le monde s’y intéresse, mais tout le monde veut le passer au voisin pour surtout pas finir avec le Mystigri à la fin. »
Cette image résume crûment la réalité politique. Depuis des décennies, les acteurs régionaux et internationaux instrumentalisent la cause palestinienne – légitimation interne, affirmation régionale, levier dans des négociations – sans s’engager véritablement dans la résolution du conflit. Chaque acteur préfère que ce soit un autre qui assume le coût politique, financier et sécuritaire d’une véritable résolution.
Cette observation désabusée résonne particulièrement après une table ronde qui a multiplié les analyses sur les reconfigurations régionales, l’affaiblissement de certains acteurs, l’émergence d’autres, sans qu’émerge une perspective claire de règlement du conflit israélo-palestinien. Peut-être la communauté internationale préfère-t-elle gérer indéfiniment un conflit de basse intensité plutôt que d’affronter les coûts politiques d’une résolution définitive.
Le modérateur remercie chaleureusement les panélistes et conclut les échanges en invitant à poursuivre les discussions lors des prochaines tables rondes. Cette séquence aura permis d’ouvrir des perspectives complémentaires, de nuancer certains propos, et de rappeler que si l’analyse géopolitique nécessite lucidité et réalisme, elle ne doit pas conduire au cynisme ni à l’abandon des principes qui fondent l’ordre international.
Conclusion : Pistes d’exploitation pédagogique pour l’enseignement de spécialité HGGSP en Terminale
Cette table ronde « Une nouvelle donne stratégique au Levant ? » offre je crois un matériau pédagogique exceptionnel pour l’enseignement de la spécialité Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques en classe de Terminale. La richesse des analyses, la diversité des intervenants et l’actualité brûlante du sujet permettent de mobiliser plusieurs thèmes du programme tout en développant des compétences essentielles chez les élèves. Voici quelques pistes de réflexion.
Ancrage dans les thèmes du programme HGGSP
Thème 2 : Faire la guerre, faire la paix – Formes de conflits et modes de résolution
Ce thème central du programme trouve dans cette table ronde une illustration parfaite et contemporaine. L’enseignant peut y puiser de multiples entrées :
L’évolution des formes de conflictualité est au cœur des analyses présentées. Le passage d’Israël d’une doctrine défensive basée sur la dissuasion à une stratégie offensive préventive permet d’étudier concrètement comment un État redéfinit sa doctrine militaire face à des menaces perçues comme existentielles. Les élèves peuvent ainsi travailler sur la notion de guerre préventive versus guerre défensive, en mobilisant les cadres juridiques du droit international et en questionnant leur application réelle.
Les nouvelles formes de guerre évoquées tout au long de la table ronde – frappes ciblées par drones, guerre d’information, cyberattaques, stratégie de décapitation des organisations adverses – illustrent parfaitement les mutations contemporaines de la conflictualité. L’enseignant peut faire travailler les élèves sur un tableau comparatif entre les guerres conventionnelles du XXe siècle et ces nouvelles formes de confrontation, en s’appuyant sur les exemples concrets fournis (élimination de Nasrallah, opérations israéliennes contre le programme nucléaire iranien).
La question des modes de résolution des conflits traverse l’ensemble des débats. L’échec des processus de paix traditionnels (Oslo, Annapolis), l’épuisement de la solution à deux États, les tentatives de normalisation via les accords d’Abraham, puis le « plan Trump » évoqué : autant d’occasions d’étudier les obstacles à la résolution pacifique des conflits et le rôle – souvent contradictoire – des puissances tierces.
Thème 6 : L’enjeu de la connaissance – Jalon sur les nouvelles conflictualités
Bien que moins directement mobilisé, ce thème trouve des résonnances dans les discussions sur la guerre de l’information, la désinformation, et l’importance du renseignement dans les opérations militaires contemporaines mentionnées à plusieurs reprises par les intervenants.
Problématiques d’étude structurantes
Les collègues peuvent organiser une exploitation pédagogique autour de plusieurs problématiques qui traversent la table ronde :
Problématique 1 : Comment les recompositions régionales au Levant illustrent-elles les nouvelles formes de conflictualité au XXIe siècle ?
Cette problématique permet d’embrasser l’ensemble de la table ronde en questionnant la nature même des affrontements contemporains. Les élèves peuvent identifier les différents acteurs (États, organisations non-étatiques, puissances régionales et globales), leurs objectifs respectifs, et les moyens qu’ils déploient. L’étude de l’effondrement de « l’axe de la résistance » offre un cas d’école pour comprendre comment des réseaux transnationaux se construisent et se défont au gré des rapports de force.
Problématique 2 : La question palestinienne est-elle soluble dans les reconfigurations stratégiques régionales ?
Cette problématique, volontairement provocatrice, reprend l’image du « Mystigri » évoquée en conclusion des questions du public. Elle permet d’interroger la permanence d’un conflit malgré les bouleversements régionaux, et de questionner la responsabilité – ou l’irresponsabilité – des différents acteurs. Les élèves peuvent ainsi travailler sur la distinction entre rhétorique politique et action effective, en analysant l’écart entre les déclarations de soutien à la cause palestinienne et les politiques réellement menées par les États arabes.
Problématique 3 : Le « retrait » américain du Moyen-Orient est-il réel ou relatif ?
La première partie consacrée au repositionnement américain offre matière à déconstruire les discours simplistes sur le « désengagement » américain. Les élèves peuvent analyser la différence entre réduction de la présence militaire et maintien de l’influence stratégique, en s’appuyant sur les interventions de Joost Hiltermann. Cette problématique permet également d’aborder la notion de puissance hégémonique, de multipolarité émergente, et de comprendre comment les États-Unis restent « l’acteur extérieur prédominant » malgré leur retrait relatif.
Activités pédagogiques concrètes
Activité 1 : Cartographie dynamique des reconfigurations régionales
Durée : 2 heures | Travail en groupes
Les élèves, répartis en groupes, reçoivent une carte vierge du Levant et doivent y représenter :
- Les zones de contrôle des différents acteurs (2015 vs 2025)
- Les flux d’influence (Iran, Turquie, États-Unis, Russie)
- Les axes de confrontation
- Les zones de réfugiés et déplacements de population
Chaque groupe travaille sur une dimension spécifique (militaire, politique, humanitaire, économique) puis les cartes sont confrontées pour construire une représentation synthétique des enjeux multidimensionnels.
Compétences travaillées : Se repérer dans l’espace, analyser des documents, travailler en groupe, réaliser une production cartographique.
Activité 2 : Simulation de négociations internationales sur la Syrie
Durée : 3 heures | Jeu de rôle
À partir des informations sur la Syrie post-Assad, les élèves incarnent différents acteurs lors d’une conférence internationale fictive sur la reconstruction syrienne :
- Représentants de HTC (nouveau pouvoir syrien)
- Délégation turque
- Délégation des pays du Golfe
- Union européenne
- États-Unis
- Représentants des minorités kurdes et chrétiennes
- ONG humanitaires
Chaque groupe prépare sa position (intérêts, lignes rouges, propositions) puis négocie lors d’une session plénière. L’enseignant joue le rôle de médiateur ONU.
Compétences travaillées : Argumentation, négociation, compréhension de la complexité des intérêts divergents, expression orale structurée.
Activité 3 : Étude critique de documents – L’évolution de la doctrine militaire israélienne
Durée : 1 heure | Travail individuel puis mise en commun
Les élèves reçoivent plusieurs documents :
- Extraits des interventions sur le passage à la guerre préventive
- Document sur la doctrine militaire israélienne traditionnelle
- Chronologie des opérations 2023-2025
- Extraits du droit international sur la légitime défense
Ils doivent analyser cette évolution doctrinale en répondant à des questions progressives :
- Quelle était la doctrine traditionnelle israélienne ? Sur quels principes reposait-elle ?
- Quels événements ont provoqué son évolution ?
- Comment cette nouvelle doctrine est-elle mise en œuvre concrètement ?
- Quelles sont les limites juridiques et éthiques de cette approche ?
Compétences travaillées : Analyse documentaire, esprit critique, contextualisation historique, mobilisation de connaissances juridiques.
Activité 4 : Débat argumenté – « La normalisation israélo-arabe peut-elle se faire sans règlement de la question palestinienne ? »
Durée : 2 heures | Débat structuré
À partir des informations sur les acteurs régionaux et notamment le positionnement des pays du Golfe, les élèves préparent un débat structuré selon la méthode du débat parlementaire britannique :
- Une équipe défend la thèse : « La normalisation peut et doit se poursuivre indépendamment du dossier palestinien »
- L’autre équipe soutient : « Aucune stabilité régionale n’est possible sans résolution du conflit israélo-palestinien »
Chaque équipe dispose de 30 minutes de préparation avec accès aux extraits de la table ronde, puis 5 minutes d’argumentation initiale, suivies d’échanges contradictoires.
Compétences travaillées : Argumentation structurée, expression orale, esprit critique, capacité à défendre une position même différente de sa conviction personnelle.
Axes d’analyse transversaux
Au-delà des activités spécifiques, plusieurs axes d’analyse transversaux peuvent être développés avec les élèves tout au long de l’étude de cette table ronde :
Le rôle des organisations internationales et régionales
L’ONU, l’OTAN (via l’intervention de Giovanni Romani), l’Union européenne, la Ligue arabe : autant d’organisations dont le rôle – effectif ou limité – est évoqué tout au long des débats. Les élèves peuvent questionner l’efficacité de ces institutions face aux crises contemporaines, en s’appuyant sur des exemples concrets (FINUL au Liban, résolutions de l’ONU non appliquées, etc.).
La tension entre principes juridiques et réalisme politique
Cette tension traverse l’ensemble de la table ronde et rejoint une des finalités essentielles de l’enseignement HGGSP : comprendre la complexité du monde. Le modérateur lui-même la souligne lors des questions du public en insistant sur l’importance de ne pas abandonner les grands principes tout en restant réaliste. Les élèves peuvent travailler sur cette dialectique à travers plusieurs cas : le droit international face aux opérations militaires israéliennes, la reconnaissance de l’État palestinien, les sanctions contre la Syrie, etc.
Le décalage entre élites dirigeantes et opinions publiques
Particulièrement visible dans le cas des pays du Golfe, ce décalage offre une entrée pour étudier les régimes politiques, la notion de légitimité, et les risques de déstabilisation. Les élèves peuvent comparer différents cas : Israël (polarisation de la société), pays du Golfe (jeunesse et solidarité palestinienne), Égypte et Jordanie (crainte des pressions migratoires).
La question des réfugiés et déplacements de population
Dimension souvent sous-estimée mais centrale dans tous les conflits du Levant. Les chiffres sont vertigineux : millions de Syriens déplacés, Palestiniens de Gaza, menaces de transferts forcés. Cette dimension permet de relier l’étude géopolitique aux enjeux humanitaires et éthiques.
Ressources complémentaires pour approfondir
L’enseignant peut enrichir son cours en mobilisant des ressources externes qui complètent les analyses de la table ronde :
Ressources cartographiques :
- Les cartes de l’OCHA sur la situation humanitaire à Gaza et en Syrie
- Les cartes du Monde diplomatique sur le Moyen-Orient
- Les productions cartographiques de la FMES (source de la carte présentée durant la table ronde)
Ressources documentaires :
- Les rapports de l’International Crisis Group (organisation de Joost Hiltermann)
- Les analyses du Washington Institute for Near East Policy
- Les dossiers thématiques de France Culture sur le Moyen-Orient
- Les articles des Clionautes sur les questions géopolitiques
Ressources audiovisuelles :
- Documentaires d’ARTE sur les conflits du Moyen-Orient
- Conférences de l’IRIS et de la FMES disponibles en ligne
- Captations des précédentes éditions des RSMed
Évaluation des apprentissages
Plusieurs modalités d’évaluation peuvent être envisagées à l’issue de cette séquence :
Évaluation formative :
- Participation aux débats et activités de groupe
- Production cartographique intermédiaire
- Questions de compréhension au fil de l’étude
Évaluation sommative type Bac :
- Étude critique de documents : corpus de 2-3 documents (extraits de la table ronde + article de presse + carte) avec questions d’analyse
- Exposé oral de 5 minutes sur un acteur régional spécifique (Turquie, Iran, Égypte…) et son positionnement dans les reconfigurations en cours
Prolongements interdisciplinaires
Cette étude peut donner lieu à des prolongements interdisciplinaires enrichissants :
Avec le cours de Philosophie :
- Réflexion sur la guerre juste, la légitime défense, la responsabilité des États
- Étude de textes philosophiques (Kant sur la paix perpétuelle, Clausewitz sur la guerre)
Avec le cours d’Histoire-Géographie tronc commun :
- Chapitre sur le Moyen-Orient depuis 1945
- Thématique des migrations internationales
Avec le cours d’EMC (Enseignement Moral et Civique) :
- Droits de l’homme et situations de conflit
- Rôle des organisations internationales
- Engagement citoyen et solidarité internationale
Conclusion : former des citoyens éclairés
Au-delà des compétences disciplinaires strictes, l’étude de cette table ronde contribue à former des citoyens capables de comprendre la complexité du monde contemporain sans céder aux simplifications binaires. Les élèves apprennent à :
- Distinguer les analyses factuelles des jugements de valeur
- Identifier la pluralité des points de vue légitimes sur des questions controversées
- Comprendre que les acteurs internationaux poursuivent des intérêts parfois contradictoires
- Questionner les discours médiatiques et politiques à l’aune de la réalité des rapports de force
Cette table ronde des Rencontres Stratégiques de la Méditerranée 2025 offre ainsi bien plus qu’un simple support pédagogique : elle constitue une invitation à penser la géopolitique non comme une collection de faits à mémoriser, mais comme une grille de lecture critique et dynamique du monde.
Captation par les équipes de l’Institut FMES de la conférence
Ressources complémentaires pour approfondir
Institutions et organisations :
- Organisation des Nations Unies – Pour les résolutions et rapports officiels
- OTAN – Analyses stratégiques sur la région
- International Crisis Group – Rapports détaillés pays par pays
- Institut Français des Relations Internationales (IFRI) – Analyses géopolitiques en français
Médias spécialisés :
- Orient XXI – Analyses approfondies sur le Moyen-Orient
- The Washington Institute – Perspective américaine
- Al-Monitor – Actualités régionales
Ressources académiques :
- Cairn.info – Articles de revues en sciences sociales
- Institut Français du Proche-Orient – Recherches sur la région