La table ronde réunit des voix aussi diverses qu’engagées. Ils explorent une crise souvent évoquée, mais rarement saisie dans toute sa complexité : l’effondrement accéléré de la biodiversité en Indonésie.
Autour de la table modérée Judicaëlle Dietrich, géographe :
- Patrice Costa, grand reporter et biologiste, dont les enquêtes ont documenté les ravages de la déforestation sur les écosystèmes indonésiens ;
- Frédéric Durand, géographe émérite, spécialiste des enjeux climatiques ;
- Nicolas Rouillé, écrivain, dont le roman Timika plonge dans les réalités brutales de l’extractivisme en Papouasie occidentale ;
Leur dialogue vise à démêler les mécanismes d’un système où s’entremêlent intérêts économiques, défaillances politiques et complicités internationales.
Un archipel au cœur de l’oubli écologique
L’Indonésie, avec ses 17 000 îles étirées entre l’Asie et l’Océanie, est bien plus qu’un simple point chaud de la biodiversité. C’est un laboratoire à ciel ouvert des tensions entre développement et préservation. Les chiffres, souvent cités, prennent ici une résonance particulière :
10 % des espèces mondiales y trouvent refuge, un chiffre qui pourrait atteindre 30 % si l’on intégrait les micro-organismes et les espèces endémiques encore inconnues. Pourtant, cette richesse reste largement invisible : seulement 2 à 4 % des espèces terrestres sont répertoriées, un aveu d’ignorance qui interroge sur l’ampleur de ce que nous laissons disparaître sans même le connaître.
Cette méconnaissance n’est pas anodine. Elle alimente l’indifférence, permettant aux mécanismes de destruction de se perpétuer sans véritable opposition. Les forêts indonésiennes, parmi les plus anciennes et les plus complexes de la planète, sont rasées à un rythme effréné, remplacées par des monocultures de palmier à huile, des mines à ciel ouvert ou des infrastructures industrielles. À Kalimantan, 70 % des forêts primaires ont déjà disparu, transformant des écosystèmes foisonnants en déserts biologiques. Les causes de cette destruction sont multiples : l’exploitation forestière légale et illégale, souvent encouragée par des cadres réglementaires laxistes et des corruptions endémiques, ainsi qu’une demande internationale insatiable en ressources naturelles.
La déforestation : une machine de guerre contre le vivant
La destruction des forêts indonésiennes n’est pas un phénomène naturel, mais le résultat d’un système économique et politique délibéré. Les plantations de palmier à huile, présentées comme un moteur de développement, sont en réalité des bombes écologiques. Elles stérilisent les sols, chassent les espèces endémiques et transforment des communautés entières en réfugiés environnementaux. Les gibbons, ces singes arborescents aux longs bras, symbolisent cette tragédie : leurs habitats détruits, ils deviennent les proies d’un trafic lucratif où un bébé, arraché à sa mère pour 25 dollars dans un village, peut se vendre 10 000 dollars à Singapour.
La déforestation ne se limite pas à la perte d’habitats. Elle alimente des conflits sociaux et des violations des droits humains. En Papouasie occidentale, la mine de Freeport, exploitée depuis les années 1970, rejette ses déchets directement dans les rivières, empoisonnant les sols et les populations locales. Les Dayaks, peuple autochtone de Bornéo, et les Papous, marginalisés sur leurs propres terres, voient leurs modes de vie systématiquement écrasés par l’avancée des bulldozers et des concessions minières. Leur résistance, souvent pacifique, se heurte à une répression militaire d’une violence inouïe : en Papouasie, 50 000 soldats sont déployés pour « protéger » des intérêts économiques soit un militaire pour 10 habitants, transformant la région en une zone de non-droit où les arrestations arbitraires, les tortures et les meurtres sont monnayées par un silence international complice. Cette surmilitarisation n’a qu’un objectif : protéger les intérêts économiques des multinationales, au mépris des droits humains.
Les initiatives locales de préservation, comme le centre Kalaweit fondé par Aurélien Brûlé pour sauver les gibbons, restent des îlots de résistance dans un océan de destruction. Ces efforts, bien que remarquables, sont systématiquement sabordés par l’absence de volonté politique et la pression des lobbies industriels.
Gouvernance et responsabilités : l’échec des institutions
L’Indonésie est un miroir grossissant des défaillances des modèles de gouvernance environnementale. Les lois existent, mais leur application est une chimère. Les forêts de tourbe, théoriquement protégées depuis 2011, continuent d’être détruites, faute de financements internationaux pour compenser les pertes économiques. La corruption, omniprésente, gangrène les institutions : les gouverneurs locaux, souvent actionnaires de compagnies de palmier à huile, bloquent toute régulation qui pourrait menacer leurs intérêts.
L’État indonésien n’est pas seul responsable. Les États-Unis, en refusant de signer la Convention sur la diversité biologique de 1992, ont privé les pays du Sud de mécanismes de compensation pour préserver leurs écosystèmes. Les promesses de financement, comme le Fonds vert issu de l’Accord de Paris, sont restées lettre morte, laissant les gouvernements locaux sans alternatives face à la pression des multinationales. Comme l’a souligné Frédéric Durant, « les pays du Nord ont une responsabilité écrasante. Ils ont construit un système où la biodiversité n’a de valeur que si elle rapporte. Et quand elle ne rapporte pas, on la détruit. »
Entre subsistance et préservation : le dilemme indonésien
L’Indonésie, 4ème pays le plus peuplé du monde, est tiraillée entre deux impératifs apparentement inconciliables : nourrir une population en croissance et préserver des écosystèmes uniques. Dans les campagnes, la survie prime : les projets de transmigration (déplacement de populations vers des zones forestières) et le déménagement de la capitale (de Jakarta, menacée par la montée des eaux, vers Bornéo) risquent d’accélérer la déforestation, malgré les discours sur une « ville verte ».
Pourtant, la jeunesse urbaine descend dans la rue. Elle réclame un autre modèle, refusant l’héritage d’un développement prédateur qui a déjà trop coûté. Mais son combat se heurte à une réalité implacable : le modèle économique occidental, fondé sur la croissance infinie et l’exploitation des ressources, est incompatible avec la préservation des forêts tropicales. Les certifications « durables », comme l’huile de palme « responsable », sont souvent des leurres, permettant aux entreprises de verdrir leur image sans changer leurs pratiques.
Quelles solutions ? Une mobilisation à plusieurs échelles
Les intervenants ont esquissé des pistes pour une action concrète. Redonner le pouvoir aux communautés autochtones est essentiel, car leurs savoirs traditionnels sont la clé d’une gestion durable des forêts.
Comme l’a rappelé Patrice Costa, ce sont eux qui protègent réellement la biodiversité. Mais on leur retire systématiquement les moyens de le faire.
Sanctionner les acteurs destructeurs est également crucial en créant des tribunaux internationaux pour juger les crimes écologiques. Il faudrait boycotter les entreprises qui refusent de changer leurs pratiques. Il est urgent de repenser les modèles économiques pour sortir de la logique extractiviste et promouvoir des alternatives durables. Ainsi, l’agroécologie ou l’économie circulaire s’imposent comme une nécessité. Enfin, éduquer et sensibiliser à travers la littérature, le cinéma (comme La Promesse verte) et les médias permet de rendre visibles les réalités invisibilisées.
Frédéric Durant a résumé l’urgence avec une phrase cinglante :
« Il faut une révolution mentale à l’échelle planétaire. Tant que nous continuerons à croire que la croissance est la seule voie possible, nous courons à la catastrophe. »
Conclusion : un appel à l’action
Cette table ronde a révélé une crise systémique, où écologie, justice sociale et économie sont indissociablement liées. La préservation de la biodiversité en Indonésie n’est pas qu’une question environnementale. C’est un enjeu de civilisation, qui interroge notre rapport au vivant et notre capacité à imaginer un autre monde.
Trois niveaux d’action s’imposent. Localement, redonner le pouvoir aux communautés autochtones, dont les savoirs sont la clé d’une gestion durable. Nationalement, exiger une réforme radicale de la gouvernance, avec des lois appliquées et une lutte sans merci contre la corruption. Et internationalement, financer la transition écologique et sanctionner les États et entreprises complices de la destruction.
Comme l’a souligné Nicolas Rouillé, la littérature et l’art ont un rôle crucial à jouer : ils doivent nous aider à imaginer un autre monde, avant qu’il ne soit trop tard. Repenser notre rapport au vivant n’est plus une option, mais une urgence absolue.
















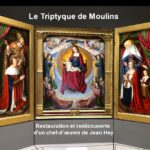
Bravo pour ton compte-rendu. J’ai adoré