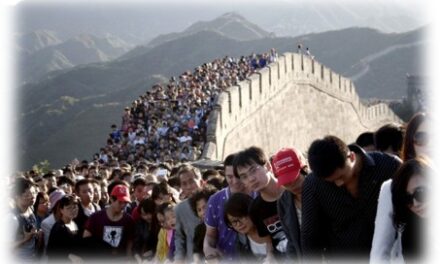La gestion des communs peut-elle redonner du pouvoir aux citoyens sur leur territoire face au changement climatique ?
À partir de l’exemple de l’agropastoralisme, cette rencontre explore les rapports entre habitants, institutions et propriétaires. Elle interroge le rôle de la propriété, de l’expertise et des savoirs locaux dans l’adaptation.
Patricia ANDRIOT, commissaire à l’aménagement au Massif des Vosges, ingénieur agro-économiste de formation, introduit la rencontre :
Un espace partagé est un lieu de pouvoir et de conflits d’usage potentiels.
Quel est votre vécu du partage de l’espace, à partir de votre expérience de pastoralisme?
Bruno CARAGUEL, sociologue, président de l’association Française du pastoralisme, définit le pastoralisme. Il est présent dans les Alpes, les montagnes mais aussi sur les rivages fluviaux ou maritimes ; on pourrait élargir à d’autres espaces : le Sahara, le Nord avec les troupeaux de rennes.
Le pastoralisme contribue à valoriser des ressources disponibles en amenant des aliments et un mode de vie impliquant du mouvement. Il est nécessaire de renouveler les relations avec les acteurs locaux. Le pastoralisme s’insère dans des espaces patrimoniaux et souvent protégés. Ils sont le fruit d’une co-évolution troupeau/nature dans les espaces agro-pastoraux. Le pastoralisme a une reconnaissance au niveau mondial.
Corinne EYCHENNE, incarne le regard de la géographe : Que dit le pastoralisme sur un espace et sa gestion ? Le pastoralisme est un lieu du collectif, il existe une persistance d’usages anciens (les communaux).
Elle définit les « communs » pyrénéens : une forme d’appropriation alternative entre publique et privée. Les communautés y définissent des droits d’accès. Il en demeure des traces aujourd’hui dans l’ouest des Pyrénées.
Les droits d’usage collectifs se situent à 3 niveaux : les pratiques (mélange des troupeaux), propriété publique, gestion collective d’un espace (groupements pastoraux). Collectif signifie un pouvoir partagé et donc des discussions permanentes qui peuvent déterminer des hiérarchies de pouvoir (quels animaux, pour quels exploitants professionnels ou non).
Autres niveaux : les autres usagers (chasse, promenade, tourisme) donc les discussions sont nécessaires pour éviter les conflits de pouvoir.
Certains usagers non-locaux pensent parfois avoir tous les droits.
Jean Sébastien LAUMOND, ingénieur agronome, témoigne de l’exemple vosgien : les associations de gestion du pastoralisme.
Sur ce territoire, les enjeux sont le maintien des espaces intermédiaires en moyenne altitude.
L’association est indispensable face à une propriété très morcelée qui rend difficile le travail des éleveurs.
L’entité de gestion est acquise si 50 % des propriétaires sont d’accord. Le rôle des collectivités locales est important, surtout quand il y a aussi de la propriété publique. Il existe des relations de pouvoir entre le collectif et certains propriétaires privés. D’où l’intérêt d’espace de discussions sur l’avenir du territoire. Quel projet pour un territoire ? Cela redonne une forme de pouvoir aux propriétaires qui participent, le petit propriétaire-habitant. Cela dépasse la seule pratique agricole, on est dans la gestion des communs et cela touche à l’identité d’un territoire.
Exemple sur la vallée de la Bruche avec un enjeu : l’ouverture des paysages.
Une démarche paysagère avec comme outil l’association foncière pastorale, une démarche envisageable aussi pour la gestion forestière, après le déclin de l’ouvrier-paysan.
L’association foncière pastorale conduit au dialogue, mais parfois aussi au conflit. Le paysage est un outil pour créer une vision collective. Cela donne une force d’action pour répondre à des enjeux paysagers, agricoles. Le 100 % prairie s’est développé, de nouveaux agriculteurs ont pu s’installer en vente directe.
Face au changement climatique, quels impacts sur les pratiques pastorales et sur les relations de pouvoir?
J. S. L : Dans la vallée de la Bruche, le changement a entraîné une réduction du nombre de bêtes par troupeau, car la sécheresse estivale réduit le fourrage disponible. Cette situation remet en cause le 100 % prairie en incitant à la mise en culture (maïs) avec un risque de perte de biodiversité (recul des « prairies fleuries »). Pourtant, la prairie est un puits de carbone et le recul des prairies menace aussi les ressources en eau.
Cela met en difficulté certaines des associations foncières pastorales. Quelques débats ont eu lieu avec les forestiers, la mosaïque espaces ouverts/forêt est importante comme coupe-feu.
B. C : Même constat dans les Alpes. La baisse de la quantité de neige en hiver affecte la ressource en eau. D’autre part, la chaleur urbaine en été invite à une plus grande fréquentation des espaces montagnards par des personnes qui ne connaissent pas le pastoralisme, situation potentiellement génératrice de conflits. La pression touristique se manifeste sur l’eau et il y a peu de lieux de dialogue.
En Rhône-Alpes, en 2003, a été soutenu l’idée de négociations de plans pastoraux territoriauxPour des exemples : Plan Pastoral Territorial du Beaufortain, Val d’Arly et Grand Arc 2015 – 2019 – Plan Pastoral Territorial du Vercors 4 montagnes 2016 – 2020, ce qui a permis de larges tours de table, par exemple en Vercors.
Ces lieux de discussion sont de « petits parlements » qui gèrent ces crédits de la Région pour améliorer les conditions de travail des bergers et protéger la biodiversité. Ce modèle a été étendu à la grande région Aura. En ce moment, c’est la prédation du loup qui incite au développement des plans pastoraux.
C. E. présente, pour les Pyrénées, les « commissions syndicales »Sur l’histoire du pastoralisme pyrénéen, voir : Les gestionnaires collectifs d’espaces pastoraux entre reconnaissance et fragilisation : un angle mort de la politique agricole commune ? Par Corinne Eychenne, dans l’ouest du massif : ce sont des « communs », une propriété indivise des montagnes pour la gestion des estives, des forêts et même des stations de ski. Ils traitent du multi-usage, élaborent des codes de bonne conduite (Pays basque).
J. S. L. : Dans les Vosges, la réflexion se fait avec les Parcs naturels régionaux pour une vision transversale et multipartenariale sur un espace. Le sylvopastoralisme, le pâturage sous couvert forestier, est peut-être une piste face au changement climatique.
Conclusion
La gestion collective peut être un atout, mais pourrait aussi être un lieu de conservatisme. Le pastoralisme est une activité plutôt adaptable, c’est peut-être une opportunité pour faire du commun à l’échelle de l’habitant, pour un projet intercommunal.