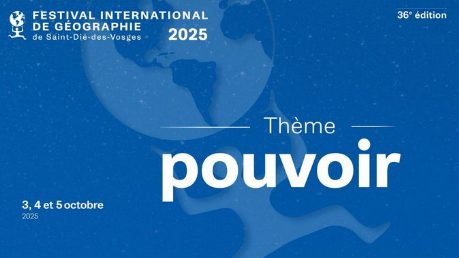La conférence de Paul Cavalliédoctorant à l’Institut Français de Géopolitique (Paris VIII) et au laboratoire EDYTEM (Université Savoie Mont Blanc) explore les territoires disputés en Irak. Ces espaces géographiques et humains sont pris entre les revendications de la Région autonome du Kurdistan irakien et la souveraineté de l’État fédéral irakien. À travers une analyse des dynamiques historiques, politiques et sécuritaires, cette présentation met en lumière les conséquences dramatiques pour les populations minoritaires, souvent oubliées des grands récits géopolitiques.
La Région autonome du Kurdistan irakien : entre autonomie et divisions
La Région autonome du Kurde d’Irak trouve ses origines dans les suites de la répression du mouvement nationaliste kurde par le régime de Saddam Hussein. En 1991, une zone d’exclusion aérienne imposée par l’ONU au nord du 36e parallèle permet aux Kurdes de s’administrer eux-mêmes, en l’absence de l’État irakien. Officiellement reconnue dans la Constitution irakienne de 2005, cette entité est souvent décrite comme un quasi-État, dotée de ses propres institutions (parlement, gouvernement, armée des Peshmergas), d’un système judiciaire autonome et d’un contrôle partiel de ses frontières avec la Turquie et l’Iran.
Cependant, cette unité apparente cache une division territoriale profonde. Le Parti démocratique du Kurdistan (PDK), dirigé par Massoud Barzani, domine la zone nord (capitale : Erbil), tandis que l’Union patriotique du Kurdistan (UPK) contrôle le sud (capitale : Souleimaniye). Cette partition résulte d’une guerre civile kurde en 1992, suivie d’accords de paix précaires. Les revendications territoriales kurdes s’étendent au-delà des frontières officielles (la green line), s’appuyant sur des arguments démographiques (présence de populations kurdes), historiques (ces territoires faisaient historiquement partie du Kurdistan) et géographiques (zones montagneuses associées à l’identité kurde). Une carte officielle du Parlement kurde irakien superpose ces frontières revendiquées et les reliefs montagneux, illustrant une stratégie de légitimation territoriale par la géographie.
Les territoires disputés : une mosaïque ethno-religieuse sous tension
Contrairement à l’image simplifiée d’un Irak divisé entre Arabes et Kurdes, les territoires disputés abritent une diversité ethno-religieuse exceptionnelle. À Sinjar, la majorité yézidie, bien que Kurdophone, entretient un rapport complexe avec l’identité kurde. Tel-Afar est majoritairement turkmène, tandis que la plaine de Ninive compte des communautés chrétiennes assyro-chaldéennes, shabaks et kakaïs. Kirkouk, ville multiethnique, est convoitée pour ses ressources pétrolières, représentant 60 % des réserves irakiennes.
Après l’invasion américaine de 2003, les partis kurdes (PDK et UPK) occupent militairement ces territoires, avec l’appui des États-Unis. Ils y établissent une administration de facto, mais le référendum prévu par la Constitution de 2005 pour statuer sur leur statut est reporté indéfiniment. Résultat : une situation d’entre-deux, où le contrôle kurde sur le terrain (écoles, police, économie) contraste avec un statut juridique flou, source de tensions permanentes avec Bagdad.
L’État islamique (2014–2017) : un choc sécuritaire et humanitaire
En août 2014, l’État islamique (EI) lance une offensive contre les Kurdes, provoquant le retrait chaotique des Peshmergas, notamment à Sinjar. Les minorités, abandonnées à leur sort, subissent des crimes de masse : massacres d’hommes yézidis à Kojo, réduction en esclavage des femmes et des enfants. Un exode massif s’ensuit vers le Kurdistan irakien, où des camps de déplacés comme deviennent des espaces de survie précaire. La photo du village de Kojo, où 500 hommes yézidis furent exécutés, reste le symbole de l’effondrement des protections locales et internationales.
La défaite de l’EI en 2017 ne rétablit pas la stabilité. L’État irakien, soutenu par les milices chiites (Al-Hachd al-Chaabi, soutenues par l’Iran), reprend militairement les territoires disputés. Mais cette reconquête s’accompagne d’une marginalisation des minorités : la reconstruction se concentre sur Mossoul, tandis que Sinjar est abandonnée. La multiplication des acteurs armés (milices, armée irakienne, PKK) aggrave la fragmentation sécuritaire, avec l’Iran renforçant son influence et la Turquie intervenant pour contrer le PKK.
Le référendum de 2017 : un tournant diplomatique raté
Le référendum d’indépendance kurde, organisé unilatéralement en 2017, est rejeté par Bagdad et la communauté internationale. Les raisons en sont claires : risque de déstabilisation régionale (opposition de la Turquie, de l’Iran et des États-Unis) et échec diplomatique (perte du soutien occidental acquis pendant la lutte contre l’EI). Cet épisode révèle les limites des revendications kurdes face aux réalités géopolitiques.
Les conséquences pour les minorités sont dévastatrices. Les chrétiens, 1,5 million en 1990, ne sont plus que 400 000 aujourd’hui, en raison d’une émigration massive. Les Yézidis bénéficient de facilités de visas dans certains pays (France, Allemagne), continuent de quitter la région. Les camps de déplacés, où des milliers de familles vivent dans des conditions précaires, témoignent d’une transformation démographique irréversible.
Acteurs externes et ressources : les clés du conflit
La Turquie, alliée du PDK, soutient la lutte contre le PKK et facilite l’écoulement du pétrole kurde. L’Iran, quant à lui, appuie l’UPK et les milices chiites, étendant son influence jusqu’à la Méditerranée. Les ressources pétrolières de Kirkouk et les barrages turcs sur le Tigre et l’Euphrate deviennent des leviers de pression sur l’Irak, dans un contexte marqué par le changement climatique.
Tourisme et reconstruction : des perspectives limitées
Le Kurdistan irakien tente de développer un tourisme interne et international, mais cela ne suffit pas à enrayer l’exode des minorités. Les chrétiens d’Erbil tirent quelques revenus de cette activité, mais l’avenir des communautés minoritaires reste incertain.
Conclusion : un conflit aux répercussions durables
Les territoires disputés restent un enjeu géopolitique majeur, marqué par l’échec des solutions institutionnelles (référendum, fédéralisme), la fragmentation sécuritaire (milices, ingérences étrangères) et la disparition progressive des minorités, piliers de la diversité irakienne.
Bibliographie
Article dans une revue :
« Frontières physiques et frontières ethniques au Kurdistan irakien : le cas particulier des Yézidis du Sinjar », Les Cahiers d’EMAM [En ligne], 35 | 2024
« Gouvernance des minorités par le PDK et ancrage social dans les territoires disputés : stratégies, répertoires d’action, représentations », Études kurdes, 16, 2023
« Qui sont les Yézidis? » kurd’Înalco, 2022, n°2, pp.57-59
Chapitre d’ouvrage :
« La Région Autonome kurde d’Irak : Un quasi-État failli ? », in Cattaruzza Amael (dir), Les Espaces Dissidents, Géotraverse, Presses Universitaires de Vincennes, (à paraitre).
Article de blog scientifique :
« Nadia Murad et l’espoir pour la minorité yézidie d’une aide de la communauté internationale », Le Grand Continent, Groupe d’Études Géopolitiques de l’ENS, 2018.
« Les Forces démocratiques syriennes avancent dans le dernier réduit de l’État islamique en Syrie », Le Grand Continent, Groupe d’Études Géopolitiques de l’ENS, 2018.
« La nouvelle offensive turque contre le Rojava est lancée », Le Grand Continent, Groupe d’Études Géopolitiques de l’ENS 2019