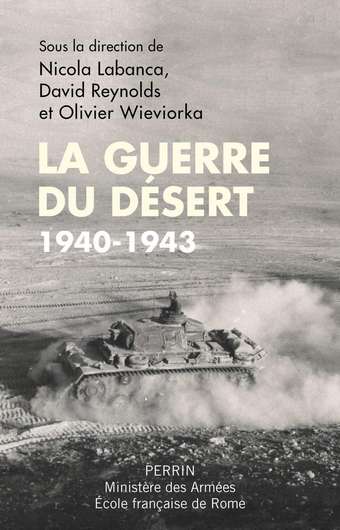Olivier Wieviorka commence par énumérer les préjugés sur la guerre dite « du désert » qui a opposé, en Libye et en Egypte, les armées anglaise et italienne puis les forces de l’Axe et celles des Alliés, de 1940 à 1943 : il se serait agi d’une guerre propre, non idéologique et « sans haine », comme le prétendirent les éditeurs des papiers du maréchal Rommel.
Le livre intitulé La guerre du désert, 1940-1943 (Perrin, 2019) est le fruit d’un travail collectif réparti en trois ateliers. Des historiens allemands, canadiens, français, italiens, américains et maghrébins ont collaboré avec l’appui de différentes institutions : le ministère français de la Défense, l’Ecole française de Rome et les Instituts historiques allemands de Rome et de Paris.
Quatre phases sont successivement étudiées :
– Mussolini engage ce que Hitler appelle une « guerre parallèle » (septembre 1940-février 1941);
– l’Allemagne intervient avec l’Afrika Korps de Rommel (février 1941-juillet 1942);
– les Britanniques donnent un coup d’arrêt et contre-attaquent (été-automne 1942);
– la guerre se traîne entre la victoire d’El Alamein et la prise de la Tunisie (8 novembre 1942-13 mai 1943).
Aucune puissance n’avait envisagé d’intervenir sur ce théâtre sud-méditerranéen.
Il ne s’agit pas d’une guerre pour le pétrole, celui du Moyen-Orient ne fournissant que 10% de la consommation britannique.
Le commandement britannique caresse l’idée d’un assaut contre l’Axe par la Méditerranée. L’opération Torch (le débarquement anglo-américain au Maroc et en Algérie, le 8 novembre 1942) est motivée par le besoin qu’a Roosevelt d’un succès pour les élections de mi-mandat, Churchill en ayant aussi besoin de son côté.
Les Allemands, de leur côté, n’ont jamais considéré le théâtre méditerranéen comme une alternative sérieuse à celui de l’Est. L’Afrika Korps est pour eux plutôt un bouclier, même si certains généraux rêvent d’une jonction dans le Caucase avec les troupes opérant en URSS.
La capitulation au cap Bon, en mai 1943, laisse 250 000 prisonniers aux mains des Alliés, contre 90 000 à Stalingrad, en février précédent.
Il y a peu d’enjeux coloniaux : ni le Reich ni les Etats-Unis ne songent à s’installer.
Les campagnes terrestres sont au service de la stratégie navale. L’amiral Raeder considère ce théâtre comme important, contrairement à Hitler.
Comment expliquer les succès allemands et les revers britanniques ?
Rommel table sur la surprise, la mobilité, les chars et les armes antichars, ainsi que les champs de mines. Son style de commandement, par ses fréquentes apparitions à l’avant, impressionne et soutient le moral.
Mais, comme tous les généraux allemands, il néglige trop la logistique. D’où des pénuries de munitions et de carburant… dont il accuse les Italiens. Il ne crée pas, dans la coalition, une atmosphère friendly. Or 80 % des convois destinés à le ravitailler sont arrivés à bon port. Et les Italiens se sont parfois très bien battus. On peut dire de Rommel que, bon tacticien et mauvais stratège, il aurait eu intérêt à passer plus de temps dans son bureau, à étudier des cartes et à dresser des plans.
Les Britanniques ne croient pas aux chars, s’en servent mal et les dispersent trop souvent. Ils mettent en place une parade, les jock columns, qui n’est guère concluante. Puis ils s’organisent en « boxes », que l’ennemi contourne. Ils négligent l’arme antichars et n’arrivent pas à concentrer leurs forces. L’entraînement des soldats laisse à désirer. Montgomery, nommé à la tête des forces britanniques le 13 août 1942, va insister là-dessus.
Les Américains envoient des chars Sherman, qui arrivent à la veille de la bataille décisive d’El Alamein.
Le renseignement joue un rôle majeur. La révélation du système Ultra permettant de décrypter les messages allemands « Enigma » est due, dans les années 1970, à l’historien britannique Harry Hinsley (1919-1998), lassé des vantardises de Montgomery. C’est grâce aux décryptements que la dernière offensive de Rommel, en août 1942, avait pu être étouffée dans l’œuf. Les Anglais savaient aussi que les Allemands manquaient d’essence. Mais il décryptaient, eux aussi, et usaient de la photographie aérienne. Ultra avait aussi des ratés, soit dans le décryptement, soit dans la transmission.
A El Alamein, le rapport des de 2 contre 1 en faveur des Alliés, aussi bien pour les hommes que pour les chars.
Une guerre chevaleresque ? Que non pas !
De nombreuses troupes coloniales sont utilisées des deux côtés. Aux 20 000 Libyens engagés par l’Axe en août 1941 font pendant les 40 000 de la « force arabe libyenne », côté anglais. Les Dominions veulent avoir voix au chapitre et Canberra obtient le rapatriement de ses troupes en juillet 1942, tandis que le Sud-africain Smuts reprend les siennes après El Alamaein. Cette diversité induit des problèmes de cohérence, les ordres n’étant pas toujours compris. Le racisme confine les troupes de couleur dans des emplois moins nobles : infanterie, intendance… Les empires coloniaux sont ébranlés dans toute l’Afrique du Nord. Ainsi, les succès anglais en Libye de 1940-41 sont accueillis comme une libération par les indigènes, qui subissent, lors de la reconquête, un retour de bâton d’une cruauté extrême. Parfois des Libyens s’en prennent aux troupes italiennes, et Rommel exige une répression très dure. Il en va de même en Tunisie.
Quant aux Juifs, ceux de Libye sont parqués dans des camps tandis que l’officier SS Walter Rauff vient préparer, en juillet 1942, la persécution de ceux de Palestine.
Peu chevaleresque, également, est le traitement des prisonniers de guerre. Leur nombre est colossal. Les Italiens les maltraitent plus que les Allemands, notamment en les dépouillant, ce qui est encouragé par les commandants de camps. Il y a toute une hiérarchie des captifs, au sommet de laquelle trônent les officiers blancs, tandis qu’en bas sont les Français libres et les troupes coloniales, contraints au travail et jamais soignés.
Au total, ce théâtre joue un rôle considérable :
– des ressources considérables sont mobilisées ;
– les Allemands sont piégés : ils engagent peu d’hommes mais beaucoup de matériel, par exemple 40 % de leurs bombardiers, pour un résultat décevant ;
– Churchill insiste pour la conquête de l’Afrique du Nord puis de l’Italie, ce qui empêche une tentative de débarquement en Europe occidentale en 1943 ; la lenteur de la campagne italienne le déçoit ;
– sur ce théâtre se sont formés de nombreux chefs, actifs dans les combats suivants : Eisenhower, Montgomery, Tedder, Patton… et Rommel. Eisenhower se forme aussi politiquement, notamment par ses contacts avec de Gaulle.
– la coopération anglo-américaine se rode et de nombreux soldats s’aguerrissent.
Sur les exactions italiennes on va jeter un manteau de Noé, puisque le pays devient un allié, en 1943 puis pendant la guerre froide.
Répondant à une question sur le rôle des communications, le conférencier remarque que le câble sous-marin entre Gibraltar et Le Caire n’a jamais été coupé. A une autre, précisément, sur les projets d’attaque contre Gibraltar, il répond qu’on a trop dit que Franco était prudent et son ministre des Affaires étrangères, Ramón Serrano Súñer, plus aventuriste, alors que l’inverse est vrai. La décision était dans les mains des Allemands, dont le chef, d’une part, n’avait pas de stratégie méditerranéenne, et, d’autre part, essayait de maintenir un équilibre entre Vichy, l’Espagne et l’Italie.
Au total, une conférence très riche… mais assez infidèle à son sujet ! La « guerre du désert », serait-ce un titre accrocheur pour un ouvrage portant plutôt sur le théâtre méditerranéen ?
Conférence suivie par François Delpla