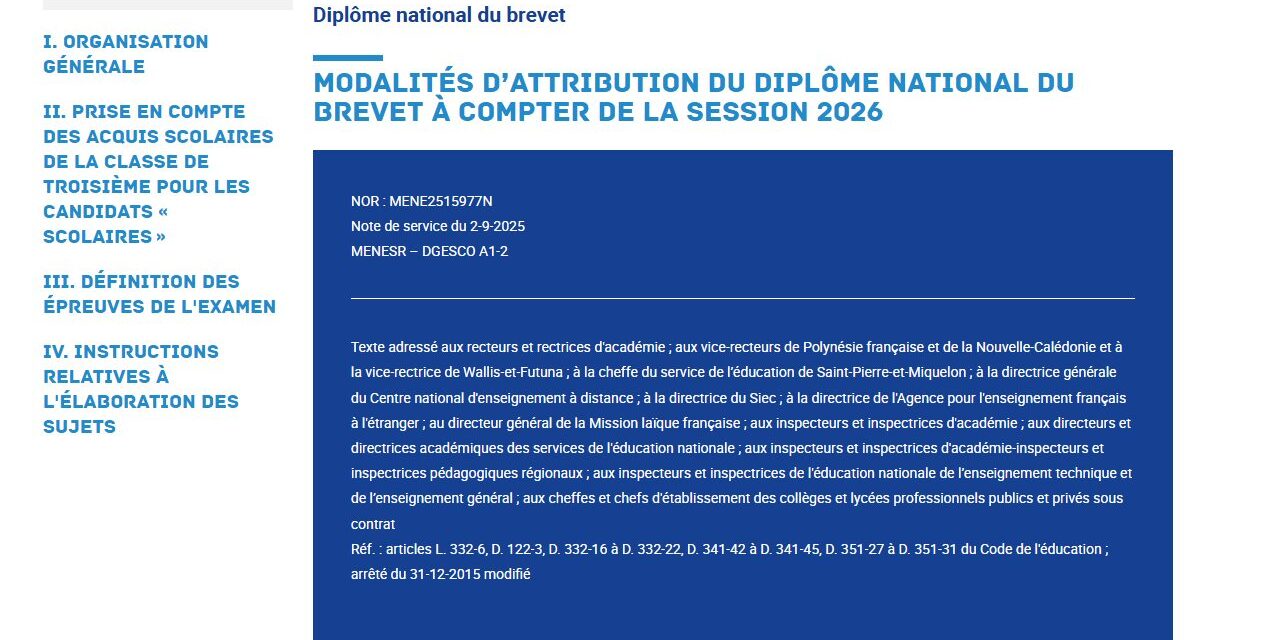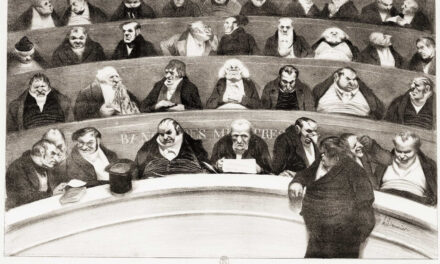Le dernier bulletin officiel a levé le voile sur le nouveau Diplôme national du brevet et les intentions d’Elisabeth Borne sur son souhait de renforcer la valeur de l’examen. Les changements restent limités, d’autant que l’annulation des nouveaux programmes d’HGEMC au collège, éventée cet été, doit encore être officiellement confirmée. Pour le DNB, nous ne développerons pas les changements généraux qui touchent l’ensemble de l’examen, la presse peut y suffire. Nous resterons sur le terrain de nos disciplines.
Confirmation de la séparation de l’EMC et de l’histoire-géographie
C’était déjà le cas à la session 2025 mais désormais, l’histoire-géographie et l’EMC feront l’objet d’une notation séparée.
Les élèves conservent bien une épreuve de deux heures où les trois disciplines, histoire, géographie et EMC, sont évaluées à partir d’un sujet d’examen unique et sans pause. Toutefois le résultat final sera décomposé en deux parties : une partie, l’histoire-géographie, à coefficient 1.5, et une autre, l’EMC, à hauteur de 0.5.
Le texte est ambigu sur le barème total. L’introduction évoque une notation sur 40 ramenée ensuite sur 20 mais à lire de plus près, les 40 points correspondent à l’addition des deux exercices d’histoire-géographie, sur 25 et 15 points. Quid de l’EMC ? Rien ne le précise vraiment.
En toute logique, cette séparation à l’examen oblige à une séparation des lignes sur les relevés de notes et les bulletins pour le calcul du contrôle continu, comme c’est déjà le cas au lycée. Pour l’enseignant, il faudra donc deux appréciations distinctes et des évaluations suffisamment nombreuses en EMC pour que l’idée d’une « moyenne trimestrielle » conserve un sens. Rien n’est explicitement formulé en ce domaine pour l’instant. Les Clionautes ne sont pas favorables à cette course de la note pour la note qui fait suffisamment de ravages au lycée.
Enfin, les résultats en EMC permettant généralement d’amortir de moindres performances en HG, les difficultés des élèves n’en apparaîtront désormais que plus grosses sur la part à coefficient 1.5. La séparation ouvre aussi la voie à la séparation des enseignants : nul besoin d’être professeur d’HG pour faire de l’EMC en lycée, on ne voit plus pourquoi ce ne serait pas le cas au collège dans un avenir proche.
Moins de points pour l’exercice 1 sur l’analyse des documents en histoire-géographie
Peu de changement pour l’exercice 1. Le nombre de points passe de 20 à 15.
On garde le même nombre de documents (1 ou 2). Le questionnement est peut-être plus incisif que précédemment :
« Les exercices visent à évaluer la capacité du candidat à analyser et comprendre ces documents en utilisant les raisonnements et les méthodes de l’histoire et de la géographie, à maîtriser des connaissances fondamentales et à mobiliser les repères chronologiques et spatiaux contenus dans les programmes d’histoire et de géographie. Les questions ou consignes proposées ont pour objectif de guider le candidat pour vérifier sa capacité à identifier ces documents, à en dégager le sens, à en prélever des informations, et, le cas échéant, à porter sur ces documents un regard critique en indiquant leur intérêt ou leurs limites. »
Le fait de devoir « mobiliser » des repères chronologiques et spatiaux et d’adopter un regard critique laissent espérer que l’on dépasse le simple prélèvement d’information mais seuls le sujet zéro et l’usage permettront de le vérifier. Entre une déclaration officielle d’intention et le résultat, il y a souvent un monde.
Le BO précise que les questions seront plus précises quant à la taille de la réponse attendue.
Exercice 2 sur la maîtrise des différents langages pour raisonner et utiliser des repères historiques et géographiques : renforcement de la rédaction
Ici, la pondération choisie renforce l’exercice qui passe de 20 à 25 points. Le développement construit, bête noire des candidats, est allongé pour atteindre un format 30 lignes (20 en voie professionnelle). L’ensemble est noté sur 18 points (au lieu de 13). Le BO précise que « la qualité de la rédaction » sera prise en compte et valorisée dans le barème, en d’autres termes, la maîtrise de la langue. Une telle mention est cohérente avec la volonté affichée ces dernières années de travailler à l’acquisition du français, reste à savoir la place que cela occupera concrètement dans le barème final et les éléments de cadrage de la correction. On a tous en mémoire ces réunions d’entente des jurys où tout est fait pour essayer de dissuader la sanction.
L’EMC
L’EMC n’est plus un exercice 3 mais une « sous-épreuve », suivant la « sous-épreuve histoire-géographie ». Elle est affectée d’un coefficient 0.5. Ce n’est pas beaucoup et, en réalité, cela ne changera pas vraiment l’équilibre précédent même si de fait, la note sera indiquée à part au lieu d’être noyée dans la note sur 50.
L’exercice lui-même n’évolue pas. On part d’une situation pratique exposée par un ou deux documents, suivie de quelques questions de compréhension et d’une petite rédaction. Les questions pourront, sauf la dernière, se présenter sous la forme d’un QCM, d’un tableau, de questions courtes… Quant à la rédaction, elle aussi, sa « qualité » sera prise en compte et valorisée dans le barème. Sur le principe, nous sommes d’accord pour ne pas négliger la maîtrise de la langue mais comme nous avons pu le dire, c’est au pied du mur que l’on reconnaît le maçon. Rendez-vous fin juin pour voir ce qu’il restera de ces textes.