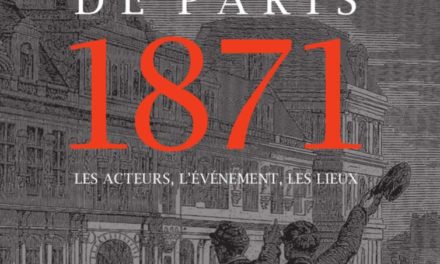Table ronde proposée par le Ministère des Armées. Modération Arnaud PAPILLON, professeur d’histoire, chef du pôle « rayonnement de la politique mémorielle » au Bureau de l’action pédagogique et de l’information mémorielles de la Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives du ministère des armées intervenants. Serge BARCELLINI, contrôleur général des armées (2s) et président général du Souvenir Français, Sébastien LEDOUX, chercheur en histoire contemporaine à l’Université Paris 1- Panthéon-Sorbonne.
Les participants et la problématique
Cette table ronde fut organisée autour de trois axes de réflexion :
- Interroger les termes de « devoir de mémoire » et de « travail de mémoire » et les mémoires auxquelles ils se rapportent prioritairement.
- Montrer comment « l’invention » du devoir de mémoire permet de revenir aux fondements de l’action mémorielle, d’en écrire l’histoire politique et institutionnelle et d’identifier les temps forts de cette construction au XXe siècle.
- Comprendre les raisons qui font que la formule de « travail de mémoire » semble désormais s’imposer auprès des acteurs mémoriels.
Sébastien Ledoux est l’auteur de Le devoir de mémoire. Une formule et son histoire, version éditoriale d’une thèse de doctorat dirigée par Denis Peschanski, soutenue en Sorbonne à l’automne 2014, sous le titre Le temps du « devoir de mémoire », des années 1970 à nos jours. Il vient de publier chez Belin, La Nation en récit. Il lui revient de traiter de la notion de devoir de mémoire, de ses origines et de son histoire.
Serge Barcellini a été la cheville ouvrière de la création de la Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA) qui pilote la politique mémorielle du ministère et qui a une approche opérationnelle de cette politique.
Leurs interventions sont complémentaires et autorisent un compte-rendu thématique de la table ronde
Aux origines de la formule « devoir de mémoire »
La formule « devoir de mémoire » n’appartient pas au vocabulaire employé par les associations d’anciens déportés du lendemain de la guerre jusqu’aux années 1980. Les premières occurrences de cette expression remontent à 1972 et sont le fait d’un écrivain et professeur de littérature d’une part, d’un psychanalyste d’autre part ; les deux occurrences non pas de référent commun et l’expression ne se rattache à aucun événement historique. L’expression est ensuite utilisée en 1980 par le philosophe Philippe Némo et en 1983 par l’historien Pierre Nora.
Cet usage du « devoir de mémoire » par Pierre Nora au début des années 1980 s’inscrit dans un contexte large qui voit depuis plusieurs années apparaître de nouveaux usages du mot mémoire, qui servent à formuler un nouveau rapport au passé. Le terme s’est enrichi dans les années 1970 d’un nouveau sens dans lequel se conjuguent les notions d’identité et de patrimoine. De nombreux livres, la création de musées des arts et traditions populaires et de nouvelles émissions de télévision reflètent alors l’attrait du public pour l’histoire de la vie quotidienne à travers les récits de vie de simples gens.
Les occurrences de « devoir de mémoire » relatives au génocide des Juifs apparaissent à partir du milieu des années 1980. A la charnière des décennies 1980-1990, ce fait historique devient la référence principale du « devoir de mémoire ». Dans cette référence on distingue plusieurs sens : référence à un impératif moral ; référence à la lutte contre l’impunité des criminels nazis et leurs complices ; référence à la construction d’une identité juive post-génocidaire ; référence au combat politique contre le négationnisme porté par l’extrême droite en France.
Devoir de mémoire » est employé dans l’article « Shoah » qui fait son entrée pour la première fois dans l’Encyclopaedia Universalis en 1989, apparition directement liée au titre du film de Claude Lanzmann sorti en avril 1985, terme qui s’impose par la suite rapidement en France pour désigner le génocide des Juifs.
L’expression fait son entrée en 1984-1985 dans le vocabulaire des politiques officielles du passé, essentiellement par l’intermédiaire d’un homme, Jean Laurain, ministre des Anciens combattants, professeur de philosophie nourri de la pensée de Kant et de Bergson, qui voit dans le rappel des deux guerres mondiales « une propédeutique pour la construction de la paix en France et en Europe« . Le terme « mémoire » remplace le terme « souvenir » jusqu’au cœur des structures administratives du ministère des Anciens combattants. Avec la création de la Commission nationale de l’information historique pour la paix, l’Etat se dote de d’un instrument des politiques publiques du passé. Son secrétaire général, Serge Barcellini, est l’artisan de cette mutation sémantique.
C’est lui qui développe l’utilisation institutionnelle des expressions « lieu de mémoire » et « politique de la mémoire ». Au sein du ministère des Anciens combattants est ensuite créée une Délégation à la mémoire des conflits contemporains qui devient la Délégation à la mémoire et à l’information historique.
L’année 1992 marque l’entrée du « devoir de mémoire » sur la scène publique.
« Lorsque l’on suit l’évolution quantitative et qualitative du terme, la trajectoire du devoir de mémoire connaît un tournant en 1992-1993. Le terme apparaît alors pour la première fois simultanément dans les quotidiens nationaux de la presse écrite, à la télévision, à la radio ainsi qu’en titre d’une association. Son introduction dans l’actualité peut également être mesurée par l’augmentation du nombre des occurrences signalées dans les dépêches de l’AFP. » Elle atteint son apogée en 1993. A la session du baccalauréat de juin 1993, le ministère de l’Education nationale propose aux élèves de terminale des séries littéraires de plusieurs académies le sujet de philosophie suivant » Pourquoi y a-t-il un devoir de mémoire ? » Ce sujet croise plusieurs thèmes du programme officiel de philosophie de la série littéraire : la mémoire, l’histoire, la vérité, le temps, la mort.
Trois semaines après le sujet du baccalauréat, « Devoir de mémoire » est choisi en titre de l’émission télévisée La marche du siècle, le 30 juin 1993. Jean-Marie Cavada reçoit le philosophe Paul Ricoeur, le juge Pierre Truche et l’historien Pierre Nora. Il demande à chacun de répondre a la question posée par le sujet du baccalauréat. » Dans le cadre d’une émission télévisée populaire, l’expression fait alors l’objet d’un consensus par les discours d’autorités réunis : le journaliste avec Jean-Marie Cavada, l’historien par la voix de Pierre Nora, le philosophe par celle de Paul Ricoeur, et le juge avec Pierre Truche, légitiment l’existence d’une telle formule en lui donnant un sens propre à chacun« .
Les usages multiples de la formule « Devoir de mémoire »
« Devoir de mémoire » devient le nom de pratiques commémoratives. Le terme continue à être employé pour dénommer des pratiques commémoratives relatives à la Shoah, inscrit désormais dans l’agenda officiel de l’Etat français. « Devoir de mémoire » devient le nom d’une éducation citoyenne. La transmission du génocide des Juifs aux élèves de l’école de la République est perçu comme une priorité par différents acteurs de l’Education nationale.
« Devoir de mémoire » devient le cadre référentiel de l’acte de témoigner de l’expérience de l’holocauste. Au cours des trois procès pour crime contre l’humanité qui ont eu lieu en France (Barbie, Touvier, Papon), le témoin n’est pas forcément un témoin historique au sens de témoin oculaire. Sa caractéristique est qu’il apparaît à la fois comme un témoin juridique qui dépose, en tant que partie civile une parole, à charge devant le tribunal, pour obtenir réparation des préjudices publics pour lui de sa famille, et comme un témoin social porteur d’une expérience historique à partager et à transmettre à l’ensemble de la population. En dehors des témoins des procès pour crimes contre l’humanité la formule « devoir de mémoire » est également mobilisée pour évoquer la littérature testimoniale consacrée à l’expérience génocidaire. « Devoir de mémoire » devient le nom d’une politique de réparation, qu’il s’agisse de la réparation judiciaire, de la réparation financière ou des déclarations de repentance.
« Devoir de mémoire » devient le nom de la conversion de l’Etat français à un nouveau régime mémoriel. Jacques Chirac, par son discours du 20 juin 1986 quand il inaugure la » place des martyrs du Vélodrome d’hiver-Grande rafle des 16 et 17 juillet 1942″, et par celui du 16 juillet 1995 au cours duquel la France reconnaît enfin sa responsabilité, propose aux Français un nouveau récit national de réconciliation. La dette de l’Etat français à l’égard du groupe historique des résistants est remplacée par une dette à l’égard de deux nouveaux groupes : la communauté juive pour la collaboration active de Vichy dans l’extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et l’ensemble des Justes, qui ont en aidant les Juifs et en en souvent les 3/4, limité cette politique d’extermination.
« Devoir de mémoire » devient un outil de mobilisation pour les autres mémoires
Critiques du « devoir de mémoire » et naissance de la formule « travail de mémoire »
En 1996, Antoine Prost, spécialiste de l’histoire de l’éducation et de la Première Guerre mondiale, fait paraître ses Douze leçons sur l’histoire, qui proviennent de ses cours adressés aux étudiants en histoire de premier cycle à l’université Paris 1. En conclusion de ces leçons, l’auteur se livre à une critique du « devoir de mémoire » et plaide pour un « devoir d’histoire » dans la dernière phrase de son ouvrage : » Rappeler un événement ne sert à rien, même pas éviter qu’ils ne se reproduise, si on ne l’explique pas (…) Si nous voulons être les acteurs responsables de notre propre avenir, nous avons d’abord un devoir d’histoire« . Plusieurs historiens se positionnent alors pour le « devoir d’histoire » et contre le « devoir de mémoire » ce qui entraîne des processus de victimisation préjudiciables à la compréhension du passé et source d’instrumentalisations multiples. Un autre front de contestation s’ouvre du côté des chercheurs en éducation. Le « devoir de mémoire » est l’objet de critiques qui concernent la transmission scolaire du génocide des Juifs.
Des indicateurs quantitatifs (nombre des occurrences de l’expression dans les quotidiens nationaux, les questions parlementaires, les dépêches AFP, les émissions de télévision) et des indicateurs qualitatifs (étude du vocabulaire des prescriptions officielles du ministère de l’Education nationale) montrent une diminution de l’emploi de la formule qui suscite une réelle défiance dans les milieux scientifiques et institutionnels. Mais parallèlement et paradoxalement, la formule se propage et » ses usages échappent à toute tentative normative« . La formule est omniprésente dans les journaux de la presse régionale ; elle sert de nom à de très nombreuses associations, elle se diffuse sur Internet et dans les réseaux sociaux. La formule est véritablement mise à distance depuis la fin des années 2000
Les critiques envers le « devoir de mémoire » se cristallisent en 2000 autour du philosophe Paul Ricoeur. Il fait alors prévaloir une autre notion, celle de « travail de mémoire », empruntée à Freud dans le cadre de la relation analytique. Ce travail de mémoire difficile permet aux victimes de se détacher progressivement de leurs souffrances et permet conjointement à la collectivité de « briser la dette » envers elles par le pardon. On sort ainsi du « trop de mémoire » pour réconcilier le présent avec le passé. Cette notion de « travail de mémoire » est reprise par des historiens, comme Henri Rousso ou les auteurs du rapport de la mission Mattéoli, mais également par le président Chirac.
Victimes et héros
Serge Barcellini souligne le fait que « la mémoire est une affaire d’Etat » et démontre qu’elle est une politique présidentielle. De Gaulle en 1964 refuse de commémorer le 6 juin 1944 et opte pour une double commémoration au mois d’août : celle d’août 1914 et celle d’août 1944 (débarquement de Provence), parce qu’il s’agit d’événements dont la France est au cœur. Les commémorations officielles ont toujours traditionnellement été celle des héros, « morts pour la France » (l’expression est de 1915).
Une inflexion s’est produite du héros à la victime quand il s’est agi de commémorer les morts en déportation et tous les morts de la Shoah, simultanément au succès de la formule de « devoir de mémoire ». Puis la victime a remplacé le héros dans tout le champ des commémorations à mesure que changeait la perception du sens des conflits : de héros combattant pour la patrie, le Poilu est devenu la victime d’une boucherie. Dans le rapport Stora, la formule « Mort pour la France » n’est citée qu’une seule fois.
Le tournant est international. Serge Barcellini montre que l’ONU et particulièrement l’UNESCO sont des acteurs de la mémoire de la Shoah, de la colonisation, de l’esclavage. Il montre que la France « fait courir deux mémoires côte à côte », la mémoire héroïque et la mémoire victimaire, alors que dans beaucoup de pays les politiques mémorielles restent centrées sur les héros, c’est le cas en Chine, en Russie, en Pologne ; on peut même alors parler de « nationalisme mémoriel ».
Il émet l’hypothèse que l’héroïsation des OPEX, militaires morts dans des opérations extérieures au territoire national, soit une « tentative de correction vers une mémoire héroïque ». Il souligne enfin la contradiction absolue et la perte de repères que constitue l’expression « victime de son héroïsme », utilisée pour qualifier la mort du colonel Beltrame, mort en service le 24 mars 2018 à Carcassonne.
Joël Drogland