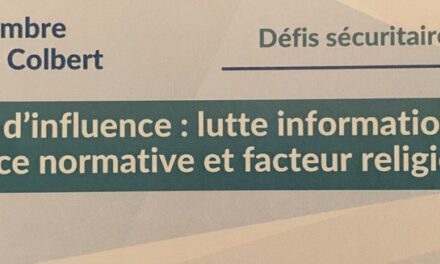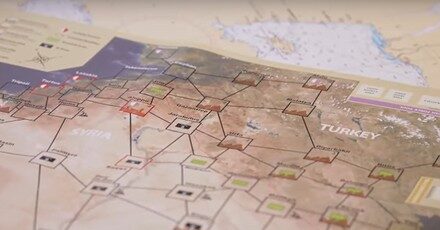Sous l’égide protectrice de Neptune, le Palais éponyme de Toulon a une nouvelle fois accueilli, les 8 et 9 octobre 2025, les Rencontres Stratégiques de la Méditerranée. Pour cette quatrième édition, alors que l’été indien méditerranéen baignait la rade varoise, plus de trois mille participants se sont retrouvés pour deux journées intenses de réflexion stratégique. Deux journées qui, au-delà du simple exercice intellectuel, ont cristallisé une conviction profonde : nous sommes au Kairos. Cette conviction, j’ai pu la partager en compagnie de mon ami Jean-Michel Crosnier, avec Pascal Ausseur, alors que le public commençait à se presser devant les portes en attente de leur ouverture. Kairos.
Au Kairos : bilan des Rencontres Stratégiques de la Méditerranée 2025
Le temps de l’action nécessaire

Nous y sommes. Nous avons basculé dans un nouveau monde. Ce n’est plus une intuition, celles des premières rencontres stratégiques de la Méditerranée. Ce n’est plus une crainte diffuse exprimée avec force lors des éditions précédentes. C’est notre réalité quotidienne. Comme l’aurait dit Hobbes, cité à de nombreuses reprises, observant l’état de nature qui se réinstalle entre les nations, nous vivons ce moment où « l’homme est un loup pour l’homme » à l’échelle géopolitique. Les alliances traditionnelles vacillent, les certitudes s’effondrent, les règles du jeu international sont contestées par ceux-là mêmes qui les ont établies.
Pascal Ausseur, directeur général de la FMES, l’a martelé avec force dès la séquence d’ouverture : nous traversons une période de rupture historique dont la profondeur est comparable aux grands basculements du XXe siècle. La rareté – des ressources, de la confiance, de la stabilité – devient le facteur explicatif central de nos crises multiples. Et dans ce contexte, le message était limpide : « Du concept à la réalisation : il est temps de faire, le temps du risque. »
C’est précisément cette urgence temporelle qui a donné aux RSMED 2025 leur tonalité si particulière. « Nous sommes encore dans la période où nous pouvons agir, » a rappelé Pascal Ausseur, « mais c’est le moment ou jamais. » Le Kairos, donc. Le moment qu’il faut saisir avant qu’il ne soit trop tard.
Vouloir, Savoir, Pouvoir : la trilogie de la puissance
Si un moment devait résumer l’intensité de ces deux journées, ce fut sans conteste l’intervention magistrale des trois chefs d’état-major des armées françaises, clôturant la première journée, puis la reprise du jeudi matin. Voir réunis l’amiral Nicolas Vaujour (Marine nationale), le général d’armée Pierre Schill (Armée de Terre) et le général d’armée aérienne Jérôme Bellanger (Armée de l’Air et de l’Espace) constitue déjà un événement rare. Les entendre partager une vision commune des nouvelles conflictualités dans un environnement contesté a été un privilège.
Le général Schill a posé le cadre avec une formule d’une clarté implacable : « Vouloir, savoir et pouvoir. » Trois mots qui résument l’équation stratégique à laquelle la France et ses partenaires sont confrontés.
Vouloir, d’abord. « Les armées gagnent les batailles, ce sont les nations qui gagnent les guerres, » a-t-il rappelé. Dans cette phrase simple se cache une vérité dérangeante pour nos démocraties : la supériorité technologique ou tactique ne suffit pas. Il faut la volonté politique, la résilience de la nation tout entière, l’adhésion du corps social à un projet de défense collective. Sans cette volonté, les armées les mieux équipées ne sont que des colosses aux pieds d’argile.
Savoir, ensuite. Le rôle du C2 – commandement et contrôle – s’allie à la capacité du chef de décider dans le brouillard de la guerre. À l’heure où l’information surabonde et où la désinformation prolifère, savoir discerner le signal du bruit devient un avantage stratégique décisif. L’intelligence artificielle peut traiter des flux de données que l’humain seul ne peut plus gérer, mais c’est bien le chef qui doit trancher, assumer, décider.
Pouvoir, enfin. Clarifier le champ de bataille, être prêt pour l’attaque. Cette phrase résonne différemment à l’heure où les frontières entre paix et guerre se brouillent, où la conflictualité devient permanente mais de basse intensité, jusqu’au moment où elle explose en haute intensité. Pouvoir, c’est avoir les moyens de ses ambitions, c’est disposer de la létalité au premier coup dont parlait l’amiral Vaujour.
Car l’amiral Vaujour, chef d’état-major de la Marine, a insisté sur ce point crucial : face à la hausse du niveau de violence, le rôle de la dissuasion est plus que jamais fondamental. Et cette dissuasion ne repose plus seulement sur le nucléaire. C’est bien la létalité au premier coup et la supériorité informationnelle qui seront les principaux différenciants des conflits à venir. Qui frappe en premier avec précision et qui maîtrise l’information du champ de bataille a déjà gagné la moitié de la bataille.
Le général Bellanger, chef d’état-major de l’Armée de l’Air et de l’Espace, a quant à lui souligné l’importance de l’entraînement à la très haute intensité et le rôle crucial des innovations dans les architectures de systèmes d’armes. Des architectures ouvertes, intégrant l’évolution logicielle, capables de s’adapter en temps réel à un environnement contesté. La guerre de demain ne se gagnera pas avec les systèmes fermés et rigides d’hier.
Et puis, le lendemain matin, il y eut cette intervention attendue de l’amiral Pierre Vandier, Commandant Suprême allié Transformation de l’OTAN. Avec cette image saisissante du « soldat sur le cheval de la Tech », l’amiral a résumé la percée technologique que nous vivons. La souveraineté numérique n’est plus une option, c’est une question de survie stratégique. Qui maîtrise la tech maîtrise le champ de bataille de demain. Et dans ce domaine, les Européens accusent un retard inquiétant face aux géants américains et chinois.
Ces interventions ont posé le diagnostic sans concession : nous sommes dans un moment de bascule géopolitique, sociétale et technologique majeur. Les certitudes d’hier n’existent plus. Il faut s’adapter, et pour s’adapter, comme le rappelait Pascal Ausseur, il faut réfléchir.
L’anti-réseau social : le temps long de la réflexion
C’est précisément là que réside la force des Rencontres Stratégiques de la Méditerranée. Dans un monde saturé d’information instantanée, de flux continus, de réactions épidermiques et de fausses nouvelles, les RSMED incarnent ce que Pascal Ausseur a si justement nommé « l’anti-réseau social ». Un espace où l’on prend le temps de se poser, d’écouter, de réfléchir. Je n’ai pas écrit tout de suite, frénétiquement, pour partager ces moments sur les réseaux sociaux. J’ai pris le temps d’en profiter lorsque j’y étais, puis celui de la réflexion avant de proposer ces quelques lignes. Alors oui, j’ai sans doute perdu quelques likes en cours. Et alors ?
Deux jours. Soixante-dix experts venus de dix-huit pays. Quinze tables rondes. Quatre interventions majeures. Trois mille participants – étudiants, militaires, diplomates, industriels, journalistes, universitaires. Un temps long pour croiser les regards, confronter les analyses, débattre sans s’invectiver. « Parler des choses qui fâchent, sans se fâcher, » pour reprendre la formule devenue la signature des RSMED.
Les thématiques abordées couvraient l’ensemble du spectre stratégique contemporain : la nouvelle donne au Levant après l’effondrement de l’axe de la résistance, la désinformation comme arme de guerre en Ukraine, au Moyen-Orient et en Afrique, les rivalités entre grandes puissances (Chine, États-Unis, Russie, Union européenne), la sécurité du commerce maritime mondial face à une conflictualité croissante, le réarmement intellectuel et la résilience de la jeunesse française, l’Europe sous pression cherchant à organiser une défense crédible, les guerres hybrides entre influence et subversion, l’espace comme nouveau terrain d’affrontement, les frappes dans la profondeur comme nouvelle frontière de la guerre technologique…
Une diversité étourdissante qui aurait pu donner le vertige, mais que l’excellence des intervenants et la qualité de la modération ont transformé en un kaléidoscope cohérent du monde tel qu’il va. Ou plutôt, tel qu’il bascule.
Car l’originalité des RSMED réside dans cette volonté obstinée de croiser les regards – opérationnel, académique, technologique. Les militaires parlent aux chercheurs, les diplomates écoutent les industriels, les étudiants interpellent les décideurs. Cette polyphonie organisée, ce refus du silo disciplinaire ou institutionnel, c’est précisément ce qui manque cruellement dans le débat public français, souvent enfermé dans des chapelles qui ne se parlent plus.
Ici, au Palais Neptune, on prend le temps. Le temps de l’argumentation, le temps du doute, le temps de la nuance. L’anti-réseau social, donc. À l’opposé de ce temps court de l’émotion, de la réaction immédiate, du jugement définitif qui caractérise nos espaces numériques. Comme aurait pu le dire Svietchine, le grand théoricien militaire soviétique, dans les périodes de rupture stratégique, seuls ceux qui prennent le temps de comprendre avant d’agir ont une chance de s’adapter.
Sans une réelle prise de conscience généralisée alimentée par une réflexion réelle, dépassant le temps du tweet, nous risquons gros. Attendant sereinement derrière ce que nous pensons être des boucliers – ici le nucléaire, là nos alliés otaniens –, nous pourrions voir la cohérence même de notre nation réduite à sa portion congrue. Et, partant, sombrer dans l’effondrement global. Car telle est la leçon de Svietchine, qui n’est pas cité ici de façon cosmétique.
Refuser de subir : le manifeste des Clionautes
C’est dans ce contexte que je veux, que nous voulons, affirmer avec force l’engagement renouvelé et renforcé des Clionautes aux côtés de la FMES et des RSMED.
Nous sommes au Kairos. Nous l’avons compris. Et dans ce moment hobbsien où l’état de nature revient entre les nations, où la loi du plus fort redevient la norme, où les alliances se défont et se refont au gré des intérêts, nous refusons catégoriquement de subir.
Je ne veux pas subir. Nous ne voulons pas subir. Dans ce monde qui bascule, nous désirons apporter notre pierre, ouvrir les champs de réflexion, participer à l’armement intellectuel de toutes les bonnes volontés, à commencer par les élèves et les étudiants.
Quelle est notre force ? Quelle est notre valeur ajoutée dans un écosystème déjà riche en experts militaires, en chercheurs reconnus, en diplomates aguerris ? Notre force réside précisément dans notre différence : nous sommes des passeurs, des vulgarisateurs, des éducateurs. Nous apportons un regard différent, complémentaire de celui des militaires et des spécialistes. Est-il de qualité ? Les articles sont là pour être lus, appréciés ou non. Nous offrons des ressources, libre à chacun de s’en emparer, de juger de leur pertinence, de leur valeur.
Nous refusons le silo. Nous sommes cette courroie de transmission entre le think tank et les élèves, les étudiants, les citoyens. La FMES produit de l’analyse stratégique de haute volée, nous la diffusons, nous l’adaptons, nous la rendons accessible et exploitable pédagogiquement. Nous ne sommes pas des experts, nous sommes des médiateurs de l’expertise. Et dans un monde où la complexité ne cesse de croître, ce rôle de médiation devient crucial.
Notre mission est claire : armer intellectuellement la jeunesse face au monde qui vient. Pas seulement l’informer – l’information surabonde déjà –, mais la former à penser stratégiquement, à décrypter les enjeux géopolitiques, à développer son esprit critique face aux narratifs concurrents, à comprendre que le monde n’est ni simple ni manichéen.
Je ne veux pas attendre de solution miracle au monde qui arrive. Cette posture passive, cette attente que d’autres – les États, les experts, les institutions internationales, nos politiques cherchant un premier ministre capable de tenir plus d’une semaine – trouvent des réponses, je la refuse. Nous la refusons. Nous voulons participer à la réflexion, participer à la construction des réponses. Et notre terrain d’action, c’est la classe, ce sont les jeunes esprits que nous contribuons à former.
Pour nourrir cette ambition, nous avons besoin de références intellectuelles solides. Hobbes, pour comprendre cet état de nature géopolitique qui se réinstalle. Svietchine, pour penser l’adaptation stratégique dans les périodes de rupture. Lawrence d’Arabie, qui nous rappelle que dans l’incertitude absolue, il faut quand même agir, décider, prendre le risque de l’erreur plutôt que celui de l’immobilisme. Simone Weil, la philosophe de l’enracinement et de la responsabilité intellectuelle, qui nous enseigne que penser est déjà un acte de résistance. Et pourquoi pas Isaac Asimov et sa Fondation, cette œuvre magistrale qui pose la question centrale : peut-on prévoir l’avenir pour mieux le façonner ? La psychohistoire d’Asimov nous rappelle l’importance de semer aujourd’hui les graines intellectuelles qui germeront demain. Oui, la Pop Culture peut aussi être une porte, un levier pour toucher ceux que les références classiques rebutent. Les deux peuvent d’ailleurs se marier pour peu que l’on tente de sortir de nos carcans intellectuels.
Ces références ne sont pas des ornements. Elles sont des outils pour penser le monde qui vient, pour donner à nos élèves les clés de compréhension d’une époque où les repères vacillent.
Des moments marquants
Permettez-moi de revenir sur quatre moments représentatifs de ces RSMED 2025.
Le premier, je l’ai déjà évoqué longuement : l’intervention magistrale des trois chefs d’état-major. Voir ces trois hommes, représentant les trois dimensions de la puissance militaire française – terre, mer, air et espace –, partager une vision commune tout en respectant la spécificité de leur milieu, fut un moment rare et précieux. Leur message d’urgence, leur appel à l’action, leur refus du fatalisme ont résonné puissamment dans l’amphithéâtre Trucy. Les armées sont prêtes, mais les nations le sont-elles ? Voulons-nous vraiment défendre ce que nous sommes ?
Le second fut la table ronde « Décrypter les États-Unis : identités, récits et intérêts ». Avec Amy Greene, Cole Stangler, Marco Mario Sioli et Marie-Caroline Debray, cette table ronde fut tout simplement lumineuse. Par la qualité des intervenants, par la profondeur des analyses, par ce qu’elle nous a révélé.
Car comprendre le « logiciel Trump II » n’est pas un exercice académique. C’est une nécessité stratégique vitale pour l’Europe. Les États-Unis, notre allié historique, notre protecteur depuis 1945, semblent avoir rejoint le camp des révisionnistes. L’administration Trump brutalise ses partenaires, engage des guerres commerciales, remet en cause les alliances, pratique un protectionnisme agressif. Mais la question posée par les intervenants était encore plus dérangeante : cette rupture est-elle Trump ou est-elle structurelle ?
Est-ce la personnalité imprévisible d’un homme, ou est-ce l’évolution sociologique profonde d’une nation américaine fatiguée de porter le fardeau de l’empire, tentée par le repli, traversée par des fractures internes qui la rendent moins fiable comme garant de la sécurité européenne ? Cette question n’a pas trouvé de réponse définitive lors de la table ronde, mais elle a été posée avec une acuité remarquable. Et pour nous, Européens, elle est existentielle. Si l’Amérique nous abandonne – et les signes se multiplient –, sommes-nous prêts à assurer seuls notre destin ? Marie-Caroline Debray a fait vivre cette très belle table ronde et les intervenants nous ont éclairé de leurs connaissances fines sur le sujet. Un plaisir total.
Le troisième moment que je désire mettre en avant fut la table ronde « L’espace, terrain d’affrontement : défis stratégiques et innovations technologiques ». Passionnante. Absolument passionnante. Avec Guilhem Penent, le colonel Fabrice Castrigno, Hugo Richard, Christophe Debaert et Xavier Pasco, nous avons plongé dans cette nouvelle frontière de la conflictualité.
L’espace n’est plus un bien commun paisible où les nations coopèrent pour le progrès de l’humanité. L’espace est devenu un terrain de compétition féroce, de militarisation croissante, de rivalités exacerbées. Le chiffre donné par les intervenants donne le vertige : Elon Musk, avec SpaceX et Starlink, a envoyé en une seule année plus de satellites en orbite que l’ensemble des États ne l’avaient fait en vingt ans !
Un homme, un milliardaire privé, dispose désormais d’une infrastructure spatiale qui dépasse celle de la plupart des nations. Quand la Russie a coupé l’internet en Ukraine, c’est Starlink qui a permis aux Ukrainiens de maintenir leurs communications. Quand des régions isolées ont besoin de connectivité, c’est vers Musk qu’on se tourne. Cette privatisation de l’espace pose des questions vertigineuses de souveraineté, de gouvernance, de dépendance.
Et la militarisation suit. Satellites espions, armes antisatellites, projets de stations lunaires à vocation duale, course vers Mars… La « guerre du ciel » a bel et bien commencé, comme l’ont souligné les intervenants questionnés avec brio par Xavier Pasco. Qui contrôlera l’espace contrôlera les flux d’information, la navigation GPS, les communications stratégiques. L’espace est devenu un domaine aussi crucial que la terre, la mer ou l’air. Alors oui parfois c’est technique. Mais les élèves de terminale qui étaient là ont pu prendre la mesure des approfondissements possibles de leurs cours de terminale et toucher du doigt les études supérieures. Et c’est exactement ce que je voulais transmettre ici.
Un moment crucial : « Réarmement intellectuel et résilience »
Mais il y eut un autre moment, absolument crucial pour nous, Clionautes, et qui mérite qu’on s’y attarde : la table ronde « Réarmement intellectuel et résilience : préparer la jeunesse française aux défis de demain », animée en salle Raimu le mercredi après-midi.
Avec Youssef Halaoua (directeur du campus Méditerranée Moyen-Orient de Sciences Po Menton), Sarah M’Roivili (étudiante et responsable du Comité Afrique des Jeunes IHEDN), Claire Daudé (étudiante à Sciences Po Menton), Muriel Domenach (diplomate, ancienne ambassadrice à l’OTAN, aujourd’hui à la Cour des comptes) et Gildas Leprince, alias Mister Geopolitix, cette table ronde a mis en lumière un enjeu que nous, enseignants, connaissons bien mais qui est rarement abordé avec autant de lucidité dans un cadre stratégique de haut niveau.
La jeunesse est devenue une cible : désinformation, campagnes d’influence étrangères, cyberattaques, manipulations informationnelles s’acharnent sur elle. Cette génération, hyperconnectée, confrontée à une série de crises – sanitaire, environnementale, sociétale, économique – doit affronter tous ces défis sans toujours disposer des outils intellectuels pour les décrypter.
Et c’est là que Gildas Leprince a pu nous donner des pistes de réflexion précieuse. Derrière le pseudonyme Mister Geopolitix, cet ancien étudiant devenu vulgarisateur sur les réseaux sociaux (YouTube, Instagram, TikTok) ambitionne depuis neuf ans de « faire découvrir et comprendre le monde » à une génération qui consomme l’information autrement que nous. Il a démontré avec une clarté remarquable que la bataille de l’information se gagne d’abord là où se trouve la jeunesse : sur les plateformes numériques. Son RETEX sur le fonctionnement des réseaux sociaux, sur la course au clic, aux likes, au détriment du temps nécessaire pour produire de la qualité, est irremplaçable.
Mais – et c’est tout l’enjeu de son propos – il ne suffit pas d’être présent sur ces plateformes. Encore faut-il armer intellectuellement les jeunes pour qu’ils ne soient pas de simples consommateurs passifs d’un flux d’informations contradictoires, mais des citoyens capables d’exercer leur esprit critique, de déconstruire les narratifs, de distinguer le vrai du faux, le signal du bruit.
Muriel Domenach, forte de son expérience à l’OTAN et maintenant engagée auprès des jeunes avec l’initiative #ParlonsStratégie de Fraternité générale, a insisté sur un point fondamental : dans un monde aussi incertain, la stabilité de la nation passe avant tout par la capacité de résilience des jeunes générations. Une nation dont la jeunesse est désorientée, manipulée, incapable de penser stratégiquement, est une nation vulnérable.
Sarah M’Roivili et Claire Daudé, en tant qu’étudiantes directement concernées, ont apporté un témoignage précieux sur ce qu’elles attendent : non pas des certitudes toutes faites, non pas des discours moralisateurs, mais des outils pour comprendre la complexité. Elles veulent qu’on leur fasse confiance, qu’on les considère comme des acteurs de la réflexion stratégique, pas comme des réceptacles passifs. Elles ont partagé des visions qui leur sont propres, des questionnements qu’il faut savoir écouter.
Youssef Halaoua, depuis son campus de Sciences Po Menton spécialisé sur le Moyen-Orient, a rappelé l’importance de l’enracinement académique de cette formation à la pensée stratégique. Les campus, les universités, les lycées doivent devenir des espaces de réflexion et de débat, pas seulement de transmission de savoirs.
Cette table ronde résonnait puissamment avec notre engagement de Clionautes. Car c’est exactement ce que nous essayons de faire, chaque jour, dans nos classes : réarmer intellectuellement nos élèves, développer leur résilience face aux manipulations, cultiver leur esprit critique, leur donner les clés de compréhension d’un monde complexe.
La bataille culturelle et informationnelle est déjà engagée. Des puissances étrangères investissent massivement les réseaux sociaux pour influencer, déstabiliser, diviser nos jeunesses. Si nous, éducateurs, vulgarisateurs, institutions, ne prenons pas cette bataille au sérieux, nous laisserons le champ libre à ceux qui veulent affaiblir nos démocraties de l’intérieur.
Le réarmement intellectuel n’est pas un slogan. C’est une nécessité stratégique. Et les RSMED, en donnant une place centrale à cette table ronde, ont montré qu’elles avaient parfaitement compris cet enjeu.
Le succès renouvelé du parcours lycéen

Comme lors de l’édition 2024, des centaines de lycéens de Première et Terminale spécialité HGGSP ont participé à un parcours spécifique, alternant tables rondes et activités pédagogiques interactives. Ils ont répondu à des questions, analysé des documents, échangé avec leurs enseignants et entre eux. À l’issue, ils recevront une attestation valorisable sur Parcoursup.
Cette initiative est lumineuse à double titre. D’abord parce qu’elle ouvre la réflexion stratégique à la jeunesse, qu’elle casse cette image élitiste du think tank inaccessible. La géopolitique n’est pas réservée à une élite d’experts, elle concerne tous les citoyens. Et former des citoyens éclairés commence à l’école.
Ensuite parce qu’elle donne du sens à l’engagement. Ces lycéens ne sont pas venus par obligation, ils sont venus par curiosité, par soif de comprendre le monde qui les attend. J’ai pu échanger avec plusieurs d’entre eux. Leur enthousiasme, leurs questions pertinentes, leur capacité à saisir la complexité des enjeux m’ont profondément touché et convaincu que nous avions raison de nous engager dans cette voie. Merci à la FMES pour sa confiance dans ce projet, à Thomas Delage pour son accompagnement, à Agathe Delorme pour l’organisation sans faille.
Pascal Ausseur a souvent rappelé sa fierté de pouvoir ouvrir cet événement aux jeunes. C’est une fierté que nous partageons pleinement, nous, Clionautes. Et c’est pourquoi nous renforcerons encore notre implication dans cette dimension pédagogique en 2026.
L’engagement renforcé : ce que nous ferons en 2026
Alors, concrètement, que ferons-nous pour renforcer notre engagement auprès de la FMES et des RSMED ?
Nous continuerons bien sûr ce que nous faisons déjà : les comptes-rendus détaillés de chaque table ronde, l’exploitation pédagogique pour les cours de spécialité HGGSP, le partenariat avec le magazine Diplomatie, la diffusion des vidéos et des analyses. Ce travail de fond, patient, méthodique, qui permet à nos collègues enseignants de disposer de ressources de qualité pour leurs cours. Le premier compte-rendu arrivera bientôt.
Mais nous voulons aller plus loin. Beaucoup plus loin.
Nous voulons renforcer notre rôle de courroie de transmission entre le monde de la recherche stratégique et le monde éducatif. Cela signifie multiplier les formats, innover dans les approches pédagogiques, ne pas nous contenter de transmettre passivement mais créer les conditions d’un apprentissage actif.
Nous voulons développer l’armement intellectuel de nos élèves. Pas seulement les informer, mais les former à penser stratégiquement. Cela passe par la création d’outils pédagogiques innovants : ateliers de simulation géopolitique, jeux de rôle diplomatiques, études de cas stratégiques, analyses de conflits en temps réel. Nous voulons que nos élèves ne soient pas de simples consommateurs d’information, mais des producteurs d’analyse. Nous avons pu l’explorer lors de la Fabrique de la Diplomatie, ces pistes sont riches et prometteuses.
Nous voulons participer encore plus activement à la réflexion collective nationale. Les Clionautes ne doivent pas être un simple relais, mais un acteur à part entière du débat stratégique français. Notre regard d’enseignants, notre connaissance du terrain éducatif, notre compréhension des attentes et des besoins de la jeunesse, c’est une expertise que nous devons faire valoir.
Concrètement, en 2026, diverses réflexions se faire jour :
- Poursuite de notre accompagnement pour le parcours lycéen des RSMED 2026
- L’organisation d’ateliers, de vidéos, de conférences pour les enseignants en amont des RSMED
- La mise en place de relais dans toute la France, en se basant sur les Clionautes de tous horizons, pour diffuser encore plus largement cet événement sous toutes ses formes
- Jeu sérieux, vidéos, articles : explorer pour transmettre, oser, tenter, même s’il faut échouer
Ces propositions ne sont pas des vœux pieux. Elles sont l’expression d’une volonté farouche de ne pas laisser passer le Kairos. Nous sommes au moment où nous pouvons encore agir, où nous pouvons encore former une génération capable de penser stratégiquement le monde complexe qui l’attend.
Conclusion : au Kairos, saisir le moment
Les 7 et 8 octobre 2026, la cinquième édition des Rencontres Stratégiques de la Méditerranée se tiendra au Palais Neptune. L’amiral Nicolas Vaujour a lancé un défi lors de cette édition 2025 : « On peut toujours faire mieux. » Pascal Ausseur et toute l’équipe de la FMES ont relevé ce défi.
Nous, Clionautes, serons là. Plus engagés encore qu’en 2025. Plus déterminés encore à jouer pleinement notre rôle de passeurs, de médiateurs, d’éveilleurs de conscience stratégique.
Car, pour reprendre les mots de Simone Weil, philosophe de l’enracinement et de la responsabilité, « penser, c’est déjà agir ». Et dans le feu du Kairos, celui qui pense sans agir a déjà laissé passer le moment. Dans un monde où la pensée stratégique devient une denrée rare, où l’immédiateté efface la réflexion, où le bruit couvre le signal, penser est déjà un acte de résistance.
Pascal Ausseur l’a dit avec force : « Pour s’adapter, il faut réfléchir. » Ajoutons : pour réfléchir, il faut du temps, de l’espace, de la qualité. C’est précisément ce que nous offrent les RSMED. C’est précisément ce que nous, Clionautes, voulons prolonger, amplifier, démultiplier dans nos classes, auprès de nos élèves.
Dans ce monde hobbsien où l’état de nature revient, où la force redevient le langage dominant des relations internationales, nous refusons le fatalisme. Nous refusons l’impuissance. Nous choisissons l’engagement. Nous choisissons de participer, à notre échelle, avec nos moyens, à l’armement intellectuel de la génération qui devra affronter les tempêtes à venir.
Car si les armées gagnent les batailles, ce sont bien les nations qui gagnent les guerres. Et les nations ne gagnent que si leurs citoyens comprennent les enjeux, adhèrent au projet collectif, refusent de subir.
Nous sommes au Kairos. Saisissons-le.
À bientôt, pour les RSMED 2026. En attendant, les vidéos des tables rondes seront disponibles sur la chaîne YouTube de la FMES. Les Clionautes proposeront, comme chaque année, des comptes-rendus détaillés et des exploitations pédagogiques. Parce que la réflexion stratégique ne s’arrête pas aux portes du Palais Neptune. Elle continue, jour après jour, dans nos classes, avec nos élèves. C’est notre manière à nous de refuser de subir.