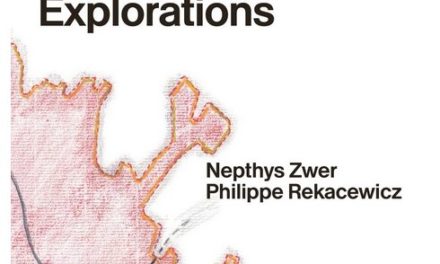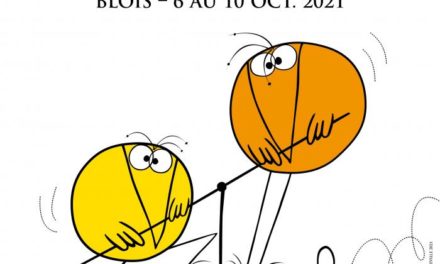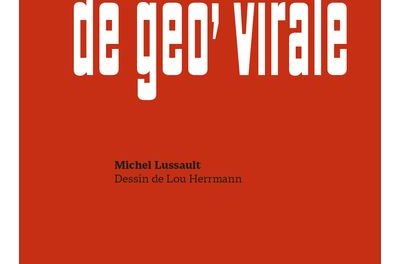Michel Foucher a voyagé dans plus de cent pays, chercheur, cartographe, diplomate, témoin des grands mouvements du monde, il n’a cessé de rendre compte et d’analyser le monde et ses enjeux. Thibaut Sardier, journaliste et président de l’ADFIG, l’interroge sur sa longue et riche carrière.
Votre dernier livre, Arpenter le monde. Mémoires d’un géographe politique, a été publié en début d’année chez Robert Laffont. Or, au moment de l’écriture du livre, nous étions en plein confinement. Que se passe-t-il quand l’arpenteur ne peut plus arpenter ?
J’ai mon âge (75 ans) donc arpenter moins était déjà une réalité. Mais c’est vrai que brutalement, les activités, les rapports sociaux et familiaux se sont quasiment arrêtés. J’ai dû annuler brutalement mon voyage au Cambodge, par crainte de rester bloqué à l’aéroport et dans les procédures d’isolement. J’avais déjà alors l’idée d’écrire mes mémoires de rassembler des matériaux, d’établir une chronologie. Certains souvenirs avaient réémergé d’ailleurs, le premier voyage scolaire au Maroc, la maîtrise au Brésil, etc.
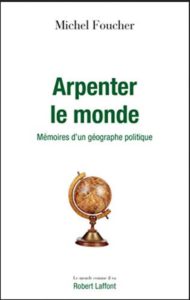
J’ai rapidement mené de front des activités d’enseignement et de recherche, avant même ma thèse soutenue en 1986 à la Sorbonne (Fronts et frontières des États du Tiers Monde). Et j’étais bien plus connaisseur de l’Amérique du Sud que de l’Europe qui occupa pourtant une bonne partie de la suite de ma carrière.
J’ai rejoint l’équipe diplomatique d’Hubert Védrine, sous le mandat de François Mitterrand. L’Europe connaissait alors d’intenses transformations auxquelles, il faut le reconnaître, la France n’était pas prête. J’ai ainsi été amené à rencontrer rapidement une série de responsables politiques divers, de Vaclav Havel à Lech Walesa, tout en restant en parallèle un chercheur.
Michel Foucher, d’où vient ce goût du voyage ?
Je me suis moi-même posé la question. J’étais un enfant de la frontière. Je vivais à Loches, à proximité de la zone libre. J’avais lu des récits de prisonniers de guerre français en Allemagne et j’étais frappé de les sentir moins germanophobes qu’…anglophobes. Et puis en grandissant, j’ai éprouvé l’envie de m’échapper, de voyager. On a tendance à oublier qu’après-guerre, les tensions étaient très vives dans les familles, avec des règlements de compte, des querelles d’héritage souvent très dures. J’avais envie d’ailleurs. Enfin, c’était une époque sans télévision. Il n’y avait pas beaucoup d’évasion, hormis Tintin.
Vous avez grandi dans un univers très marqué à droite. Quel a été l’impact sur votre vision du monde ?

Mon père lisait le Figaro et un membre de la Jeunesse ouvrière chrétienne. Ma mère était une institutrice très pratiquante. Comme elle voulait que je poursuivre des études, j’ai été envoyé dans des institutions catholiques. Je me souviens que le recteur de l’une d’elle nous parlait d’Indochine. En bon lecteur du roman d’Arthur Koestler, Le Zéro et l’Infini, j’ai nourri une critique sévère de l’URSS et j’étais obsédé par la recherche de la vérité en tout.
Quoique sans engagement politique, je me suis pris d’intérêt pour le tiers-monde et le sous-développement. Dans un monde divisé entre l’impérialisme américain et le système stalinien, je voulais espérer en une « troisième voie ». Parmi les géographes, je faisais figure d’exception, tant mes collègues étaient fascinés par l’URSS, sa prétendue domination sur la nature, son exploitation miraculeuse du pétrole, du gaz ou du charbon, sa planification quinquennale, etc.
Puis, j’ai forcé la porte d’André Fontaine, qui revenait de Chine et dont l’éloquence m’avait profondément impressionné. Je voulais alors en savoir autant que lui sur la Chine. Il me conseilla d’apprendre le mandarin, mais comme il fallait au moins sept d’ans d’apprentissage, je suis passé à autre chose…
Je lisais avec assiduité le Monde. J’en découpais tous les articles utiles qui servaient ensuite de fondement à mes cours.
Finalement, je me suis rendu au Brésil où j’ai eu l’opportunité de rencontrer Hélder Câmara, évêque de Récife. Je me suis rendu en Amazonie puis dans le reste de l’Amérique latine. à l’époque, la région était en train de basculer dans la dictature un peu partout, en Argentine, au Chili, etc.
Le tiers-monde a-t-il servi de source d’inspiration à votre compréhension des problèmes de frontières en Europe ?
C’est vrai qu’au-delà des fronts pionniers en Amazonie, j’ai eu à cœur d’approfondir la question de ces frontières difficiles en Amérique latine ou ailleurs. J’avais observé que l’Apartheid recouvrait aussi une stratégie territoriale en Afrique du Sud, au même titre que le cas de la ligne verte dans le conflit israélo-palestinien me paraissait très important. La frontière, c’est du politique inscrit dans l’espace, avec ses origines, ses acteurs, ses implications, etc.
Vous avez collaboré avec la revue Hérodote dès sa fondation. Quelles ont été vos relations avec Y. Lacoste ?
Il a fallu attendre le 27ème numéro d’Hérodote pour qu’Yves Lacoste accepte le mot de « géopolitique ». Le mot n’avait pas bonne presse en ce temps-là. Lacoste avait pour mentor Jean Dresch, un géographe marxiste, qui partageait avec le géographe allemand Wolfgang Hartke une même répulsion pour ce mot. En effet, il y avait eu une école de géopolitique à Munich dans les années 1930 mais celle-ci s’était compromise en donnant des arguments au concept d’espace vital des nazis. Donc le mot avait été banni. La Géographie, c’était le sol, pas l’Etat.
Mes propres contributions à la revue concernaient l’échec de la guérilla de Che Guevara en Bolivie.
J’ai fini par prendre mes distances avec Hérodote parce que je n’était pas d’accord avec son évolution. J’aurais souhaité qu’elle devienne un vrai centre de recherche.
Quand Hubert Védrine vous fait venir en vous disant, « vous vous avez les cartes dans la tête », comment s’est déroulée votre intégration dans le gouvernement ?
Même si tout le monde manifestait une grande courtoisie, nous appartenions à des cultures professionnelles très différentes. Quand les diplomates du Quai d’Orsay m’appelaient « Monsieur le Professeur », ce n’était pas forcément très facile d’espérer après une réelle intégration.
Les dossiers étaient aussi nombreux que brûlants : le processus de paix dans le conflit israélo-palestinien, l’Afghanistan, l’élargissement en Europe, les Balkans, etc. Les échanges avec nos interlocuteurs n’étaient pas simples. Par exemple Yasser Arafat avait de mauvaises connaissances géographiques. Dans les négociations, les Israéliens donnaient des cartes fausses et Yasser Arafat se perdait dans une vision du monde palestinien idéal. Même si la France ne prétendait pas être une grande puissance, il fallait être capable d’être une puissance de médiation et d’équilibre.
Pour les Balkans, j’avais proposé à Hubert Védrine de monter une conférence avec les Serbes et les Albanais du Kosovo. On se préparait à une autonomie substantielle plutôt qu’à l’indépendance. Notre projet a échoué car nous ignorions que les Américains projetaient d’installer une base militaire dans la région. Ce fut jugé intolérable. Il faut savoir qu’au Kosovo, il y a une majorité albanaise certes, mais la région compte une dizaine de monastères serbes majeurs.
Dans d’autres occasions, nous étions prisonniers d’intérêts contradictoires. Dans le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, nos intérêts économiques étaient auprès de l’Azerbaïdjan mais nous avions aussi des liens historiques avec la communauté arménienne. Au Maghreb, où nos liens étaient très resserrés, il fallait pouvoir avancer alors que parallèlement se jouait la crise palestinienne et libanaise.
Dans votre récit, on sent que vous avez toujours été entre deux mondes, celui des chercheurs et celui des décideurs. Quelle a été le prix de cette liberté ?
Le prix a été assez lourd. Aux Etats-Unis, quand il y a changement d’administration, les anciens cadres rejoignent des think tanks. On peut circuler entre la recherche et l’exercice de responsabilités. En France, c’est beaucoup plus compliqué. On appartient à un corps qui, d’une certaine façon, vous fige dans des logiques statutaires. On peut être détaché, c’est vrai, mais j’ai le sentiment en fin de carrière, que je n’ai jamais vraiment appartenu ni au monde des chercheurs, ni au monde des diplomates. J’ai eu parfois le sentiment d’être entravé. Je suis resté un prophète plutôt qu’un grand-prêtre.
Comment reste-ton prophète quand on fait autorité ?
En travaillant.