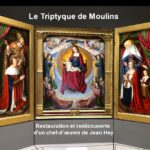Participants :
Bernard Badie Fiche disponible sur [le site du centre de recherches internationales de Sciences Po->http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/users/bertrandbadie]
Jacques Lévy Fiche disponible sur [le site de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne->http://personnes.epfl.ch/jacques.levy]
Vendredi, 17H30. Nous nous retrouvons dans la salle Gaston d’Orléans du Château de Blois pour assister à l’une des dernières conférences de la journée. Loin de nous endormir celle-ci va se révéler passionnante, portée par deux chercheurs que l’on a toujours autant plaisir à écouter.

Bertrand Badie distingue deux tentations impériales dans l’histoire française, aux géographies distinctes :
1, Une tentation impériale européenne, puisant ses racines dans le passé carolingien, et réactivée régulièrement dans l’histoire plus ou moins récente.
2, Une tentation du grand large, dans ses avatars pré-coloniaux, coloniaux et post-coloniaux.
Pour autant, et cela fait écho aux propos tenus un peu plus tôt, la tentation impériale, et par essence universaliste, côtoie dans l’histoire française la reconnaissance de l’altérité des autres peuples : relisons pour s’en convaincre les échanges entre Jules Ferry et Georges Clemenceau sur les revendications impériales françaises au Tonkin. Ceci dévoile les deux faces de la République : la République impériale et la République nationale. Loin d’avoir disparu, ce débat est toujours d’actualité.
Médiateur : Si nous revenons à l’actualité justement, la germanophobie française fait-elle renaitre une contre-offensive néo-impériale en France ?
Bertrand Badie: Nul Etat ne peut se penser empire sans être auparavant une puissance régionale majeure. La France est traversée par la tentation impériale, et cela est visible à plusieurs égards :
1, Syndrome de la responsabilité particulière en certains lieux où se développent des degrés d’altérité, justifiant les interventions militaires et diplomatiques à travers le monde.
2, La surdimension du militaire. La France a une grande histoire militaire et sa surdimension est le fruit de son ambition impériale.
3, Le grand interventionnisme français. La France donne son opinion sur tout, et crée de très nombreux comités de contact pour régler les crises. Ce sont les automatismes de la diplomatie française, sans jamais se poser la question de l’efficacité de cette pratique, et de sa pertinence.
4, Le recours nouveau à la croisade. L’évolution de la doctrine française et de son personnel d’exécution suit la vision néo-conservatrice étasunienne : certaines valeurs, placées au dessus de tout autre idée, justifient toutes les interventions en absence d’accord. Moyennant quoi, l’on ne négocie plus (les premières négociations diplomatique menée depuis 1989 lors du nucléaire iranien se sont faites sans véritable bonne volonté française).

Ainsi empire et Etat-nation ne sont que des variantes d’une même idée : celle de la conquête de territoires et de ressources. Jacques Lévy va même plus loin : tout Etat, fonctionnant par accumulation et extension territoriale à partir d’un coeur pensant sa puissance et la projetant, est par essence impérial. A mesure de son extension, le centre doit s’assurer la fidélité des périphéries, de plus en plus éloignées et donc enclines à la rébellion. C’est dans cette dialectique que l’Etat-providence trouve ses origines, notamment en France, à l’image des larges redistributions fiscales que l’Etat opère entre les régions motrices et les espaces délaissés ou en marges. C’est aussi pourquoi, de nos jours, les plus grands défenseurs de ce modèle soient aussi souverainistes.
Bertrand Badie reconnait de nombreux points d’accord avec Jacques Lévy, mais marque son opposition quant au rapprochement opéré par celui-ci entre construction nationale et impérialisme. En cela Bertrand Badie réaffirme le travail de conceptualisation déjà opéré par lui à Blois Voir la conférence Les sorties d’empire menée plus tôt dans la journée. La logique d’empire est celle du rayonnement : l’on peut parler d’empire lorsqu’une construction politique opère davantage par logique de rayonnement que territorialité.
Médiateur : Y a t-il des forces politiques réveillant aujourd’hui cette tentation impériale ? Comment pouvons-nous dépasser cette idée d’empire ?
Pour Bertrand Badie toutes les formes du souverainisme réveillent les tentation. Bertrand Badie appelle à la prudence devant ces tentations et à la réflexion sur une mondialisation basée sur la reconnaissance de l’altérité, qui permet de sortir des pathologies impériales, universalistes et punitives.
Jacques Lévy marque son accord avec les propos de son voisin. La question du dépassement de la notion d’empire est celle de l’affrontement entre deux visions politiques : celle de l’idéalisme et celle du réalisme. Si le réalisme mène à la realpolitik et donc à la tentation d’empire, l’idéalisme mènera à abandonner les tentations d’empire et les velléités de domination.
Séance de questions :
Q1 : La table ronde a abordé la France impériale et sa vision dans l’histoire et non pas la France face au retour des empires. Est-ce que l’Europe n’a pas d’ambition à devenir un empire dans le monde et face aux grandes puissances impériales en place (Etats-Unis d’Amérique) ou en devenir (Chine) ?
Bertrand Badie n’est pas d’accord car l’Union Européenne est dans une logique associative et non une logique de rayonnement et de domination. Pour autant l’Union Européenne va mal, l’alternative se trouve dans la solidarité. Jacques Lévy marque son accord total avec son voisin, en rappelant que pour lui, l’impérialisme se trouve dans l’inclusion de force de sociétés, et donc l’emploi de la violence et de la coercition. L’abandon de cette vision coercitive est possible en partant de l’idéalisme.
Q2 : Quel serait pour vous le moins mauvais découpage territorial ?
Jacques Lévy croit que la région est une échelle majeure de lecture du monde et qui est, par principe, non impérial. Il faut lancer un grand débat et trouver le meilleur équilibre entre ressources objectives et ressources subjectives. Pour Bertrand Badie c’est l’exemple même de la mauvaise réforme. La surdité du pouvoir est impériale ici, celui-ci agissant par prescription et non par construction.
Une conférence de haut vol, avec des intervenants aux réflexions complexes, exigeantes mais riches d’enseignement et promptes à nourrir la réflexion personnelle et de nombreux débats ultérieures. Qu’il me soit permis d’émettre une remarque : il est dommage que la question centrale de la conférence, celle du « retour de l’empire », notamment via la réflexion autour de la nature impériale actuelle ou en devenir de l’Union Européenne, ne soit abordée que tardivement et sur un temps très court : à charge d’une nouvelle rencontre à laquelle nous assisterions avec plaisir.
Geoffrey Maréchal © Clionautes