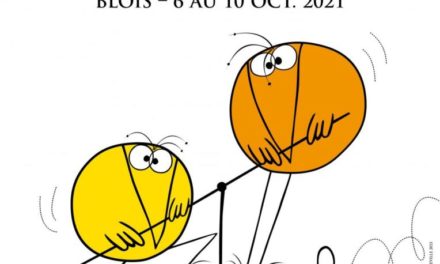Table ronde, carte blanche à la revue Entre-Temps. Modération Patrick Boucheron, professeur au Collège de France. Intervenants Romy Sanchez, chargée de recherche au CNRS, Valérie Theis, professeure des Universités à l’École normale supérieure, Bertrand Tillier, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sylvain Venayre, professeur à l’Université Grenoble-Alpes
En octobre 2020, Entre-Temps lançait la série « Nos archives » dans laquelle elle proposait à des historiennes et des historiens d’exhumer un fragment de leur propre fonds d’archives pour en faire brièvement le récit. L’objectif était de constituer un fonds d’archives collectif, qui pourrait remettre d’écrire « l’histoire que les historiennes et les historiens ont vécu et avec laquelle, consciemment ou inconsciemment, ils et elles écrivent celle des femmes et des hommes qui les ont précédés ».
« Si l’égo-histoire est désormais pratique commune, inscrite même comme un passage obligé dans la carrière, il est rare en revanche que les historiens ouvrent leurs placards, montrent ce qu’ils ont dans le fond de leur tiroir, dans la sous-chemise de la boite en haut de l’étagère. » L’examen de leurs propres archives n’est sans doute pas anodine, « elle dit peut-être à la fois quelque chose de nos manières d’écrire l’histoire mais aussi du rapport que chacun entretient avec le passé. Collectivement, ces documents mis ensemble composent enfin un corpus qui, peut-être, révèle moins un portrait de groupe qu’un autoportrait de l’historien.ne au travail aujourd’hui ».
Quatre documents sont successivement projetés et/ou lus, qui sont les documents choisis par les quatre chercheuses et chercheurs présents. Romy
Sanchez a choisi un rapport de police cubain de 1967 critiquant l’attitude politique d’un étudiant et lui interdisant de continuer ses études, auquel s’ajoutent un télégramme et une lettre de convocation. Valérie Theis a choisi le tout premier document auquel elle fut confrontée en entreprenant sa thèse d’histoire médiévale. Le choix de Bertrand Tillier s’est porté sur un cahier d’écolier sur lequel son grand père recopia des chansons militaires, au Maroc en 1919-1920 ; tandis que celui de Sylvain Venayre allait vers une médaille en bronze donnée aux combattants des guerres napoléoniennes. On constate ainsi que tous n’ont pas interprété de la même façon l’expression « nos archives » : il peut s’agir de documents les concernant personnellement dans leur travail de recherche, ou d’archives familiales.
Questionnés par Patrick Boucheron, ils vont ensuite présenter le document, justifier leur choix, puis réfléchir ensemble aux éléments communs, aux modes de narration (ils on chacun rédigé un article sur le sujet dans le numéro de la revue), au sens à donner à ces démarches personnelles.
Le père cubain exilé de Romy Sanchez
Romy Sanchez nous apprend que l’étudiant était son père, alors âgé de 23 ans, et qu’il fuit par la suite Cuba. La proposition de la revue a été pour elle l’occasion de faire ce qu’elle avait envie de faire, mais n’avait pas encore eu le courage de faire : aborder en historienne le roman familial dont cette lettre est le début. Son père obtint le statut de réfugié en 1982, 15ans après cette éviction politique. Par la suite Romy Sanchez a fait sa thèse sur les exilés cubains au XIXème siècle.
« Les analogies sont toujours évidentes pour qui les échafaude. Bien sûr j’ai terminé avec diligence la carrière universitaire interrompue de mon père. Bien sûr je suis devenue historienne. Bien sûr j’ai choisi d’étudier l’exil et le compromis politique, l’exclusion des gagnants, la réforme au lieu de la révolution. Tout cela est presque trop convenu pour être vrai. Et pourtant, ce que ces années d’étude des autres exilés m’ont appris, c’est que les raisons du départ « forcé » sont souvent bien plus complexes qu’il n’y parait, et que les « documents fondateurs », les archives-clés, cachent souvent d’autres indices plus difficiles à mettre en avant pour tenter de reconstituer le puzzle de la migration. L’histoire intime est comme les autres, elle a son histoire officielle et ses silences »
La première page de Valérie Theis
« Si cette page est si spéciale à mes yeux, c’est parce que, comme l’indique le numéro écrit à l’encre bleue Waterman, noyé dans une annotation en haut à droite, elle constitue la toute première page de « mes » sources. » « En septembre 1996, j’ai essayé pour la première fois de faire de la recherche en étudiant les comptes de construction du palais du pape Jean XXII à Pont-de-Sorgues pour ce qui allait devenir mon mémoire de maîtrise », nous dit Valérie Theis. « Contrairement aux apparences, il ne s’agit pas d’une vulgaire photocopie, mais d’un tirage papier réalisé grâce à un objet en voie de disparition, le lecteur-reproducteur de microfilm. La première chose qu’elle vient ainsi rappeler est la colossale énergie collective mobilisée pour permettre à une étudiante de commencer à travailler ».
Avec cette première page, elle veut d’abord rendre hommage aux archivistes, aux bibliothécaires, à tous ceux qui par leurs conseils aident des étudiants à devenir chercheurs. Elle veut aussi montrer comment cette page de compte, en apparence austère, donne accès à la vie quotidienne des travailleurs sur un chantier pontifical au XIVème siècle, un « fascinant accès à la vie des gens ordinaires ». « Parce qu’il raconte les premiers pas d’une historienne au travail, il y a quelque chose de très personnel dans ce document. »
Le cahier de chansons de l’arrière-grand-père de Bertrand Tillier
« Avec ses couleurs fanées et son allure fatiguée, c’est un objet que je n’avais jamais vu avant que ma mère ne me l’offre, il y a quelques années. C’est un cahier de chansons qu’avait constitué son grand-père maternel, Léon Merle (1899-1971), pendant son service militaire comme engagé volontaire dans l’aviation au Maroc, en 1919-1920. Peu porté sur la chose militaire – en mon temps, j’avais réussi à me faire exempter du service national – et sans lien particulier avec « les colonies », j’ai rangé cette archive familiale dans une boîte, après l’avoir rapidement feuilletée, sans y déceler d’intérêt particulier, à part la présence de dessins sommaires qui m’avaient amusé. » Le cahier contient 54 chansons dont les paroles ont été soigneusement transcrites à l’encre noire, chansons patriotiques issues de la Grande Guerre, chansons coloniales, et surtout des chansons d’amour et chansons érotiques aux paroles grivoises.
« Ce qui saisit le plus l’historien des images que je suis, ce sont les dessins dont il a farci son cahier, au gré des chansons d’amour et surtout des chansons grivoises : tracées à l’encre et sommairement coloriées à l’aide de quelques crayons de couleurs, ces figures ont été, pour certaines, décalquées à l’aide d’un papier carbone bleu, d’après des périodiques, des cartes postales ou des chansons illustrées. Mais pour la plupart, elles ont été malhabilement dessinée à main levée ; certaines tirent vers l’inquiétant. A leur manière, elles disent combien l’apprentissage scolaire du dessin, obligatoire depuis 1882 à l’école primaire, repose exclusivement sur la maîtrise du dessin géométrique. »
« Malaise de l’archive familiale : comme si j’avais ouvert une de ses armoires à son insu, j’ai l’impression dérangeante d’accéder à l’intimité masculine de cet arrière-grand-père, quand il était un jeune soldat pris dans un univers d’hommes à l’érotisme marqué, où les images de femmes aidaient à s’évader, davantage que les avions qu’il entretenait tous les jours et voyait de très près, les mains dans le cambouis, mais dont il ne dessina aucun. »
La médaille napoléonienne de l’aïeul de Sylvain Venayre
« Il y avait chez mes grands-parents maternels », nous raconte Sylvain Venayre, « accrochée au mur du salon, une médaille, vaguement marron, dans un petit cadre de verre cerclé de métal, maladroitement fixé à un anneau de fer-blanc. Je savais, car ma grand-mère me l’avait dit à plusieurs reprises, que cette médaille avait appartenu à l’un de ses ancêtres (« Il a fait toutes les guerres de Napoléon », me disait-elle, « et il en est revenu, tu te rends compte »). La médaille est en bronze, suspendue à un ruban dont les couleurs vert et rouge sont aujourd’hui fanées. Encore bien visible, sur l’une des deux faces, on peut lire ces phrases encerclées de lauriers : « Campagnes de 1792 à 1815 / À ses compagnons de gloire sa dernière pensée / Ste Hélène / 5 mai 1821 ». Et, sur l’autre face, tout autour du profil romain de Bonaparte empâté : « Napoléon I empereur ». L’ensemble est surmonté d’une couronne, à l’image de celle que tient Napoléon au-dessus de Joséphine dans le célèbre tableau de Jacques-Louis David. Tout évoque donc ici Napoléon Ier mais, ainsi que l’indique la date de sa mort, le 5 mai 1821, la médaille lui est évidemment postérieure. »
Cette médaille fut créée en 1857, alors que Napoléon III cherchait à récupérer la gloire de Napoléon Ier. Appelée « médaille de Sainte-Hélène », elle fut décernée à 40 0000 vétérans des guerres de la Révolution et de l’Empire, français mais aussi étrangers, principalement belges, qui avaient constitué les régiments de la Grande Armée, avec pour conditions d’avoir participé à un bataille entre 1792 et 1815, et d’être encore vivant en 1857. « C’était le cas de cet ancêtre de ma grand-mère. La médaille de Sainte-Hélène n’a pas bonne presse. Elle a été donnée à trop de gens, trop longtemps après les faits, et d’abord pour légitimer l’Empire ambigu de Napoléon III, au lendemain de la meurtrière guerre de Crimée ». L’historien entreprend néanmoins d’interroger sa grand-mère, qui se souvient de ce que lui racontait son grand père, qui le tenait de son grand père, lequel s’appelait François Jau et avait reçu la médaille. « Ce François Jau mourut vers la fin des années 1870, ce qui fait que le grand-père de ma grand-mère, né en 1869, l’avait connu assez longtemps pour s’en souvenir – et pour perpétuer ensuite ce souvenir auprès de sa petite-fille. »
« Voilà donc tout ce que je sais de l’histoire de cette médaille et de celui à qui on l’a remise. J’en retiens qu’à ma génération (je suis né en 1970), avec une grand-mère née en 1922, on pouvait encore se raconter des histoires transmises oralement depuis les guerres de la Révolution et de l’Empire – en tout cas la partie de ces histoires que l’on n’avait pas oubliée. Ce sont certes de pauvres histoires (…) mais ce sont des histoires précieuses, où se donne à sentir, un peu, l’émotion de ceux qui racontèrent et transmirent, sans pouvoir les écrire, le souvenir lointain des grandes campagnes militaires. Il m’est difficile d’en dire plus. Si les historiens étaient capables d’écrire mieux que d’autres leur propre histoire ou celle de leur famille, ça se saurait. »
Joël Drogland