Nous sommes heureux d’accueillir ce point de vue tant ses préoccupations rejoignent les nôtres.
Bruno Modica
Président des Clionautes

Le titre qui m’avait été proposé était le suivant : « devons nous être nostalgique des écoles normales ? » Je propose, à bien y penser, de lui substituer, en guise d’introduction celui-ci : « Voulons-nous réellement la mort de la formation des maîtres de l’école primaire ? »
Alors évidement, cela pourra apparaître comme relevant d’un procédé rhétorique, qui m’éviterait de faire, en historien, la longue histoire de la formation des maîtres. Il est vrai aussi que deux éminents collègues s’y sont déjà attelés, avec talent : Yves Chevallard et le regretté André Ouzoulias, bien mieux que je ne saurais le faire, en dix minutes qui plus est. Cela m’évite aussi le fait de dire la position anachronique de juger de façon nostalgique une école normale à l’aune de la société actuelle. Autre temps autre école, autre société autre rapport à l’école. C’est entendu.
Un autre préalable s’impose ici : il ne s’agit pas dans ce texte de dresser arbitrairement un réquisitoire contre un acronyme, ni de fustiger qui que ce soit dans les ESPé, qu’il s’agisse des personnels d’encadrement, des administratifs ou des formateurs. Si les étudiants ont encore une formation, c’est bien souvent grâce aux dévouement de chacun, à la déontologie qui guide chaque acteur à ne pas compter ses heures et ses efforts. Ici, c’est la réforme qui est directement visée.
Alors que se terminait le quinquennat de Nicolas Sarkozy, nous étions nombreux à penser qu’en supprimant les IUFM, son gouvernement porterait longtemps la responsabilité de la dilapidation de la formation des maîtres de l’école primaire. La masterisation telle qu’elle avait été mise en place, pour des raisons idéologiques (non au « pédagogisme ») et de circonstances budgétaires, entraînait la formation professionnelle des maîtres de l’école primaire dans une situation que beaucoup d’entre nous avons mesurée dès la première année : de moins en moins de lien avec le terrain, avec les classes, disparition de la logique nationale de formation et moins d’ambition de construction d’une culture professionnelle commune, désagrégation des IUFM et de l’héritage des écoles normales en fonction et au bon vouloir des universités.
La Refondation de l’école prévue et annoncée par Vincent Peillon à l’aube du nouveau quinquennat, laissait entrevoir une ambition pour ceux qui, comme nous en étions, n’avaient pas d’opposition de principe à la masterisation de la formation des maîtres du primaire. La création des Écoles supérieures du professorat et de l’éducation, à laquelle nous avons cru et appelé le cas échéant, a définitivement confirmé la crainte que tous les acteurs de l’école primaire pouvait avoir : assister, impuissants, à la fin d’une réelle et sérieuse formation professionnelle de ceux qui sont chargés, au quotidien, de s’occuper des élèves le temps d’une année scolaire.
Historiquement, l’école primaire était le cœur des préoccupations, permettant une cohérence dans l’organisation de ce cycle fondamental de tous les enfants de la nation. Les IUFM, a leur manière, avaient tenté de maintenir cela. Aujourd’hui, une dissociation s’observe entre la formation (qui relève des ESPé au sein des Universités), de l’évaluation et de la gestion des personnels et des concours de recrutement, qui relève des Rectorat. Un recrutement en crise de vocation par ailleurs, qui fait recevoir beaucoup de candidats qui, à d’autres époques, n’auraient pas eu le concours.
Même l’Inspection générale et son groupe primaire, depuis 2010, a été dépossédée de facto de son rôle de contrôle et de participation aux jurys des oraux du concours. Plus aucune cohérence, plus aucune logique ne préside à l’encadrement de l’école primaire et de ses maîtres, dans une désorganisation qui fait des usines à gaz des modèles d’ingéniosité comparé à ce à quoi nous assistons aujourd’hui. Ici, on frôle le grand n’importe quoi.
Il faudrait aussi évoquer, comme conséquences inévitables de cette situation, les suspicions réciproques, le mépris pour les IUFM, l’absence désormais de lien entre tous les partenaires engagés dans la formation des maîtres. Autrefois (il n’y a pas si longtemps, rappelons-nous, c’était avant la masterisation) les formateurs IUFM travaillaient avec des maitres-formateurs, en classe, avec les étudiants, fréquentaient des inspecteurs de circonscription et des conseillers pédagogiques, partageaient le souci de ces jeunes qui venaient découvrir ce métier exigeant. Tout n’était pas parfait, loin s’en faut, et nous savons les combats que beaucoup d’entre nous avons menés pour tenter d’améliorer sans cesse ce qui ne fonctionnait pas. Mais au moins y avait-il encore une logique, une cohérence.
Osons le mot : un sens.
Aujourd’hui, chacun est dépendant de sa structure hiérarchique, incapable de trouver le temps et les modalités concrètes de tout travail en commun. Chacun fait son métier dans une absence totale de sens et de logique. Les étudiants le voient. Les Rectorats n’en ont cure. Les effets sur les élèves ne tarderont pas. Ils sont notre horizon d’attente pour lesquels nous avons des devoirs et des responsabilités.
Les ESPÉ, au sein de la masterisation, provoquent un phénomène très significatif de dilution des responsabilités pédagogiques et professionnelles : là où chaque centre de formation disposait d’une tutelle clairement identifiée, les centres intégrés à l’Université, relèvent de trois, voire quatre tutelles distinctes, dont certaines n’ont rien à voir avec la formation ou s’en soucient peu. Les formateurs doivent improviser des cours dans un contexte devenu inconsistant, sans logique et sans âme. Des procédures de validations qui changent d’une année sur l’autre, parfois d’un semestre sur l’autre, des matières qui se compensent d’autres pas, des formateurs exigeants et d’autres qui donnent la moyenne à tout le monde : tout existe, sans règle, sans raison et sans contrôle. L’anarchie est à son comble, là où les slogans de la Refondation de l’école de Vincent Peillon insistaient sur le nouveau « dynamisme de la formation des maîtres », sur « la priorité donnée à l’école primaire ». Face aux effets d’annonce, nous n’avons que désolation et dislocation.
Prenons les maquettes. Qui n’a pas travaillé dans la masterisation, puis dans les ESPé ne peut goûter tout à fait ce que ce mot désigne de formalisme et de logiques propres à décourager tout formateur et tout étudiant. Heures disciplinaires et de pédagogie générale en constante diminution, dilution des contenus sans plus aucun contact entre eux (pour une formation qui fait de la polyvalence sa valeur et sa vertu), perte de vue du terrain des classes, des élèves, des maîtres avec qui le travail pouvait être possible, des maîtres-formateurs disparus, et des conseillers pédagogiques qui cultivent, à leur manière, une nostalgie emprunte de méfiance et de prudences dans son expression publique à l’égard de leur assujettissement définitif aux corps rectoraux des Inspections d’Académie. Et qui regrettent définitivement que la formation leur soit presque quasiment retirée.
Au fond, en masterisation l’argument était : détruisons les IUFM idéologiques : la masterisation a érigé la technique et l’institutionnel vidé de sa substance comme idéologie. La technique et la science comme idéologie aurait dit Jürgen Habermas. S’il on ajoute les logiques pédagogiques tout entière tournées vers les compétences et les savoirs faire, le primaire peut dire adieu à la culture et aux savoirs.
Le concours qui a eu lieu au printemps dernier a donné une expression symptomatique de ce qui arrive : Seuls le français, les mathématiques et l’EPS sont obligatoires, ainsi qu’une épreuve de culture du système éducatif dont les modalités de passation restent, pour les jurys dont aucun n’est sociologue, chercheur, philosophe de l’éducation, loin parfois des grands enjeux de l’école aujourd’hui ; et plusieurs échos ont pu laisser penser que le sens commun remplaçait souvent le jugement argumenté.
Pour l’épreuve d’option, sur dossier (soit histoire, soit SVT, soit musique, soit etc…) les jurys ne sont pas disciplinaires, et jusqu’au début des épreuves, ni les étudiants ni les formateurs chargés de la préparation du concours ne savaient par qui, précisément, ils étaient composés, ni leurs attentes. Les oraux ne pouvaient que se passer de façon très aléatoire. On sait que le concours est, par définition aléatoire. Mais il répond toujours à des critères un tant soit peu repérables, anticipables, ne serait-ce que sur le contenu ou la thématique concernés. Là, beaucoup ce sont nécessairement « pas très bien passés ». Exemple : en géographie, sur les espaces touristiques littoraux, après avoir fait un exposé qui a été jugé « clair » par le jury (2 conseillères pédagogiques) il pouvait être reproché de faire un sujet trop précis, et de vouloir faire des élèves « des experts des littoraux ».
Il est à noter qu’à moins de penser que les formateurs des ESPé encadrant le suivi de la préparation des dossiers de concours (à l’aveugle, par pure conscience professionnelle, là où ils auraient dû refuser de le faire sans connaître les conditions et les modalités de passage des candidats) sont des fous furieux du concept géographique ou des contenus savants, il est clair que l’étudiante en question en savait simplement un peu plus et de façon plus précise que les membres de la commission.
Ne faut-il pas savoir beaucoup pour choisir et enseigner convenablement ? Sur l’esclavage, le fait d’avoir lu l’ensemble des références historiques majeures sur la question a pu être, pour certains, un handicap, face à un jury composé d’un inspecteur de l’éducation nationale et d’un conseiller pédagogique, prompts au contre sens, sur le Code noir, n’ayant pas lu les références bibliographiques en question…
De manière générale, les jurys ont semblé courroucés du fait que les candidats ne maîtrisaient pas la didactique de la discipline concernée. Mais comment cela aurait-il pu se faire (et se fera assurément) dans le cadre des maquettes actuelles de la formation des maîtres pour les Masters 1 où la didactique, précisément et majoritairement, est réservée au master 2 ? Comment répondre à ces questions lorsque de jeunes étudiants découvrent un contenu de savoir (et s’y investissent) et tentent maladroitement peut-être, mais sans formation véritable (quelques heures dans l’année en groupe, avec une individualisation qui ne relève que du sacerdoce du formateur), de dire des choses convenables sur comment faire passer ce savoir ? Et que dire des M2 qui entament une formation didactique (et nous savons ce que la didactique disciplinaires suppose d’exigences) et qui doivent affronter une (petite) formation avec des souvenirs issus du baccalauréat…
Faut-il renoncer à développer les liens nécessaires, désormais détruits, entre les différents acteurs du primaire dans chaque Académie ? Des propositions simples pour définir le rôle de chacun et les modes de communication entre les acteurs académiques et les universités s’imposent plus que jamais.
En construisant les ESPé, aujourd’hui coquille vide laissée aux atermoiements d’universités « naturellement » plus à l’aise pour réfléchir sur la formation des professeurs du secondaire, et aux Rectorats qui recrutent sans penser le volet formation, les étudiants qui se destinent au professorat des écoles vivent l’incurie, le dysfonctionnement, l’aléatoire.
Surtout, plus grave à nos yeux, ils rencontrent l’absence de cohérence et d’ambition nationale, dans des études laissées au seul contrôle d’Universités peu disposées, historiquement, à comprendre la spécificité du primaire, et des Rectorats dont le seul véritable objectif à cours terme est de de recruter.
La culture disparaît. La formation générale et pédagogique s’amenuise. Le lien avec les professionnels des classes est réduit à peau de chagrin. La césure entre la formation, le « terrain » et le rectorat la règle. Se pose dès lors une question simple : voulons-nous réellement la mort de la formation des maîtres de l’école primaire obligatoire ?
Si rien n’est fait dans les deux ans qui viennent, il y a fort à parier que les dégâts risquent d’être irréparables. Et de la « refondation », il faudra faire son deuil, mais aussi peut-être aussi de l’école primaire, école de la nation, école pour tous.
Une question se pose ? Jusqu’à quand faudra t’il colmater, s’adapter à des plans de formation incohérents, ? Combien de temps tiendrons-nous à remplir nos emplois du temps d’activités vaines et vouées à aucun horizon d’avenir ?
Si nostalgie il y a, c’est sur la question de la cohérence du projet, du sens et de la culture. Il est temps de définir, au-delà des bidouillages institutionnels, des conflits de territoire et de l’approximation permanente d’une organisation désormais exclusivement dictée par les tableaux Excel, un projet de formation, avec des chapitres obligés, des exigences précisées, des méthodologies rigoureuses. Les universités savent faire cela quand elles le veulent : en témoignent des licences et des masters professionnels de grande qualité. Car, si nous ne nous ressaisissons pas, si, faute de prendre au sérieux la formation de ses enseignants du primaire, notre école primaire se délite ou se privatise… nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
Pour finir, je voudrais parodier Charles Péguy quand il évoquait la question de la République (j’ai juste remplacé « République » par « formation des maîtres du primaire » :
On prouve, on démontre aujourd’hui la formation des maîtres du primaire. Quand elle était vivante on ne la prouvait pas. On la vivait.
Benoit Falaize


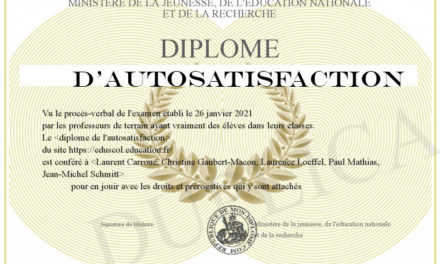
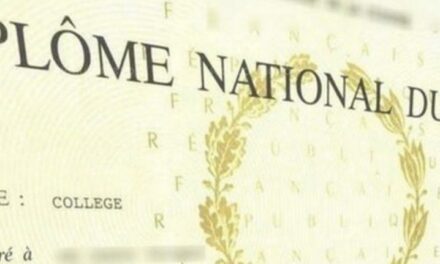












Trackbacks / Pingbacks