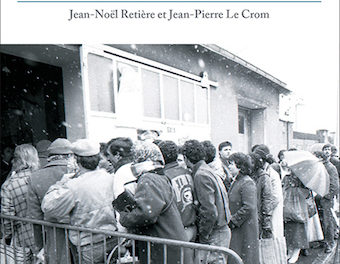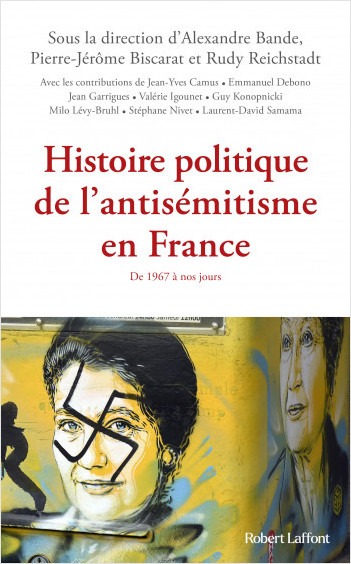Il est nécessaire de remonter au XIXe siècle pour comprendre les problèmes des collèges d’aujourd’hui. La persistance des termes risque de nous induire en erreur. “Collège” et “principal” existaient déjà il y a deux siècles. Nos modernes collèges sont très différents de leurs prédécesseurs, et pourtant cet héritage pèse encore sur eux. Pour le dire en deux mots, les problèmes présents viennent de ce que nous avons des “collèges”, et pas des “écoles moyennes”.
I Le XIXe siècle le temps des pionniers
Au XIXe siècle, dans une France rurale, sans chemins de fer, aux chemins cahotiques – où Guizot choisit des bénévoles possédant leur cheval pour visiter les écoles des villages -, l’instruction reste réservée à des privilégiés:
_ L’enseignement secondaire est payant. Il est donné dans deux types d’établissements : les lycées et les collèges. Les lycées, peu nombreux (56 en 1848, 83 en 1870), sont à la charge de l’Etat. Ils donnent le ton et servent de modèles. Les collèges communaux, au personnel moins qualifié, sont gérés financièrement par les communes (cf Littré). Bien que l’inscription d’un interne dans un collège coûte cher – elle correspond environ à un salaire annuel d’instituteur – la charge pour les communes est lourde. Ex Budget de la commune d’Argentan = 90 000 Francs dont 17 000 Francs pour le collège, ce qui ne permet pas d’avoir des professeurs spécialisés. Il ya un professeur, un “régent” pour chaque classe, et parfois on regroupe deux classes (ex. 6e-5e) autour d’un seul régent. Les agrégés ne se rencontrent que dans les lycées. Il y a ainsi deux enseignements secondaires : un enseignement de 1ère classe (lycée) et un de 2nde classe (collège)
On compte à la fin du XIXe siècle en France 250 collèges qui sont un élément essentiel du maillage secondaire du territoire. La plupart ont un internat, généralement au compte du principal, ce qui fait de sa femme une sorte de cantinière et de la qualité de la nourriture un élément non négligeable de sa réputation.
_ Le nombre moyen d’élèves est faible : 146 en 1898, mais la moitié des collèges communaux a alors moins de 118 élèves. Le collège d’Arbois d’où est issu Pasteur compte par exemple 65 élèves de la 11ème à la Terminale.
_ Le latin est enseigné dès la 8ème et l’on peut entrer au collège dès 6 ans… en tant qu’interne éventuellement.
Les cours sont très différents de la pédagogie actuelle : on fait un devoir par jour (version grecque, latine, thème latin, vers latins, discours latin) que le professeur corrige et qui est préparé en étude : 4 heures de cours, 7 heures d’étude, ce qui donne une importance considérable au maître d’étude et permet de faire tourner un collège avec 7/8 professeurs.
Leur compétence est parfois incertaine. En 1865, il y a 1320 professeurs de lettres dans les collèges communaux dont 1000 sont de simples bacheliers sans licence.
_
Il y a beaucoup d’abandons en cours de scolarité, car les parents sont en fait demandeurs d’un enseignement court. En 1876, s’il y a 2250 élèves en 6eme, il n’en reste que 643 en classe de Philosophie.
Pour augmenter leur nombre d’élèves, qui est un élément essentiel de leur équilibre financier, les collèges ont développé un enseignement plus court, mieux adapté aux demandes des familles, un enseignement qu’ils appellent souvent primaire supérieur. En 1865, Duruy réorganise cet enseignement et l’appelle enseignement “spécial”. Il compte un gros tiers des élèves, alors qu’il dure quatre années seulement.
Les républicains arrivés au pouvoir choisissent de développer l’enseignement primaire en le prolongeant par un enseignement primaire supérieur d’une durée de quatre ans (une année préparatoire et trois années). Cet enseignement est donné dans deux sortes d’établissements : des établissements de 1ère classe : les Ecoles primaires supérieures, pour lesquels ils recrutent des professeurs qualifiés, et des établissements de 2nde classe : les Cours complémentaires, qui sont simplement annexés à des écoles primaires et sont faits par des instituteurs chevronnés. Le ministère crée beaucoup d’EPS dans les années 1880, et les inspecteurs d’académie multiplient les CC. Les collèges se font alors en quelque sorte “voler” leurs élèves du spécial, ce qui compromet leur équilibre. A la fin du siècle, on voit apparaître chez les professeurs du secondaire la critique des instituteurs qui gardent leurs bons élèves au lieu de les envoyer au collège, comme les curés envoient leurs bons élèves dans les collèges catholiques, alors très prospères (ils gagnent des internes alors que les lycées et collèges en perdent).
II Au tournant du siècle, la réforme décisive
1902 : la réforme fondamentale de l’enseignement secondaire invente le cycle et la section, fondement sur lequel nous vivons encore aujourd’hui sans toujours le savoir.
Les débuts du latin avaient été repoussés en 6e en 1880. L’enseignement secondaire classique durait donc sept ans sans rupture. L’enseignement spécial avait évolué et était devenu un enseignement moderne, d’une durée de six ans. Les réformateurs de 1902 lui ajoutent une année et ils mettent à parité le classique et le moderne, qui conduisent tous deux à un baccalauréat de même valeur. Mais ils choisissent de couper le secondaire, classique comme moderne, en deux cycles : un 1er cycle de quatre ans avec une section classique (A) et une section moderne (B). Ainsi les bons élèves du primaire supérieur, qui font des études assez comparables à celles de la section B, pourront entrer dans le 2d cycle. Ils organisent ainsi une passerelle entre le primaire supérieur et l’enseignement secondaire. Le second cycle comprend quatre sections de A à D : latin-grec, latin-langues, latin-sciences, langues-sciences. Cette architecture, légèrement modifiée par la suppression de la section latin-langues, durera jusqu’en 1965.
Dès cette époque, apparaît le thème de la démocratisation – le terme date d’après la Grande Guerre. Ferdinand Buisson, qui avait été longtemps directeur de l’enseignement primaire, explique en 1899 que la différence entre le primaire supérieur et le secondaire est sociale et non pédagogique. Il développe cette analyse dans les années suivantes. Pour lui, il existe deux classes : ceux qui travaillent sans possèder et ceux qui possèdent sans travailler. Et s’il existe des bourses, ce sont des “exceptions consolantes”! Il propose donc en 1910, pour prendre date, une proposition de loi réorganisant l’enseignement en trois niveaux successifs, avec un seul et même enseignement primaire, ce qui signifierait la suppression des petites classes des lycées et collèges, un enseignement intermédiaire, et au troisième niveau des filières différentes.
_ Après la Grande Guerre, l’idée de démocratisation se répand. Un groupe d’universtaires qui se sont connus sous l’uniforme, les Compagnons de l’Université nouvelle, lance le slogan de “l’école unique” qui est abondamment repris. Un socialiste, Zoretti, propose une organisation démocratique pour rompre avec l’école de classe. Diverses commissions travaillent la question. La Fédération générale de l’enseignement, à laquelle appartient le SNI, et qui fait elle-même partie de la CGT, adopte un projet dans lequel, après un enseignement primaire unifié, un premier cycle commencerait par un tronc commun pour orienter les élèves. Ce projet est repris par le ministre du Front populaire, Jean Zay, sans aboutir. Les choses restent en l’état.
Plusieurs raisons expliquent cette inertie.
D’abord, le milieu de l’enseignement public, les syndicats et les partis de gauche, donnent la priorité à une autre réforme : il s’agit de faire aboutir le combat inachevé du début du siècle contre l’enseignement catholique. La grande revendication de l’époque n’est pas la démocratisation mais la nationalisation de l’enseignement. Elle est adoptée par exemple par le parti socialiste lors de son congrès de 1929 à l’unanimité sur rapport de Léon Blum. L’école unique passe au second plan, et elle est d’ailleurs dénoncée par la droite comme une offensive contre l’école privée, ce qui n’a pas de sens.
_ Un second combat mobilise la gauche à cette époque : le combat pour la paix. Nous ne comprenons plus le pacifisme viscéral de l’entre-deux-guerres. J’ai été surpris par exemple de l’ampleur du refus de la défense passive : il n’y a rien d’agressif dans la défense passive, mais à l’époque on y voit une militarisation de la société. Les instituteurs évitent dans leur enseignement tout ce qui peut conduire à l’éloge de la guerre. Le débat public tourne donc autour de leur pacifisme, que dénonce la droite, comme le maréchal Pétain dans un article de la Revue des deux Mondes de 1934.
_ Enfin, l’administration n’est pas favorable à cette réforme. Le directeur de l’enseignement secondaire y est hostile parce qu’il y voit la fin du classique. Il a aussi des raisons plus pratiques : les effectifs des collèges sont si faibles que leur retirer leurs petites classes (11e à 7e) serait les condamner à mort.
III Les occasions manquées
Pourtant, d’autres raisons, tout aussi terre à terre, rendaient la réforme particulièrement opportune.
D’abord, ces petits collèges posent un problème à l’administration. Le coût par élève est vraiment excessif. Une circulaire de 1922 prévoit de supprimer ceux qui ont moins de 150 élèves. Mais les communes résistent et rien ne se fait.
_ En 1925, la dénatalité provoque une crise de recrutement car il y a moins d’élèves. La natalité pendant la guerre a été inférieure de 40% à ce qu’elle était en temps normal, et les permissions n’y ont rien changé. Les classes de 6ème sont squelettiques dix ans plus tard, au point que le risque apparaît dans les lycées de voir fermer des classes. Pour l’éviter, on prend des élèves qu’on aurait refusés en temps normal. Dans l’académie de Caen, les lycées se contentent d’une moyenne de 7/20, et trois lycées descendent même jusqu’à 6/20. La défense de l’emploi passe avant celle du niveau.
_ Mais il y a une autre solution : l’amalgame. Il s’agit de regrouper pour les mêmes enseignements les élèves en petit nombre du collège et ceux, en tout aussi petit nombre, de l’EPS ou du CC voisin. On fait ainsi des économies appréciables, sans que l’effectif de la classe amalgamée soit très élevé. Le ministère pousse en ce sens à partir de 1926.
L’exemple, à dire vrai exceptionnel, de Saint-Amand-les-Eaux montre comment cette stratégie de réduction des coûts pouvait conduire à une réforme démocratique. Le collège n’avait que 8 élèves en 6ème, et 5 dans chacune des trois classes suivantes, c’est à dire 23 élèves pour 4 niveaux. Le maire décide de réunir le collège, les cours complémentaires et une école pratique de même niveau. La classe de 6ème est appelée classe de distribution et réunit tous les élèves, qu’ils se destinent au secondaire, au primaire supérieur ou au technique. Tous les bons élèves font du latin. Il y a trois professeurs. En 5ème, tous les élèves font deux heures par semaine de travail manuel. Les options divergent à partir de la 4ème. C’est une véritable école moyenne qui joue pleinement son rôle d’orientation.
_ Cette fusion des premiers cycles était facilitée par la proximité relative des professeurs. A l’époque, les professeurs de collèges sont licenciés (licence passée en 2 ans après le bac), mais ceux des EPS sont recrutés par concours au sortir de de l’ENS de Saint Cloud. On ne peut dire qu’ils soient moins qualifiés.
L’amalgame a connu un certain succès jusqu’en 1930. Il se heurtait à l’opposition des chefs d’établissements. Le jumelage de l’EPS de Douai avec le lycée échoue par exemple en 1925 devant l’opposition du directeur, qui ne veut pas perdre son poste.
Les écoles primaires supérieures ont mieux résisté à la crise démographique que les lycées. La demande sociale se portait en effet vers le primaire supérieur plus que sur le secondaire. Deux indications le prouvent. En 1925, on a unifié le concours des bourses, en alignant leur montant sur les frais de scolarité réels des divers établissements, pour que cela ne coûte pas davantage aux familles de mettre leur garçon au collège qu’au CC. L’immense majorité des lauréats a choisi l’EPS ou le CC, pas le collège ou le lycée. Dans les années 1930, avec la reprise démographique, et la gratuité de l’enseignement secondaire instituée en 1930, les effectifs augmentent partout. Les lycées créent un examen d’entrée en 6e. Mais les EPS recrutent sur concours, et il y a beaucoup moins de places que de candidats. A Thiers, Marseille, cinq candidats pour une place en 1934. Pour le secondaire, c’est une injustice intolérable : le primaire garde ses bons élèves au lieu de les envoyer au lycée. C’est une concurrence déloyale.
Pour la faire cesser, en 1941, le ministre de Vichy Carcopino intègre purement et simplement les EPS au secondaire et les transforme en collèges modernes. Dans son esprit, les CC devaient se limiter à la classe de fin d’études primaires. Mais son successeur les apprécie beaucoup et il les développe. La concurrence du primaire supérieur, décapitée par l’annexion des EPS, renaît dans les CC. Comme ils sont beaucoup souples, faciles à créer, très décentralisés et très proches des familles, ils se développement plus rapidement que les premiers cycles des lycées qu’ils devancent à la fin des années 1950.
La Libération a constitué une seconde occasion manquée de réaliser une vraie école moyenne. Le directeur de l’enseignement du second degré, Gustave Monod, avait repris en l’élargissant à tout le premier cycle une expérience pédagogique menée sous Jean Zay avec des classes de 6ème d’orientation. Monod a créé des classes nouvelles, dans des lycées de centre-ville. Il s’agissait d’observer les élèves de façon plus large, en donnant beaucoup de place aux arts et au travail manuel, aux méthodes actives, à l’enquête. Un effectif de 25 élèves par classe, une heure de concertation hebdomadaire pour les professeurs modifiaient radicalement le climat. Dans son esprit, pour que l’orientation se fasse, il fallait reporter au-delà de la 6ème le début du latin. La commission Langevin Wallon, à laquelle il participait activement, se prononca par un vote sur le report en 4ème des débuts du latin. Mais la pression des défenseurs du latin fit reculer le ministre, qui décida que les 6ème nouvelles ouvriraient à la rentrée 1945 avec du latin à partir du second trimestre. La commission Langevin-Wallon a perdu la bataille bien avant d’avoir rendu son rapport.
Rien ne se passe sous la IVe République. Quatorze projets de réforme sont élaborés, qui tous échouent. On explique généralement cette inertie par l’opposition du SNI et du SNES. C’est une vision un peu courte. Certes, ces deux syndicats défendent chacun leur périmètre de recrutement et les carrières de leurs membres. Mais réduire le débat à ces enjeux corporatifs interdit d’en mesurer la profondeur. D’une part, ce ne sont pas simplement deux syndicats qui s’opposent, mais deux institutions : la direction de l’enseignement secondaire et celle de l’enseignement primaire font bloc avec leurs syndicats. On a même vu le directeur du primaire élaborer un projet de réforme pour contrer celui, trop favorable au secondaire à ses yeux, que son ministre avait fait approuver par le Conseil supérieur. D’autre part, ce sont aussi deux conceptions différentes de la démocratisation. Du côté du secondaire, on refuse une “démocratisation au rabais”. Il faut donner aux enfants de tous les milieux, ce qu’il y a de meilleur dans notre culture, c’est-à-dire les humanités classiques et ne pas compromettre la formation de l’élite en amputant l’enseignement classique de ses premières années. Du côté primaire, on souligne à quel point cette ambition est éloignée des désirs des familles, et l’on préconise une culture moderne, avec des aspects techniques, qui permettent vraiment aux enfants de se situer dans la société de leur temps, et non dans la Rome de Cicéron ou la Grèce de Démosthène.
IV Les collèges de la Ve République : un compromis boiteux
La Ve République veut prouver son efficacité, par contraste avec l’impuissance du “régime des partis”. Elle va donc réaliser la réforme, en deux étapes : le décret Berthoin crée en 1959 un cycle d’observation de deux ans (6ème-5ème), puis un décret de 1963 lui ajoute un cycle d’orientation de deux ans aussi. Le premier cycle, qui s’autonomise ainsi, est enseigné dans deux types d’établissements, les CEG (Collèges d’enseignement général) qui prennent la suite des CC, et les CES (Collèges d’enseignement secondaire), qui sont des établissements nouveaux. Leur fusion en 1975 crée le collège unique. En une quinzaine d’années, grâce à la construction de 2.500 collèges, l’organisation scolaire est ainsi totalement remaniée, avec une école primaire unique (plus de classes primaires dans les lycées), un collège unique, puis les lycées qui ont perdu leur premier cycle (sauf à Paris) et ne durent plus que trois ans.
_ C’est la réalisation de l’école unique : une idée de gauche qui aboutit sous un gouvernement de droite. Plus qu’un paradoxe, c’est la rencontre de deux logiques:
Pour la gauche, le but est de favoriser l’égalité des chances en orientant les élèves selon leurs résultats et non selon leur milieu. Il s’agit de démocratiser l’école. C’est une logique sociale.
Pour la droite, il s’agit d’élever le niveau de la nation ; la France ne peut se permettre de négliger des talents, il faut recruter l’élite scientifique et technicienne sur la base la plus large possible : c’est une logique économique. L’ordonnance du 6 janvier 1959 prolonge la scolarité jusqu’à 16 ans.
Cette croissance prend la forme du collège unique. Mais pas n’importe lequel. Pour les réformateurs du ministère, autour du Directeur général de l’organisation et des programme, le recteur Capelle, ce doit être une école moyenne qui assure la transition entre l’école et le lycée. Elle doit commencer par un tronc commun sans latin d’au moins un an, et finir avec des sections diversifiées pour qu’il y ait une orientation. Il faut donc des établissements assez gros pour avoir plusieurs sections différentes en 3ème, et aux niveaux précédents. Or sous la pression des élus locaux, les inspecteurs d’académie créent de tous petits collèges à une seule classe dans des villages. Pour y mettre bon ordre, il faut une carte scolaire.
_ Le Premier ministre, Pompidou, est “violemment hostile” au tronc commun. Tout le monde a pourtant conscience, à l’époque, de la nécessité de changer la pédagogie : on ne peut pas scolariser l’ensemble de la classe d’âge avec des méthodes et des contenus conçus pour former une élite restreinte. Pompidou ne dit pas le contraire, mais il ne veut pas qu’on touche à l’enseignement classique, ce qui suppose la continuité de l’enseignement secondaire et du latin de la 6ème à la Terminale. Il l’impose à Capelle. J’ai trouvé aux archives deux versions successives d’un même rapport d’une commission de 1962. Dans la première, il y a une partie intitulée “Les établissements polyvalents de premier cycle”. Ce sont des collèges uniques, avec un tronc commun, et des professeurs différents de ceux des écoles comme des lycées. Dans la seconde, qui est le rapport annoté et accepté par Pompidou, cette partie a disparu. Le rapport est signé de l’adjoint de Capelle : René Haby, le même qui achèvera comme ministre le collège soi-disant unique en 1975.
_ La discussion entre Matignon et le ministère aboutit à un compromis. Capelle gagne sur la carte scolaire : il y aura bien des collèges, et pour qu’ils puissent orienter, ils auront au moins trois sections par niveau, soit au moins 300 élèves, ce qui suppose une population de 4.000 habitants. Mais il perd sur le tronc commun (le latin commence au deuxième trimestre de 6ème) et le corps enseignant unique. On gardera dans les collèges des professeurs de lycées, des certifiés, pour enseigner dans les sections d’enseignement “long”, et des professeurs d’enseignement général des collèges (PEGC), de formation différente (école normale plus deux, puis trois ans de faculté), pour enseigner dans les sections d’enseignement “court”.
Capelle espérait que le brassage des enseignants, certifiés et PEGC, de culture pédagogique différente, finirait par produire une osmose, une hybridation. En fait, comme dans tous les cas analogues, il y a eu attraction du corps le plus prestigieux sur le moins prestigieux. Les PEGC, initialement bivalents, ont imité les certifiés spécialisés. En 1980, 80% des PEGC n’enseignement qu’une discipline. En 1986, le ministre met le corps des PEGC en extinction. On ne recrute plus que des certifiés pour les collèges. On compte aujourd’hui 11.370 PEGC sur 180.000 professeurs de collège.
On a donc répondu à une demande de prolongation de scolarité de type primaire supérieur, par un enseignement de type secondaire. Inévitablement, car les élèves sont ce qu’ils sont et les professeurs s’adaptent, cet enseignement a évolué. Ce n’est plus le premier cycle des lycées d’autrefois. Mais il en a gardé l’esprit. Ce que traduit la persistance du vocabulaire : nous n’avons pas de vraies écoles moyennes ; nous avons des collèges, dirigés par des principaux.
Précisions apportées suite aux questions du public
A propos de la création des COP.
_ A l’origine (début XXe siècle) les CO qui existent ont été créés par des villes ou des chambres de commerce. C’est Jean Zay qui, en obligeant tous les apprentis à présenter un certificat attestant qu’ils ont passé un examen d’orientation professionnelle (1938), jette les bases de ce qui va devenir un réseau complet.
A propos de l’enseignement professionnel
_ Vichy a créé des centres de formation professionnelle. Ils comptent entre 40 et 50.000 élèves en 1944. La Libération les transforme en Centres d’apprentissage. Ces CA se développent, deviennent Collèges d’enseignement technique en 1959, puis en 1975 lycées d’enseignement professionnel et en 1985 lycées professionnels.
L’éducation nationale ne cesse de revendiquer la formation de pans entiers de formation dont elle ne s’est pourtant pas occupée. Ainsi de la formation permanente. Quand les syndicats et les patrons se mettent d’accord en 1970 sur la formation continue dans les entreprises, l’Education nationale qui ne s’en est encore jamais occupée, crie au “démantèlement”. L’enseignement professionnel de Vichy s’est développé en dehors d’elle, et avec des méthodes qu’elle considère comme du dressage, très éloignées de ce qu’elle appelle une formation “méthodique et complète”. Pour en reprendre le contrôle, elle a accepté qu’il conserve en grande partie son originalité pédagogique.
A propos des gestions municipales
_ Les collèges communaux ont été tranformés progressivement par des lois successives en lycées nationalisés. La croissance rendant la gestion de tout le second degré par le ministère impossible, celui-ci a délégué la tutelle des lycées aux recteurs en 1962, ce qui a obligé à diviser les trop grandes académies et à créer sept rectorats supplémentaires. Les lois de décentralisation ont donné la personnalité aux lycées et collèges, qui sont devenus des EPLE (établissements publics locaux d’enseignement) en 1983, le fonctionnement des lycées étant transféré aux régions, et celui des collèges aux départements.